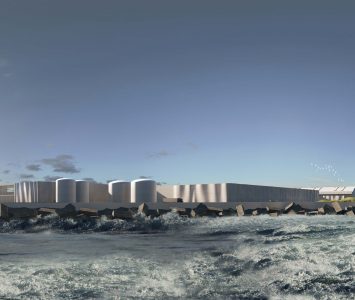Les visages de la poissonnerie traditionnelle sont divers. Mais sédentaires ou ambulants, petites ou grosses structures, poissonneries du littoral ou des terres, le grand défi à relever est le même pour assurer à ce circuit stratégique pour la pêche française un avenir : toucher le consommateur. L’étude sur la poissonnerie de détail, menée par Via Aqua pour FranceAgriMer, révèle la fragilité d’un circuit dont le potentiel, pourtant, est bien réel.
Six ans se sont écoulés depuis la dernière enquête sur la poissonnerie de détail et, fait nouveau, elle prend en compte l’activité des non-sédentaires. De quoi permettre de mieux évaluer la densité du réseau. En moyenne, l’Hexagone disposerait d’une poissonnerie pour 8 000 habitants. Pas si mal en soi. Sauf qu’à regarder l’implantation géographique des boutiques et marchés, force est de constater que si les zones littorales comptent près d’une poissonnerie pour moins de 3 000 habitants, l’est de la France est moins bien doté : on n’y recense qu’un point de vente pour 50 000 habitants. La place est libre pour les grandes surfaces présentes partout sur le territoire.
La légère augmentation du nombre de boutiques sur les six dernières années n’a pas corrigé le tir. Alain Caillat, associé chez Via Aqua, constate d’ailleurs que « le chiffre d’affaires global de la poissonnerie n’a pas progressé. Sur l’univers du frais, la part de marché de la poissonnerie de détail s’est érodée plus encore qu’en hyper et super. Et ce qui est le plus dommageable, c’est que les artisans n’ont pas compensé cette baisse en développant le traiteur ». Un segment sur lequel, selon lui, il faudrait investir pour s’assurer un avenir plus prometteur. « La marge brute sur les produits traiteurs avoisine les 47 ou 48 %, contre 40 % sur les produits bruts. Se lancer dans les produits traiteurs permet d’amortir un peu les coûts logistiques qui restent très élevés, puisque l’on peut acheter des produits uniquement pour faire du traiteur », valide Bernard Benassy, directeur de la Scapp et du groupement des poissonneries Corail. Dans ce réseau de poissonneries indépendantes, la part des produits traiteurs, tels que des brochettes, des rôtis, des plats cuisinés, etc., monte jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires. Le responsable n’y voit qu’une limite : « La restauration. On peut imaginer des espaces dégustation dans une poissonnerie, mais la restauration, dans une boutique où la fraîcheur est de mise, ne peut pas fonctionner. Pour réussir, il faut créer un autre établissement, avec des salariés à part, et surtout savoir gérer. »
Installé à Saint-Quay-Portrieux, sur le port, Stéphane Le Rouzès, dirigeant de la société Louis et Georges, a conscience qu’ « il y a une demande pour du prêt à consommer, du traiteur, des sushis. Mais nous en faisons peu. C’est moins de 10 % de notre chiffre d’affaires et nous avons plutôt tendance à acheter des produits traiteurs à des spécialistes qu’à le faire nous-mêmes. Le principal frein au développement interne est lié à la complexité des règles sanitaires et aux investissements à consentir ».
|
« Mettre le cap sur le traiteur »
Alain Caillat, associé Via Aqua, auteur de la dernière étude sur la poissonnerie
« Pour développer la poissonnerie de détail, le premier levier n’est pas celui du maillage territorial, même s’il est important, mais celui du développement de l’offre, notamment celle du traiteur. Aujourd’hui, alors que c’est l’unique segment de marché en progression dans les ventes de produits de la mer, les achats des ménages en produits traiteurs stagnent en poissonneries de détail, qui ne détiennent que 2 % de parts de marché en volumes et 3,3 % en valeur. |
En région parisienne, sur les marchés de Neuilly et de La Garenne-Colombes, Éric Michelet, des Produits de la Mer, constate que « la belle dynamique que l’on a connu sur les produits traiteurs voilà une quinzaine d’années est un peu retombée. Certes, nous en faisons toujours, avec des brochettes, des papillotes. Nous complétons avec des plats préparés par un ancien poissonnier devenu traiteur qui ne livre que des poissonneries avec des produits qualitativement différents et enfin, par des produits achetés auprès de grossistes à Rungis. Mais je ne suis pas sûr que s’engager dans le traiteur ou le très élaboré soit notre métier. Pour finir, trouver un bon cuisinier n’est pas simple ».
La stabilité relative des ventes de produits traiteurs s’explique pour Monique Lebeaupin, dirigeante de la société éponyme de mareyage et de vente en gros nantaise, par « la dynamique des ambulants. Ce sont eux qui amènent la croissance dans le circuit, mais ils misent peu sur le traiteur, qui se développe plus en boutiques ».
Or, dans ces dernières, certaines souffrent, à commencer par les entreprises familiales réalisant moins de 300 000 euros de chiffre d’affaires par an. « Investir dans le traiteur et des équipements pour proposer une offre non standardisée qui permette aux poissonniers de se démarquer de la GMS est vraiment une piste à explorer. Mais il est nécessaire d’assurer un accompagnement », souligne Alain Caillat. Selon lui, les structures professionnelles doivent aider leurs adhérents à entrer le domaine en les guidant sur le choix des équipements, en proposant des recettes, en soutenant l’aide au financement ou en favorisant la mutualisation d’un recrutement de cuisinier. « Pourquoi pas, réagit Stéphane Le Rouzès, mais c’est un métier où les gens se sentent vite en compétition. »
Dès lors, c’est sans surprise que le développement des produits traiteurs faits maison, devenu récemment la piste de relance des grandes surfaces pour leurs rayons marée, n’est pas vu comme un critère de compétitivité par les poissonniers de détail. Pas plus d’ailleurs que les promotions, relevées pourtant, dans les commentaires du blog consommateurs mis en place et étudié par Via Aqua, comme une attente forte des Français, notamment les plus jeunes, dont le pouvoir d’achat n’est pas aussi élevé que celui de leurs aînés. « Vu notre clientèle, les promotions ne servent à rien », affirme Bernard Benassy. « On essaie plutôt de mettre en avant la belle opportunité, liée à la saison. Mais ce n’est pas vraiment une promotion, évoque Éric Michelet. Par contre, on réfléchit à des outils de fidélisation. Une carte avec un tampon, comme pour l’esthéticienne. » Mais l’heure n’est pas au passage à l’acte. Une question de génération ? La jeune équipe d’Ô’poisson.fr, qui a désormais basculé toute son activité en ligne, propose déjà à ses fidèles clients des bons de réduction.
Néanmoins, le plus beau poisson du monde, l’offre traiteur la plus alléchante et des promotions attirantes ne suffisent pas pour réussir si les consommateurs n’entrent pas dans la boutique ou ne s’arrêtent pas sur un marché !
« Or, le blog consommateurs a révélé que certains ne savaient même pas où se situait la poissonnerie la plus proche, note Alain Caillat. Les pouvoirs publics doivent soutenir le commerce traditionnel, en faisant savoir à leurs habitants où se trouve le poissonnier sur le marché, etc. Les poissonniers n’ont pas le temps de faire ce travail de publicité. » C’est aussi aux pouvoirs publics de soutenir l’installation des commerces de centres-villes en aménageant des parkings. « À défaut d’être proches d’une poissonnerie ou de pouvoir s’y rendre facilement après le travail, les Français ne fréquentent plus les poissonneries. »
Vivant le problème de la désertion des centres-villes au quotidien, de plus en plus de professionnels réagissent. « Ils se délocalisent pour s’installer en périphérie, comme l’on fait les boulangers avant eux, pour se rapprocher de la clientèle, indique Bernard Benassy. Ils disposent alors d’une surface de vente plus grande, proche des 300 m2, qui leur permet de développer l’offre traiteur, le préemballé et ainsi de séduire une clientèle plus large. » Les chiffres d’affaires, en baisse dans les centres-villes, reprennent des couleurs : « À Montauban ou à Annecy, deux collègues sont passés de 700 000 euros de chiffre d’affaires à plus d’1 million en quelques mois. »
Pour Alain Caillat, les poissonneries traditionnelles, comme les GMS, auraient même un certain intérêt à s’installer dans les galeries marchandes des hypers. « Les premiers bénéficieraient du trafic, les autres n’auraient pas forcément besoin d’investir, parfois à perte, dans un rayon d’image. Dans d’autres métiers de bouche comme la crémerie, cela a fonctionné. »
Sur ce point, Bernard Benassy se montre sceptique : « La clientèle n’est pas la même. » Certains professionnels des centres-villes préfèrent donc s’allier avec d’autres artisans à proximité pour faciliter la collecte de commandes passées en un lieu unique.
|
« La fréquentation des marchés diminue » Éric Michelet,
« Nous travaillons sur les marchés de Neuilly et La Garenne-Colombes, des marchés où la population a du pouvoir d’achat. Mais depuis plusieurs années, la fréquentation diminue et le chiffre d’affaires avec. En quelques années, nous sommes passés de 1,2 million d’euros à 815 000 euros. Les travaux qu’il y a pu avoir n’expliquent pas tout. Certains clients âgés ne peuvent plus se déplacer et les nouveaux retraités sont plus volatils, ils voyagent et ne viennent pas chaque semaine. Quant aux jeunes, ils ont un problème de pouvoir d’achat. Nous avons beau offrir une large gamme de produits, notre prix moyen d’achat est à 10 €/kg. Pour le consommateur, cela fait 20 €/kg. Ce n’est pas donné et les gens hésitent d’autant plus que le prix au kilo ne leur parle plus. Depuis deux ans, nous mettons de plus en plus de prix à la pièce, préparons des sachets de crevettes à 5 ou 10 euros, des papillotes, etc. Mais face à la baisse de fréquentation des marchés, je me prépare aussi à en fermer un et à ouvrir la vente sur entrepôt le jeudi, vendredi et samedi après-midi. Cet entrepôt au pied de la Défense avec quatre places de parking peut nous permettre de faire face et conserver nos cinq salariés. ” |
Pour encourager ce mouvement, Epicery.com, créé en 2016 par Elsa Hermal et Édouard Morhange, fédère sur internet près de 300 commerçants de quartiers parisiens ou lyonnais. Les consommateurs passent commande auprès de ceux de leurs choix et se font livrer l’ensemble chez eux à l’heure et au jour choisis. Plusieurs poissonniers parisiens comme Maison Vanhamme, la poissonnerie Quoniam Mouffetard, Le Petit Chalutier, la poissonnerie Collachot et d’autres ont rejoint avec satisfaction la plateforme. Le déploiement national d’Epicery.com devrait débuter en 2018 avec l’arrivée de Monoprix comme partenaire et soutien logistique.
Des initiatives qui permettent de comprendre l’optimisme des professionnels. Interrogés sur leurs perspectives à cinq ou dix ans, 18 % d’entre eux estiment qu’ils connaîtront une croissance de chiffre d’affaires de plus de 10 %, 29 % de moins de 10 %, contre seulement 17 % qui estiment qu’ils subiront une chute. Enfin, 44 % sont optimistes voire très optimistes sur l’avenir du circuit, contre seulement 39 % de pessimistes – en 2011, 54 % des professionnels interrogés voyaient l’avenir en noir.
Pourtant, l’analyse des forces et faiblesses par rapport à l’environnement réalisée par Via Aqua laisse entrevoir un avenir plus sombre, notamment pour les 50 % d’entreprises familiales. Celles dont les dirigeants n’ont pas le temps de se pencher sur la gestion. « Cette question est clé. Il est essentiel de savoir vite ce qui va ou ce qui ne va pas pour réagir, de calculer ses marges, etc. », indique Éric Michelet. C’est crucial quand les prix de la matière première grimpent, que les coûts d’une logistique en A pour B grèvent les bénéfices. Au point que certains, comme Bernard Benassy, se demandent s’il ne faudra pas passer en A pour C parfois.
Céline ASTRUC
|
« Les gens n’ont pas la démarche d’aller en poissonnerie » Maxime Le Bousso, cofondateur de Ô'poisson.fr
Nous venons tout juste de fermer la boutique d’Orvault, en périphérie nantaise, pour nous installer aux Sables-d’Olonnes et nous consacrer exclusivement aux expéditions aux particuliers et à des professionnels, à commencer par ceux qui développent des box repas, etc. |