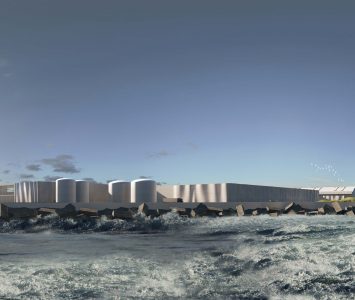Le Canada et l’Union européenne ont signé le 30 octobre 2016 l’AECG (Accord économique et commercial global) ou Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement). À l’heure où la nouvelle administration américaine s’interroge sur le bien-fondé de ce type de traité, qu’en est-il de son entrée en vigueur et de ses effets sur les échanges transatlantiques de produits de la mer ?
|
Sommaire : 1- PdM : On a parlé d’une potentielle entrée en vigueur provisoire du Ceta en avril 2017 ? Concrètement… 2- Le Canada est un partenaire commercial important de l’Union européenne en produits de la mer. Quels changements apporte le traité ? 3- Le homard, le crabe des neiges et les crevettes représentent 67 % de la valeur débarquée au Canada, quelles seront les opportunités offertes par le traité ? 4- Le consommateur va-t-il en profiter ? 5- L’accord pose-t-il des problèmes techniques aux opérateurs canadiens ? 6- En retour, des opportunités s’ouvriront-elles pour les produits de la mer européens sur le marché canadien ? 7- Les détracteurs du Ceta craignent que le traité remette en cause les normes de qualité des produits. Est-ce fondé ? |
 |
|
Yannick Dheilly, |
1- PdM : On a parlé d’une potentielle entrée en vigueur provisoire du Ceta en avril 2017 ? Concrètement…
Yannick Dheilly : Plusieurs étapes jalonnent l’adoption définitive du traité international entre le Canada et l’Union européenne. L’automne dernier, les exécutifs européens l’ont signé, avec la difficulté que l’on a vue en Belgique car le chef d’État n’avait pas la délégation pour toutes ses composantes. Il a néanmoins été ratifié en février, même s’il est aussi prévu des votes par les parlements nationaux, voire régionaux dans certains pays, avant l’entrée en vigueur définitive. Ces étapes, longues, obligatoires et complexes, n’empêchent pas une mise en application provisoire d'une grande partie de l’accord, quasiment 95 %. Notamment sur les droits de douane, qui sont de compétence européenne et pour lesquels le vote actuel est suffisant. Nous attendons néanmoins le vote du Sénat canadien qui effectue une troisième lecture de la loi. Celui-ci acquis, et je ne connais pas la date exacte, elle pourrait être promulguée à partir de mai. L’accord provisoire pourrait donc être efficient dans les prochains mois.
2- Le Canada est un partenaire commercial important de l’Union européenne en produits de la mer. Quels changements apporte le traité ?
Y. D. : Le Canada occupe le 12e rang dans les relations commerciales globales avec l’Union européenne. Par ailleurs, il exporte 85 % de ses produits de la mer. À terme, à savoir sept ans maximum, les droits de douane sur les produits de la mer canadiens exportés vers l’Europe seront nuls. Pour un certain nombre de produits, ce sera même immédiat. C'est le cas pour les homards vivants, première espèce pêchée en valeur au Canada, et les saint-jacques fraîches et congelées… Pour le homard, les droits n’étaient pas si élevés (8 %) mais la baisse est conséquente sur des espèces comme le hareng (15 %) et le maquereau (20 %) congelés, voire le saumon fumé (13,5 %). Pour certains autres produits, le homard transformé par exemple, les délais de mise en œuvre sont plus longs : trois, cinq ou sept ans. Les gens qui connaissent le pourquoi de ces délais sont les négociateurs et ils sont peu nombreux. Il s’agit de négociations, avec des rounds successifs qui impliquent des échanges sur l’ensemble des produits alimentaires. Par rapport à la viande bovine ou porcine, les produits de la mer n’ont pas présenté de problèmes majeurs dans le traité.
Une grande partie de la pêche européenne porte sur du frais, alors que le Canada exporte surtout en surgelé. Les potentielles substitutions ne seront donc pas immédiates sauf peut-être en homard vivant mais il y a un différentiel de prix entre l'espèce européenne et canadienne. Quant aux saint-jacques, elles s’exportent en surgelé, à la différence des États-Unis. Résultat, peu de concurrence directe avec la France et l’Europe qui est elle-même un importateur majeur de produits de la mer.
|
David Sussmann,
« Avec deux filiales au Canada, nous espérions cet accord depuis longtemps, avec l’attente de baisses de tarifications, différentes selon les espèces. Les droits de douane sur le homard vivant baissent dès maintenant, mais pour la chair, cela prendra cinq ans. Ensuite, le homard a doublé de prix en trois ans, ce qui nous ramène à une éventuelle baisse, toute relative ! Mais cela va fluidifier les marchés de poissons de fond ou de crevettes. Le Canada apparaît encore plus comme une alternative aux États-Unis et à l’Asie. Au moment de prendre des positions, en début de saison, nos clients sont à l’affût. Ils espèrent saisir des opportunités de prix. À nous de leur en faire profiter. Nous sommes, a priori, en train de rentrer dans le concret. Mais cela fait longtemps que l’on en parle, et tant que ce n’est pas appliqué, nous devons travailler. Ce traité de libre-échange est une très bonne nouvelle. Il n’y a pas de raison que les produits français ne profitent pas non plus d’opportunités en retour : tout ce qui part en vivant ou en frais de Rungis notamment. » |
||
3- Le homard, le crabe des neiges et les crevettes représentent 67 % de la valeur débarquée au Canada, quelles seront les opportunités offertes par le traité ?
Y. D. : Le crabe des neiges est une espèce complexe, avec des cycles et des prix très variables. Il reste moins cher que le king crab, mais nous n’avons pas réussi à vraiment ouvrir le marché en France. Contrairement au homard, dont la production est stable. En crevette boréale, il existe un marché de redistribution, car l'espèce est plus appréciée dans le nord de l’Europe. Elle transite par le Danemark vers le Royaume-Uni mais peu en France où la tropicale domine le marché avec des volumes considérables. Pour la saint-jacques, le marché est complexe et limité par les apports. La canadienne, de gros calibres et en grande partie surgelée mer, restera un produit cher et de qualité. Les moules de la côte sont de la même espèce Mytilus edulis avec un taux de chair excellent au moment où il est faible en Europe, soit en avril, mai et juin. Elles sont déjà présentes via les Pays-Bas, mais aussi dans la restauration en France, même si le transport aérien fait monter le prix.
Les huîtres de la côte est (Crassostrea virginica) ne sont pas compétitives car leur croissance est lente. Mais celles du Pacifique (Crassostrea gigas) offrent un potentiel théorique malgré la grande distance et le transit par Toronto. Ceci dit, on fait déjà de l’export de champignons sauvages dans les mêmes conditions ! Les pays de l’Europe de l’Est trouveront des opportunités sur le maquereau ou le hareng. Nos captures de thon blanc connaissent aussi une belle dynamique, mais cela ne devrait pas spécialement intéresser la France.
L’Union a des accords douaniers avec de nombreuses origines – pays scandinaves, Afrique, Amérique latine – qui bénéficient de taux moins élevés que le Canada. Nous allons avant tout rééquilibrer une situation. La Canada exporte beaucoup, dans le monde entier, surtout aux États-Unis, en Chine et chez tous ceux qui veulent des produits d’eau froide qualitatifs en surgelé. Nous ne sommes pas des fournisseurs de « blocs ».
Sur le marché français qui s’intéresse davantage au frais, les beaux chiffres attendus portent surtout sur le homard. Le Canada va gagner en compétitivité par rapport à l’origine USA, qui fournit deux tiers du homard vivant en Europe, avec des droits de douane identiques à ceux d'aujourd'hui pour le Canada. Or, nous allons bientôt arriver sans taxes aux frontières européennes avec le même crustacé. Les deux pays étaient en même temps en négociation, mais le Tafta n’a pas abouti. À présent, les exportateurs des États-Unis commencent à crier à l’injustice. Cela dit, ils restent avantagés par la logistique. Boston est une place forte d’expédition qu’utilisent les Canadiens. Nous devrions aussi améliorer notre position à l’intérieur de l’offre nord-américaine.
4- Le consommateur va-t-il en profiter ?
Y. D. : Le consommateur ne sait pas comment les prix se forment. Il n’a pas de notion psychologique du prix des produits de la mer. Il est probable que les Canadiens vont augmenter un peu leurs prix, pour s’ajuster de manière compétitive avec les Nord-Américains. En Europe, les distributeurs auraient aussi la possibilité d’augmenter leur marge. Il n’y aura pas, demain, 8 ou 10 % de baisse sur l’étal et dans les rayons. L’accord vise à favoriser le commerce et à redonner une position compétitive. À terme, toute la chaîne en profitera, l’exportateur canadien comme le circuit de distribution et les consommateurs français.
5- L’accord pose-t-il des problèmes techniques aux opérateurs canadiens ?
Y. D. : Des exigences d’origine existent, avec lesquels les opérateurs devront jouer. Les Canadiens sont des transformateurs et donc des importateurs de homards américains à certaines périodes. Il faudra donc séparer clairement les productions. Car dans les règles d’origine, les produits éligibles sont les produits canadiens, autrement dit pêchés dans les eaux canadiennes par des bateaux canadiens. Cela concerne la majorité des produits. Mais les opérateurs de homards peuvent se fournir sur la côte est des États-Unis pendant une certaine période de l’année. Et des bateaux canadiens peuvent parfois débarquer au États-Unis et inversement. Pour assurer cette certification d’origine canadienne, un chapitre du traité porte sur la surveillance et les enquêtes douanières possibles en cas de suspicion. De plus, il existe des certificats de capture et nous n’aurons jamais de problèmes.
Enfin, l’accord induit une certaine flexibilité pour utiliser des matières premières non canadiennes, en quantité limitée. Cela s’appelle des quotas d’origines alternatifs. Ils atteignent 2 000 tonnes pour le homard sur les 150 000 tonnes de production totale réparties à parts égales entre USA et Canada ! Sur le saumon, par exemple, le quota d’origine alternatif est de 3 000 tonnes.
|
Nathanael Richard,
« Nous travaillons depuis 40 ans le homard, uniquement en surgelé et transformé, à 95 % pour l’export : États-Unis, Europe et Asie (Chine, Japon, Corée). Le Ceta devrait entrer en vigueur au printemps et l’Europe, avec son marché de 500 millions de consommateurs, où l’on apprécie les produits de la mer, nous intéresse plus que jamais. Baisser les droits de douane sur des produits perçus comme chers devrait permettre de les rendre plus abordables. C’est gagnant-gagnant. Nous nous préparons depuis deux ou trois ans en étant actifs en Europe (salons, missions commerciales…). Mais aussi en investissant de façon importante dans nos outils (haute pression, automatisation, froid…) pour diversifier notre offre. Des produits décortiqués, la chair de homard ou d’autres, à plus haute valeur ajoutée, devraient trouver des débouchés, en partie dans la grande distribution et grâce aussi au label MSC. À Boston, nous nous sommes rendu compte que les transformateurs du Maine commencent à s’inquiéter de l’attractivité nouvelle dont va profiter le Canada. »
|
||
6- En retour, des opportunités s’ouvriront-elles pour les produits de la mer européens sur le marché canadien ?
Y. D. : Toutes filières agroalimentaires confondues dans les échanges bilatéraux, la France exporte trois fois plus que le Canada, soit presque 1 milliard d’euros pour elle contre 400 millions de dollars pour nous. Ce déséquilibre tient en grande partie sur les vins et spiritueux, les fromages, les produits élaborés… Au Canada, on apprécie les produits importés. Alors que la France, comme l’Italie, est l’un des pays au monde où l’on pense que les meilleurs produits sont ceux du pays, c’est un état d’esprit ! Beaucoup de produits français arrivent au Canada et il peut y en avoir plus. Une grande partie des Canadiens vivent loin de la mer. Ils sont naturellement portés vers la viande, jugée meilleure et moins chère, vers les céréales ou les produits d’eau douce comme la truite, le brochet ou le sandre. Comme l’offre canadienne en produits de la mer est déjà importante, je n’entrevois pas beaucoup de demandes supplémentaires à venir. Sauf sur des produits alimentaires élaborés.
7- Les détracteurs du Ceta craignent que le traité remette en cause les normes de qualité des produits. Est-ce fondé ?
Y. D. : L’accord ne change rien aux normes de qualité ni aux normes sanitaires. Strictement rien ! Ce sont les normes européennes qui s’appliquent aux produits exportés par le Canada. Les exigences sanitaires canadiennes sont aussi hautes et, ces dernières années, il n’y a pas eu de crise sanitaire en produits de la mer. Les produits animaux les plus périssables, en particulier les produits aquatiques, sont sous contrôles sanitaires dans bon nombre de pays et sujets à inspections par les autorités des pays importateurs. Concernant nos deux produits emblématiques, la saint-jacques est surgelée en mer dans les 6 à 12 heures et la pêche au homard fait l’objet de marées courtes. Quelles meilleures garanties ?
Propos recueillis
par Dominique GUILLOT - Photos Thierry Nectoux
|
Libre-échange progressif Après l’entrée en vigueur du Ceta, le Canada sera le seul pays du G7 à profiter d’un accès préférentiel garanti aux deux plus importantes économies du monde : États-Unis et Europe. |