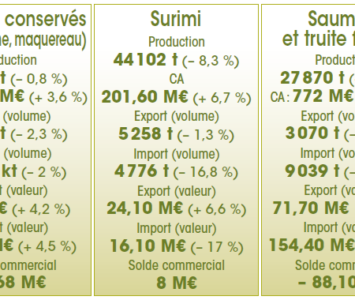Le 23 janvier dernier, les étudiants du pôle halieutique de l’Institut Agro de Rennes ont organisé un débat sur les productions high-tech et low-tech au service d’une production durable. Entre nouvelles technologies et nécessité de préserver l’environnement, la frontière est souvent poreuse.
« Utiliser du low-tech pour limiter notre impact et rendre accessible les technologies, c’est un enjeu de notre temps », affirme en préambule Pierrick Haffray, responsable technique au Sysaaf. Les étudiants définissent le low-tech par une technologie accessible techniquement et financièrement, facile à fabriquer par tous, à utiliser, à réparer et à réutiliser. Par opposition, le high-tech désigne des technologies de pointe difficilement reproductibles par tous et nécessitant un investissement important. « Le low-tech est également une démarche philosophique d’exploitation d’un outil », détaille Tangi Le Bot, du projet Skravik qui arme des bateaux de pêche à la voile. Julien Simon, ingénieur des pêches à l’Ifremer et en charge entre autres du projet Game of Trawls (qui vise à améliorer la sélectivité du chalut grâce à l’IA), nuance en expliquant que « ces deux catégories ne s’opposent pas forcément au regard de l’objectif de durabilité ».
Pierrick Haffray rappelle les progrès techniques en aquaculture qui permettent d’en améliorer les performances : sélection génétique, vaccination, amélioration des aliments… Des évolutions difficilement accessibles dans les pays du Sud où travaille Delphine Lethimonnier, de l’ONG APDRA pour une pisciculture paysanne : « La limite en Afrique, c’est le coût de production et la capacité du marché à absorber ce prix. Le prix de vente du poisson en Afrique de l’Ouest est autour de 2 euros/kg. Implanter des usines d’aliments en Afrique ferait augmenter ce prix. » Le low-tech devient ici une nécessité économique mais aussi de sécurité alimentaire. Laëtitia Bisiaux, chargée de mission chez Bloom, rappelle que « la technologie a poussé l’exploitation toujours plus loin. Mais elle est aussi utile pour le contrôle des pêches. Cependant, elle ne doit pas servir à améliorer le chalut et la propulsion, la transition doit se faire sur les techniques de pêche ».
Le low-tech présente des limites, comme l’expose Tangi Le Bot : « Le principal défi pour la pêche à la voile, c’est de sortir de la bande côtière qui est saturée et d’aller sur des techniques de pêche qui permettent d’avoir du volume pour le marché. » Ces technologies douces peuvent aussi présenter des atouts. « Les caseyeurs de langoustines sont plus rentables que le chalut pour moins d’impact, expose Julien Simon. Mais la vraie question pour faire émerger ces technologies, c’est le partage de l’espace et des quotas. Pour ma part, je souhaiterais faire de l’high-tech au service du low-tech, notamment sur les données. »
Vincent SCHUMENG