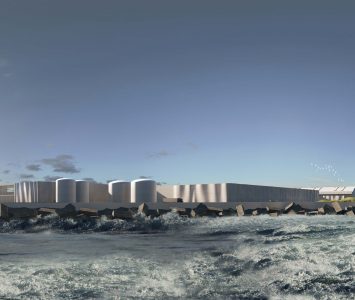À l’occasion de leurs Assises, les directeurs des halles à marée ont lancé le débat autour de l’achat confiance. Alors que les ventes sur Internet se développent dans les criées françaises et que les mareyeurs tentent de nouer des liens directs avec les pêcheurs, il est essentiel pour Christophe Hamel, représentant des criées, et Peter Samson, représentant du mareyage, de renforcer la confiance à l’achat.
|
Sommaire : 1-PdM : Pourquoi avoir mis la question de l’achat confiance 3- Peut-on quantifier les volumes sur lesquels il y a un problème ? |
 |
|
Christophe Hamel, « Le poste le plus stratégique dans une criée est celui de l’opérateur de saisie. » |
1-PdM : Pourquoi avoir mis la question de l’achat confiance sur la table ?
Christophe Hamel : Les modes de vente en criées ont beaucoup évolué. Désormais, la vente à distance représente en moyenne 60 % des achats sous criées. Le chiffre est d’importance même s’il cache des disparités importantes selon les ports. Certains étant à 100 %, les autres à 20 %, notamment en Méditerranée et sur la façade Atlantique. On aurait pu croire que le décret de 2013 sur l’ouverture des criées à un nombre plus important d’acheteurs a participé à cet essor. Mais souvent les poissonniers, notamment les ambulants, préfèrent venir sous criée, voir le produit et le récupérer très vite. À Concarneau par exemple, où les poissonniers sont nombreux, les achats à distance tombent à 47 %. Les restaurateurs ou les poissonniers installés dans d’autres régions achètent à distance, mais les volumes en jeu sont faibles. En Cornouaille, les achats à distance réalisés hors Bretagne ne dépassent pas les 5 % en volumes comme en valeur.
Peter Samson : Les mareyeurs locaux achètent de plus en plus à distance, depuis leur bureau. Cela leur permet de faire des gains de personnel, de vérifier en simultané les cours des différentes criées pour savoir comment se placer.
C.H. : Sur les trois dernières années, la tendance est nette. Cela évite aux mareyeurs locaux d’avoir un acheteur dans chaque criée. Et si les criées sont proches, la ramasse peut s’organiser facilement.
Mais les achats à distance ne se développent que si les criées disposent d’apports réguliers ou de produits typés, comme des poissons de ligne. Ensuite, il faut aussi que l’acheteur à distance, aveugle par nature, puisse acheter les yeux fermés, en confiance. Une confiance que nous devons renforcer, construire.
P.S. : Pour acheter en confiance, il faut que le mareyeur puisse se fier aux informations envoyées par les criées pour répondre aux différentes demandes de ses clients, en termes de volumes comme de prix. La variété des profils clients, GMS, grossistes, poissonniers, export fait qu’il y a de la place tant pour les qualités E, que A ou B, selon que le produit est destiné à être fileté ou à être mis en avant sur un étal haut de gamme. Mais le mareyeur doit savoir en amont comment le lot a été identifié et surtout que l’identification soit bien faite, pour éviter de retrier le produit une fois acquis.
2- Si la criée trie et qualifie parfaitement le produit, n’y a-t-il pas un risque pour les mareyeurs, longtemps vu comme les « yeux des poissonniers », de se faire court-circuiter ?
P.S. : Le décret sur l’ouverture des halles à de nouveaux acheteurs en 2013, nous a fait craindre, au sein de l’UMF, que nos clients y trouvent le moyen de réduire les intermédiaires. Aujourd’hui, la tendance est au développement des circuits courts, à celui de la vente directe, du gré à gré. Cela doit aussi nourrir les inquiétudes des halles à marée. Désormais, chaque maillon se doit de justifier sa place dans la filière en étudiant les services qu’il doit offrir.
Aux yeux du mareyage, la place des criées est de rester un marché de gros ou de semi gros. Les mareyeurs achètent, bon an mal an, 140 000 tonnes de produits de la mer sous les criées, ils sont à l’origine de 65 % de leur chiffre d’affaires. Le mareyage s’impose donc comme un passage obligé de la marchandise. Sa valeur ajoutée : il connaît les bateaux, les criées, les techniques de pêche. L’information mise à disposition aujourd’hui ne permet pas toujours, pour quelqu’un de non averti, de réaliser un achat optimum.
C.H. : Il est vrai qu’aujourd’hui, les acheteurs n’achètent pas un lot sur les seules informations ECPF (espèce, calibre, présentation, fraîcheur). Ils se renseignent sur le nom du bateau, tentent d’en savoir plus. Les criées ont beaucoup investi dans des outils pour garantir et préserver la fraîcheur des produits – machines à glace, chambres froides etc. Elles ont innové dans l’organisation de la transparence des marchés. Toutefois, un manque d’homogénéité existe d’une criée à l’autre, notamment dans l’identification des lots selon les critères ECPF. Beaucoup de criées compensent en ajoutant des commentaires sur les catalogues ou les écrans de ventes pour aider les acheteurs à distance, mais des progrès peuvent être faits pour « normaliser » les indications données. Il faudrait que tout le monde puisse avoir la même définition de « la beauté » d’un poisson, d’un poisson « rougi ou gratté »
Normandie Fraîcheur Mer suggérait de créer un référentiel, une base de données des termes utilisés. Ce serait un premier pas pour renforcer les conditions d’un achat confiance. FranceAgriMer récupère aujourd’hui toutes les informations liées aux transactions faites sous criées, par lot, et exploite les éléments obligatoires de la traçabilité mais pas les commentaires. C’est un chantier à ouvrir !
P.S. : Il ne faut pas négliger les freins à l’harmonisation. Selon les ports, les pêcheries sont différentes. Dans un port de côtiers, on va vouloir faire ressortir la qualité extra. Dans un port d’armement hauturier, ce qui fait vivre un port c’est le A. Ces différences d’apports sont pour moi un frein à l’homogénéisation du tri d’une criée à l’autre.
C.H. : C’est un problème qu’évoquait Mer Conseils lors de nos Assises. Nous avons trop tendance à associer la pêche côtière à du E et la pêche hauturière à du A. C’est caricatural. Ce qui devrait compter c’est la fraîcheur et l’état du poisson, pas la technique de pêche ou la façon de travailler d’un pêcheur. Parce qu’il est vrai qu’entre des lots classifiés A, il existe des différences qui ne valorisent pas au mieux le travail de certains pêcheurs.
P.S. : Une partie du classé A pourrait être mieux valorisée ! Et si l’inverse - qu’un E soit déclassé - peut-être vrai, le gain pour le pêcheur sera plus important que les pertes au global. Il suffit de regarder la typologie des volumes débarqués, le A représente 85 à 90 % des volumes.
Le tri fait partie des missions du mareyage, ne serait-ce que pour répondre aux exigences de leurs clients. Mais si la part du tri liée à la vérification de la qualification, à son manque d’harmonie et de régularité d’une criée à l’autre, même si les efforts sont réels, l’économie serait conséquente. Le besoin de main-d’œuvre serait allégé et les déqualifications limitées.
3- Peut-on quantifier les volumes sur lesquels il y a un problème ?
C.H. : C’est difficile. Le taux de réclamation, de 3 %, ne prend pas tout en compte.
P.S. : Le problème c’est que d’une criée à l’autre le système de réclamation diffère. Il est même parfois inexistant pour les acheteurs à distance. S’il est payant, les mareyeurs hésitent à l’utiliser. Ils ne sont pas sûrs d’avoir gain de cause et dans le cadre d’un travail en flux tendus, ils préféreront déqualifier un produit et le vendre moins cher. Mais parfois, cela ne passe pas et le client refuse le produit.
C.H. : Je suis conscient qu’il faudrait que le service existe et soit gratuit. Mais l’histoire nous a montré que certains acheteurs abusent des réclamations. Or, le temps de traitement des demandes est important : l’idéal est d’aller voir sur place, de négocier, la notion de fraîcheur du poisson peut-être subjective. Avec l’achat à distance, cela devient encore plus complexe puisque la question logistique entre en jeu. Que se passe t-il dans le transport ?
Certaines criées ont décidé d’utiliser la photo pour faire des constats, ce qui semble fonctionner. C’est une piste à explorer et j’y suis très ouvert.
P.S. : Cela apparaît comme du bon sens d’utiliser la photo. Autoriser les réclamations serait un pas colossal dans l’achat confiance. Précisons toutefois, qu’il existe deux types de réclamations : celles concernant le grade qualité et celles où le problème concerne la présence de produits sous taille ou de crustacés morts. Là, il faut que les choses bougent vite.
C.H. : Vous savez, dès que l’on peut tenter de voir où est le problème, et si la personne n’abuse pas, on tente de trouver une solution.
 |
|
Peter Samson « Les acheteurs achètent |
4- Pour limiter les déceptions et les risques de réclamation, quelles seraient les informations complémentaires désirées par les mareyeurs ?
P.S. : Savoir si un poisson est blessé ou gratté est important. Certes, cela peut tirer les prix vers le bas. Mais, des informations comme le nombre de pièces par lots, tireraient les cours à la hausse.
C.H. : C’est compliqué pour des espèces à gros volumes.
P.S. : Nous aimerions aussi savoir, si les poissons sont touchés par le parasitisme. Une criée le fait et c’est intéressant, notamment lorsqu’on travaille à l’export. C’est là que cela pose le plus de problème.
C.H. : Le parasitisme est un vrai sujet. France Filière Pêche s’en est emparée pour savoir comment accompagner les professionnels sur le sujet, notamment en termes de communication. Les parasites ne sont pas dangereux pour l’homme si le poisson est congelé 24 heures ou s’il est cuit à 60 °C. Il faut l’expliquer. Afficher qu’un lot est parasité peut changer l’acte d’achat. Ensuite, très concrètement, donner cette information sur des petits lots, après contrôle visuel, est possible. Mais, sur des pêches de gros volumes, c’est compliqué aussi. On peut peut-être faire de l’échantillonnage. Sincèrement, j’attends les conclusions du groupe de travail FFP. Le sujet touche toute la filière et chaque maillon a des moyens d’agir pour limiter les incidences du problème.
P.S. : La découpe, le parage sont ceux du mareyage.
C.H. : D’une manière générale, je crois qu’aujourd’hui le poste le plus stratégique dans une criée est celui de l’opérateur de saisie, celui qui enregistre les lots. Dans un temps record, il doit le qualifier correctement. Sur des lots de 40 kg, ce n’est pas si aisé. En relation avec les producteurs, les criées ont amélioré la prévision des apports. Aujourd’hui, c’est en fournissant des informations sur les lots, au-delà de ce qu’exige la réglementation, que l’on améliorera l’achat confiance. Cela se fait sur les écrans de vente, parfois sur les catalogues. Demain, nous allons le faire avec de l’audio. La vidéo, elle, a déjà fait ses premiers pas dans certaines criées côtières qui ont placé des caméras au-dessus des convoyeurs. L’audio est un bon compromis pour les autres, pour fournir, à tous les acheteurs connectés, des informations complémentaires sur les lots, le nombre de pièces en temps réel. Aujourd’hui, certains acheteurs nous appellent, mais on ne leur répond que si on a le temps.
Ensuite, il ne peut pas y avoir d’achat confiance sans transparence des marchés. Elle a beaucoup progressé avec les obligations de traçabilité. Toutes les informations de ventes sont transmises aux services de l’État via le réseau intercriées (RIC). Une base nationale est en cours de construction via le projet Salto pour les enregistrer. Enfin, avec les systèmes Internet mis en place par les criées, les mareyeurs peuvent télécharger en temps réel les informations qui les intéressent, notamment pour préparer leurs étiquettes à l’avance.
P.S. : Mais il y a encore des manques, les attentes sur les prévisions des apports restent fortes. Toutes les criées ne le font pas. Or, si un mareyeur sait que des volumes sur une espèce seront importants sur une criée et pas dans les autres, alors en fonction de la demande de ses clients, il pourra plus facilement mettre le prix à l’achat.
Concernant la traçabilité et le projet Salto, tout le monde est concerné. Chaque maillon se doit de saisir l’information sur ce qu’il achète ou sur ce qu’il vend. L’idée est d’assurer la traçabilité de la pêche à l’assiette et de favoriser les contrôles. Le projet a pris du retard. Mais, ce qui pose problème aux mareyeurs, c’est de devoir ressaisir manuellement les informations de traçabilité fournies par les criées. Avec l’Abapp (association bretonne des acheteurs de produits de la pêche), nous avons recensé 15 informations à saisir à chaque fois. Il faudrait vraiment que les fichiers soient facilement compilables et livrés dans les mêmes temps.
C.H. : Nous sommes en ordre de marche pour le faire : les fichiers sont normalisés, selon le cahier des charges de la DPMA. Reste la question des horaires de livraison de l’information et des choix des éditeurs logiciels. Ces derniers dépendent des impératifs économiques des gestionnaires de criées. Lorsqu'ils sont différents la reprise des informations sans ajustement ou ressaisie est délicate.
De la même façon, un des freins à l’harmonisation des critères de tri est lié aux choix des actionnaires des criées d’internaliser ou d’externaliser le tri. Les prestataires extérieurs doivent devenir un maillon reconnu de la filière, avec les mêmes obligations. De toute façon, les halles à marée sont responsables de ce qu’elles mettent à la vente.
Au niveau de la Bretagne, la Région finance un audit des criées sur la question du tri, pour vérifier que les lots sont qualifiés de façon homogène. Les travaux de la Normandie sur les règles de qualification doivent nous inspirer et nous permettre de valoriser au mieux les captures.
P.S. : La création de marques et de labels, tels Pavillon France, Normandie Fraîcheur Mer, merlu de ligne ou Filière Opale, offre des opportunités pour avancer. L’existence de cahiers des charges derrière les marques oblige les opérateurs à être plus attentifs aux critères ECPF. Les acheteurs achètent les poissons qui portent des pin’s les yeux fermés. Il s’agit de produits de niche, mais cela pourrait être élargi. Pourquoi pas aux produits écolabellisés ?
5- Un écolabel ne garantit pas la qualité d’un produit !
P.S. : L’achat confiance ne concerne pas que la question de la qualité. Avoir confiance dans un produit lui permettra de mieux se vendre. Les écolabels le peuvent.
C.H. : Les halles à marée se sont inscrites dans une démarche responsable, en offrant un cadre sécurisé aux transactions, tant sur le plan sanitaire qu’en matière de traçabilité. Nous sommes régulièrement audités sur ce point et nous allons plus loin en signant, par exemple, avec des organisations de producteurs des conventions afin de les aider dans leurs démarches de pêche responsable, en saisissant pour leur compte, des lots hors taille ou hors quotas etc.
Nous nous sommes mobilisés pour les réunions concernant l’écolabel français. Mais au final, il n’est pas obligatoire de passer sous criée pour l’obtenir. On se sent lésé, nous souhaiterions être intégrés dans les cahiers des charges des marques. À tel point que nous réfléchissons à créer un label « poisson vendu sous une halle à marée française ». Il faudra peut-être du temps pour pouvoir le faire sur de gros volumes mais cela fait sens.
Pas sur les étals. Les étiquettes en direct de la criée existent déjà. La nuance est trop subtile.
P.S. : En B to B, cela aurait le mérite de faire reconnaître le rôle de chacun dans la filière et les services qu’ils peuvent amener. Car si, avec cette marque, les criées assurent la partie qualification qui incombe aux mareyeurs, comme c’est le cas pour Pavillon France, alors ces derniers pourront se concentrer sur l’ouverture de nouveaux marchés. Vendre n’est pas si simple. La qualification des lots est un service intéressant. Cela fonctionne d’ailleurs en Normandie avec le double pin’s NFM et Pavillon France.
C.H. : Cette démarche est bonne. J’ai conscience qu’en matière de services, les criées doivent faire attention à ne pas empiéter sur le domaine de compétences des mareyeurs. L’équilibre est parfois difficile à trouver mais assurer le travail d’identification des lots et de leur qualification, fait partie de nos missions.
D’ailleurs, nous ne cessons d’investir sur les hommes et la formation. La construction de l’achat confiance passe par là. Les formations ECPF ont toujours été bénéfiques et entraîné des baisses de réclamations.
P.S. : D’une région à l’autre, les référentiels de formations sont-ils les mêmes ? À défaut d’avoir les mêmes formateurs cela pourrait favoriser l’harmonisation du tri, non ?
C.H. : Comme pour les systèmes d’information, c’est compliqué de disposer du même. Mais l’essentiel, je crois, est d’avancer et de s’engager dans des démarches d’amélioration continue. Les gros acheteurs, engagés dans des démarches qualité et de progrès, nous questionnent sur notre démarche qualité. Pas facile de répondre quand nous ne disposons pas des moyens pour salarier un responsable qualité.
Au niveau de la région Bretagne, nous allons tenter de mutualiser le poste. D’autres criées le font peut-être déjà.
La formation est importante : les métiers sont durs. Les candidats au tri sont de plus en plus rares alors même que le tri ne pourra jamais être 100 % automatisé sur des sites pluri-espèces.
P.S. : Les bras manquent aussi dans le mareyage. La formation est un levier pour attirer du monde. Le salaire, déjà au-dessus du SMIC, ne peut être un levier pour les mareyeurs : les charges de personnel représentent déjà 75 % des coûts de revient.
Propos recueillis par Céline ASTRUC – Photos Lionel FLAGEUL
|
La prévision de la demande en question La prévision des apports jusqu’à trois ou quatre jours en avance est vue comme un moyen de mieux valoriser les captures, en favorisant une meilleure adéquation de l’offre et la demande. Mais est-il possible d’anticiper la demande ? « Oui, au moins avec les promotions », indique Christophe Hamel qui regrette que ce ne soit pas toujours le cas. « Complexe, tant d’un point de vue technique, répond Peter Samson, que parce que la confidentialité des opérations importe aux mareyeurs. » Et si la criée additionnait de façon anonyme les anticipations de demandes pour les transmettre aux OP ? Un point à travailler, répondent les deux acteurs. Mais qui ne fonctionnera qu’avec une bonne cohésion de filière, souligne Christophe Hamel. |