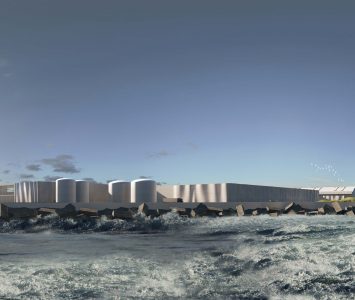Si les pêcheurs français ont très vite communiqué sur leurs inquiétudes à propos du Brexit, l’aval de la filière est resté plus discret. Pour autant, ces acteurs peuvent être fragilisés par les changements à venir. Anticiper et interpeller les institutionnels impliqués dans les négociations s’impose, comme en témoigne une étude commandée par l’Union du mareyage français, avec le soutien de France Filière Pêche.
|
Benoît Vidal-Giraud, « Même si tout le monde n’en est pas encore convaincu, il n’y aura pas
|
 |
Suite au référendum sur son appartenance à l’Union européenne du 23 juin 2016, le Royaume-Uni a entamé sa procédure de retrait le 29 mars 2017. Depuis, de nombreuses questions se posent, sans que des réponses ne se dessinent. « Seule certitude, résume Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français, il n’y en a aucune ! L’exercice actuel consiste à sortir un œuf d’une omelette. »
Dans ce contexte, mieux vaut s’attendre au pire et se préparer à un Brexit dur, conseillent à l’aval de la filière les responsables professionnels. Lors d’un séminaire organisé à Boulogne-sur-Mer le 5 juin par la Mission Capécure 2020, l’Union du mareyage français (UMF) a dévoilé une étude particulièrement intéressante. Elle analyse les différents impacts du Brexit sur la circulation internationale des produits, sur l’accès aux produits de la mer ou sur les coûts de production des deux piliers du mareyage que sont l’achat, en criée ou à l’import, et la création de valeur ajoutée. « Durant quatre mois, explique l’ingénieur agronome Benoît Vidal-Giraud, du bureau d’études Via Aqua, nous avons rencontré plusieurs dizaines de mareyeurs français pour analyser leurs achats et leurs marchés, en lien avec le mareyage boulonnais et les associations des acheteurs des produits de la pêche de Centre Atlantique (Acaapp) et de Bretagne (Abapp). »
Selon les façades maritimes, l’accès aux eaux britanniques des pêcheurs français n’aura bien sûr pas le même impact pour les acheteurs en criée. Les professionnels des Hauts-de-France et de Bretagne-Normandie sont plus dépendants que ceux de l’Atlantique ou de la Méditerranée à ces apports : pour les premiers, à hauteur de 33 % et 19 % contre 8 % et 0 % pour les seconds.
|
Des facteurs déstabilisants ❱ droits de douane |
L’impact variera aussi en fonction des espèces travaillées par les mareyeurs. Pour les poissons à fileter, il devrait être important. En 2016, en effet, pour ces espèces, les captures réalisées dans les eaux britanniques ont représenté 60 % des volumes vendus sous les criées de Bretagne et Normandie et 40 % de ceux vendus dans celles des Hauts-de-France. Mais moult céphalopodes, coquillages et crustacés, poissons fins et pélagiques débarqués en France ont aussi été capturés dans les eaux britanniques.
La dépendance des mareyeurs français au Royaume-Uni concernant leurs approvisionnements s’accroît aussi avec les achats réalisés directement à l’étranger. C’est particulièrement vrai sur le maquereau frais, le tourteau et la langoustine non congelés, le poisson blanc frais à découper (cabillaud, lieu noir, lingue), les pectinidés et la baudroie. In fine, l’étude souligne la fragilité, face à un Brexit dur, « des entreprises spécialisées sur les poissons à fileter qui seront les plus exposées ». Elle ajoute que le risque s’accroît « pour les PME de taille modeste. Car il leur sera plus difficile de dénicher de nouveaux sourcings ».
En influençant les stratégies des entreprises à chaque échelon de la filière, le Brexit pourrait aussi avoir un impact majeur sur leur pilier « valeur ajoutée ». Pour analyser l’effet des facteurs déstabilisants, les auteurs de l’étude ont retenu l’hypothèse que les volumes amont (captures totales) et aval (consommation finale) ne varieraient pas. Cinq facteurs ont été identifiés comme pouvant remettre en question l’équilibre dans lequel le mareyage s’inscrit, avec des impacts négatifs mais parfois positifs.
À moyen terme, l’étude met ainsi en évidence que la réduction de l’accès aux eaux britanniques se traduirait par le rapatriement de tout ou partie des volumes au Royaume-Uni. De quoi faire perdre aux mareyeurs et transformateurs du littoral français leur avantage compétitif de proximité au profit de leurs concurrents britanniques. De même, l’étude évoque la question de la fin de la libre circulation des capitaux. Si cela arrive, il deviendrait alors impossible pour le mareyage français de nouer des partenariats amont/aval ou interentreprises en Grande-Bretagne. Le retour des taux de change, quant à lui, renforcerait, dans les scénarios évoqués, l’attractivité des entreprises britanniques à l’export. D’autant que, comme le redoute Brigitte Delanchy, présidente de la société de transport éponyme, habituée à travailler en euros, « la facturation en livres amènerait une charge administrative supplémentaire ». Prestataire de services lui aussi, Xavier Bateman, président de Conegan (conditionnement de surgelés), se demande où ses donneurs d’ordre internationaux, aujourd’hui basés en Angleterre, iront s’installer. « Si c’est à Amsterdam, la marchandise passera par les ports belges », craint-il.
|
Les conséquences vues par
Sylvain Pruvost, président de la filière mer du groupement Les Mousquetaires. « Premier armateur français à la pêche, nous pêchons dans les eaux britanniques. Nous acheminons notre production en France, à Lorient et à Boulogne-sur-Mer, pour la transformer et alimenter nos 1 800 points de vente. 70 % du poisson pêché par les trois chalutiers senneurs de Scopale le sont dans les eaux britanniques. |
Par contre, si le différentiel de taxes entre produits bruts et transformés se maintenait, les droits de douane avantageraient les activités créatrices de valeur ajoutée de l’Hexagone. Autre impact qui pourrait s’avérer positif : la perte de la libre circulation des travailleurs au Royaume-Uni. Elle devrait entraîner un renchérissement du coût de la main-d’œuvre pour l’industrie de transformation des produits de la mer outre-Manche, rendant potentiellement les entreprises françaises plus compétitives.
Mais quel que soit le scénario final retenu, quelques grands équilibres de la filière risquent d’être déstabilisés. L’étude commanditée par l’UMF a donc choisi de recenser des solutions envisageables pour quatre risques perçus comme majeurs.
Premier d’entre eux : la perte de volumes à l’achat. Pour la compenser, sans doute faudra-t-il renforcer les cellules commerciales des halles à marée françaises, à l’image de celles déjà imaginées à Lorient et Boulogne. Le regroupement de certaines criées doit aussi être envisagé pour élargir les gammes proposées aux acheteurs et augmenter l’attractivité de la première vente nationale en diminuant les coûts d’import.
Ensuite, pour amenuiser les nouvelles contraintes de l’importation, il conviendrait de mettre en place des couloirs sous douanes pour les bases avancées françaises dans les îles britanniques, comme celles des armements Scapêche et Euronor en Écosse, mais aussi de protéger les circuits en provenance des îles Féroé et de l’Islande. « Concrètement, comment seront considérés les produits originaires d’Islande, membre de l’espace Schengen, qui transitent par le port anglais de Grimsby ? », s’interroge le secrétaire général du mareyage boulonnais Aymeric Chrzan.
Enfin, pour limiter les risques liés à la hausse des coûts et des prix ainsi que les risques de perte de maîtrise de la valeur ajoutée, la solution mise en avant passe par l’innovation produit. Individuelle ou collective, elle doit être encouragée et favorisée par la puissance publique. « Il faut renforcer l’attractivité de la première vente française et la promotion origine France », conseille aussi Peter Samson, délégué de l’UMF. Mais au-delà, l’étude rappelle aux professionnels la nécessité de réfléchir à des investissements dans des partenariats à la source, dans des assurances pour se prémunir des effets de change, ou dans un réseau de première mise en marché afin de diminuer les coûts de transport.
Comme son étude a révélé une certaine méconnaissance des enjeux liés au Brexit pour un grand nombre d’entrepreneurs de la filière aval, l’UMF les invite à se renseigner dès à présent sur leur situation particulière et à anticiper les changements qui ne manqueront pas de subvenir, que ceux-ci soient négatifs ou porteurs d’opportunités.
Les autres recommandations des auteurs de l’enquête s’adressent davantage aux institutionnels. Ainsi, l’UMF espère qu’ils soutiendront, dans les négociations, le maintien de la libre circulation des capitaux avec le Royaume-Uni. La minoration des droits de douane à l’import en provenance de Grande-Bretagne est espérée, notamment pour les produits bruts. Pour l’UMF, il importe qu’un différentiel de taxation existe entre produits bruts et produits transformés. Plus crucial encore, les représentants de l’aval plaident pour la mise en place de mécanismes innovants de fluidification et d’accélération des opérations de dédouanement. Ils attendent et espèrent aussi des contrôles européens harmonisés pour lutter contre les points d’entrée « passoires », afin d’éviter une compétition au moins-disant.
Enfin, l’UMF espère que l’Europe obligera le Royaume-Uni à suivre et respecter les règles communes de commercialisation, celles relatives à la traçabilité et les normes sanitaires du « paquet hygiène ».
Voilà pour les grandes lignes. Mais les représentants des structures de l’aval de la filière invitent leurs membres à s’organiser, à faire remonter leurs craintes précises. Tout pourra alors être déposé auprès du négociateur en chef nommé par l’Union européenne, Michel Barnier. Le niveau où la France veut agir. Elle ne souhaite pas entamer de discussions bilatérales. D’ailleurs, d’autres pays de l’Union – Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Irlande… – sont tout autant impactés par ce divorce. Et, si « la France s’est mise en marche très vite car la filière représente un secteur structurant pour ses territoires maritimes », confirme Éric Banel, conseiller au secrétariat général à la Mer, il ajoute : « Nous n’avons pas intérêt à un accord séparé : nous ne sommes pas en position de force. »
Cela n’exclut pas de faire pression. Déjà, Aymeric Chrzan réclame, pour le mareyage des Hauts-de-France, la création d’une cellule opérationnelle de veille et de lobbying. « Une task-force se met en place, y compris avec des Bretons », confirme Jean-Noël Calon, animateur de la Mission Capécure 2020. Benoît Vidal-Giraud ne peut que soutenir cette initiative car, « même si tout le monde n’en est pas encore convaincu, il n’y aura certainement pas de statu quo ». Alors, mieux vaut prévoir le pire en espérant le meilleur…
Benoît LOBEZ
|
Les conséquences vues par Brigitte Delanchy, Pdg du groupe de transport Delanchy.
« Dans un camion, je peux avoir de la marchandise pour 80 destinataires, avec une moyenne de quatre lots différents par client. Cela pourrait m’exposer à 320 contrôles, soit 6 400 contrôles par jour pour un flux de 20 camions. Mes véhicules en provenance d’Angleterre arrivent à Boulogne vers 8 heures. Les premiers, après dégroupage, repartent à 11 heures. Le flux tendu est notre business. Et la fraîcheur, une obligation. » » |
|
❱ Les autorités concernées Dans le Pas-de-Calais, futur département frontière entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, les douanes et la direction de la protection des populations (ex-services vétérinaires, concurrence, consommation et répression des fraudes) s’accordent pour accompagner les entreprises dès aujourd’hui et ne pas devenir un frein à leurs échanges. Désormais, les contrôles d’import pourront se faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour éviter les pertes de temps. Le recrutement de plusieurs centaines d’agents est déjà en cours. ❱ où en sont les négociations ? Deux ans après le référendum, la situation demeure peu lisible en attendant la sortie du Royaume-Uni en mars 2019. Les 27 ont convenu, en janvier 2018, d’ouvrir une période de transition dite « statu quo » qui pourrait courir jusqu’à fin 2020. Un temps où la circulation des biens, services et personnes serait maintenue, mais pendant lequel Londres n’aurait plus son mot à dire sur les décisions de l’UE. Le Royaume-Uni souhaite quitter l’union douanière pour négocier ses propres accords commerciaux, mais l’UE veut que cet accord respecte l’indivisibilité de son marché unique. En l’absence d’accord, le Royaume-Uni se verrait appliquer les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui régissent les barrières douanières et tarifaires. |