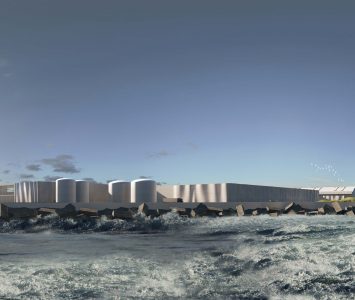Depuis trois ans, l’engin et les zones et sous-zones de pêche devraient figurer sur les étiquettes des produits aquatiques. Exigeante en termes de traçabilité, la réglementation n’est toujours pas parfaitement mise en œuvre, comme le révèle une étude de FranceAgriMer, conduite par Odyssée Développement et Mer Conseils. La volonté de bien faire des professionnels n’est pas en jeu. Certains y voient même un outil pédagogique.
 |
 |
 |
 |
|
Charlotte Abadie, Directrice générale |
Isabelle Maurer Responsable qualité |
Franck Riché Poissonnier en GMS |
Leslie Widmann Directrice d’Odyssée Développement, société d’études coauteur de l’analyse avec Mer Conseils |
1- PdM : Pourquoi une étude sur la mise en œuvre de la réglementation européenne de l’étiquetage des produits aquatiques ? N’est-elle pas bien appliquée ?
Leslie Widmann : Avec cette enquête sur l’application du règlement OCM-UE N° 1379/2013, FranceAgriMer souhaitait identifier les freins à sa mise en œuvre, repérer les bonnes pratiques, en chiffrer le coût pour les différents maillons de la filière et estimer les bénéfices pour le consommateur. Par rapport à la mise en place, un mot résume la situation : hétérogénéité. Le règlement visait à niveler une situation en donnant un cadre commun. Il reste méconnu, mal connu et est parfois jugé inapplicable. Pourtant, chaque maillon fait de son mieux, estimant que le règlement répond à un besoin du consommateur et qu’à défaut d’être parfait, il ouvre des opportunités.
Seule l’Écosse a vraiment refusé d’appliquer la réforme, préférant verser une amende à l’UE. Aux importateurs, alors, de s’adapter pour pêcher les informations dont auront besoin leurs clients français afin de répondre aux exigences de la réglementation.
En théorie, la charge de l’étiquetage revient à chaque maillon de la filière qui facture quelque chose, mais c’est celui qui est le plus proche du consommateur qui subit le plus de contrôles et se trouve dans l’obligation de trouver les informations qui peuvent lui manquer.
Franck Riché : Chef de rayon marée, j’achète en criées 40 % des produits de l’étal. Le ticket acheteur me donne immédiatement les informations sur le produit : nom, qualité, provenance, bateau, quantité, zone et engin de pêche. Ces tickets sont insérés dans les cahiers de traçabilité et consultables lors des contrôles réalisés par les Affaires maritimes. Pour les coquillages et les poissons achetés en direct en centrale, les informations réglementaires figurent sur les emballages et les étiquettes sanitaires. Je m’y fie.
Isabelle Maurer : Le fournisseur a tout intérêt à donner les bonnes informations. Chez Mericq, le service qualité a renforcé les contrôles concernant l’étiquetage lors de la réception des achats. Cela permet de demander des corrections à nos fournisseurs en cas de problème. De plus, nous réalisons fréquemment des tests de traçabilité en remontant des filières.
Charlotte Abadie : Nous sommes convaincus, chez Mericq, que la traçabilité est un enjeu primordial. Bien sûr, la réglementation sur le nouvel étiquetage est contraignante, mais nous avons voulu y voir une opportunité – une règle de base de la famille Abadie. Concrètement, c’était l’occasion d’améliorer nos modes de travail et d’organisation. Cela dit, l’investissement dans l’informatique pour automatiser certaines démarches, dans l’humain pour déployer les méthodes de travail dans les différentes cases de marée ou encore dans les équipements pour adapter peseuses et étiqueteuses, fut très lourd.
I. M. : Le gros du travail a surtout porté sur l’ERP, le progiciel de gestion intégré. Le paramétrer pour prendre en compte les nouveaux critères demandés – engins de pêche, zones et sous-zones… – fut d’autant moins aisé qu’il fallait tenir compte des besoins de tous nos sites, qui achètent sous plusieurs criées et importent une partie des volumes. Cela exigeait d’être fin dans la traçabilité.
C. A. : Malheureusement, il est impossible de récupérer automatiquement les données des criées. La ressaisie est obligatoire : non seulement les systèmes informatiques des criées ne sont pas homogènes mais nous avons aussi un problème de délais. L’information n’est pas disponible au moment où les marchandises sont déjà dans le camion.
L. W. : Effectivement, trois systèmes informatiques de vente coexistent dans les criées françaises. L’intégration automatique des données exigerait donc trois types d’interfaces différents. Reste après la question du délai. Officiellement, les données de vente présentes sur la facture ne peuvent pas être transmises avant la clôture de celle-ci. Les criées peuvent avoir besoin de 48 heures pour gérer les retours, les bugs informatiques… C’est trop pour des mareyeurs qui expédient dans la foulée de leurs achats. Ils n’ont pas d’autre choix que de ressaisir les éléments de traçabilité des tickets acheteurs.
|
Le regard ❱ 50 % des étals contrôlés ❱ Pour la Direction interrégionale de la mer nord Atlantique - Manche ouest ou les Affaires maritimes, la mise en œuvre de la réglementation n’est pas encore faite et il lui est difficile d’estimer toute la réalité des contraintes et leur impact économique sur les opérateurs de la filière. Dans ses missions de contrôle, elle fait le constat que les informations, globalement, ne sont pas correctement retransmises tout au long de la chaîne d’approvisionnement, mais que cela dépend des acteurs et de la modernité de leur activité. Source : Étude FranceAgriMer / Odyssée Développement-Mer Conseils – sept. 2017 |
2- Outre la perte de temps, c’est aussi une source d’erreurs, non ? Est-ce un des éléments qui vous a conduit à nouer des partenariats avec les bateaux ?
C. A. : L’objectif de notre transition numérique est d’être le plus réactif possible. Pour y parvenir, il faut limiter les saisies et ressaisies. Clairement, une homogénéisation des systèmes des criées serait souhaitable pour avancer plus vite. En attendant, on s’adapte. Mais nous ne nous sommes pas rapprochés des pêcheurs pour ces raisons-là. Nous l’avons fait pour répondre à des exigences de fraîcheur, de qualité, de disponibilité. Cela dit, gérer la traçabilité est plus simple.
I. M. : Même si des investissements informatiques ont été réalisés pour démarrer la traçabilité au niveau du bateau.
3- Peut-on imaginer que les pêcheurs soient les premiers à saisir les informations et qu’elles se transmettent sans ressaisie ?
L. W. : L’enregistrement des premières données par les bateaux pouvant être reprises automatiquement dans le reste de la chaîne est intéressant. Les navires de plus de 12 mètres disposent de logbooks électroniques. Les marges d’erreur sur les quantités débarquées sont inférieures à 10 kg. Alors si, une fois à terre, le bateau transmettait automatiquement les données de son logbook, le gain de temps serait considérable. Mais aujourd’hui, tout est ressaisi, lot par lot.
Pourquoi ? Parce que le logbook est vu comme un instrument de suivi des pêches et de gestion des quotas. Les organisations de producteurs considèrent alors que les informations enregistrées sont confidentielles.
Cela dit, la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture s’est penchée sur la question des saisies et des ressaisies, en finançant le développement d’un système de traçabilité national des produits de la mer : Salto. Ouvert à tous les volontaires, il permet d’enregistrer les éléments de traçabilité et de les récupérer. Malheureusement, l’enquête montre que le logiciel n’est pas déployé et que très peu d’acteurs en ont entendu parler.
I. M. : Nous avons participé aux groupes de travail sur Salto. Nous ne l’utilisons pas. Nous avions déjà notre propre système et nous n’avons pas eu les bons contacts pour créer une interface permettant une extraction automatique de nos données pour l’alimenter.
4- Côté détaillants, la mise en œuvre de ce nouvel étiquetage a-t-elle été coûteuse et compliquée ?
F. R. : Nous avons surtout dû changer les pique-prix. Le support adéquat trouvé, le reste, c’est-à-dire la modification des informations, fait partie de notre quotidien.
L. W. : Distinguez-vous à l’étal les bars de chalut et de filet, comme vous le faites pour le bar de ligne ?
F. R. : Non. En cas de lot mélangé, je choisis de n’afficher qu’un seul engin de pêche. Je ne vois pas l’intérêt pour un consommateur de voir pour un même poisson les mentions chalut et filet côte à côte. Gérer cela serait d’une folle complexité et prendrait beaucoup de temps, alors que tout est présent dans les cahiers de traçabilité.
L. W. : Beaucoup de poissonniers ont choisi d’afficher les deux techniques de pêche sur une même étiquette. Même si l’information transmise aux consommateurs apparaît un peu aberrante.
I. M. : Les agents des Affaires maritimes le tolèrent pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation au vu du fonctionnement du secteur. Mais la tolérance s’arrête à deux.
L. W. : C’est la même chose pour les sous-zones. Généralement, les poissonniers indiquent la sous-zone majoritaire et ajoute « et autres sous-zones ».
F. R. : Et finalement, le consommateur va se demander d’où vient son poisson ! Cela dit, j’évite au maximum de mélanger les techniques de pêche ou les sous-zones, pour rester au plus près de la vérité. Les contrôles sont fréquents. Quatre en trois mois, par les Affaires maritimes dont le cheval de bataille est l’étiquette. Ils regardent les factures, les bons de livraison, les lieux d’achat, etc.
I. M. : Cette année, nous avons ressenti l’intensification des contrôles, chez nous comme chez nos clients. Et les contrôles portaient effectivement sur l’étiquetage.
L. W. : Y a-t-il eu verbalisation ? Les services de contrôle ont dit qu’ils effectuaient des interventions pédagogiques.
I. M. : S’il y avait eu matière à verbaliser, je crois qu’ils l’auraient fait.
F. R. : Faire une descente à quatre un vendredi matin à 11 heures, alors qu’il y a la queue devant le rayon, je ne trouve pas cela très pédagogique !
5- La coopération existe-t-elle déjà au niveau national ?
A. L. : Oui, le ministère norvégien du commerce a géré la coopération interagence et le travail avec le département des taxes a permis de retracer des navires en situation illégale. Il est vrai que les contrôles en mer sont très coûteux, les investigations financières aussi, mais à un niveau moindre si les services coopèrent. Remonter la filière financière permet de déboucher sur le vrai bénéficiaire dont la condamnation mettra un terme à l’activité.
S. V. : À l’échelon international aussi, il y a l’exemple d’un armement espagnol bien connu qui a été condamné et quasiment démantelé. L’armateur a été condamné aux États-Unis, fiscalement et administrativement, avec la collaboration de l’Espagne et de l’Union européenne.
|
Impliquer les pêcheurs ? Alors que les logbooks électroniques, obligatoires sur les plus de 12 mètres, enregistrent le nom du bateau, l’engin, les temps de pêche et le nombre d’opérations par jour, ainsi que les quantités capturées par espèce et par zone et sous-zone de pêche, ces informations ne sont pas automatiquement transmises aux criées en France. Certes, tous les bateaux n’en sont pas équipés, mais cela pourrait déjà limiter les saisies en criées des informations contenues dans les feuilles de pêche, transmises aux OP. Pour autant, les pêcheurs n’ont pas l’obligation de transmettre ces informations, qu’ils jugent pourtant aptes à valoriser leurs captures par rapport aux produits d’import ou de pêche hauturière. |
6- S’il n’y avait qu’une seule information à donner au consommateur, ce serait laquelle ?
Ensemble : La fraîcheur !
7- Selon quels critères ? La date de pêche ?
I. M. : Non, parce que le consommateur n’a pas conscience qu’un produit acheté en criée n’est pas débarqué le matin. En plus, la qualité dépend beaucoup du glaçage. Les grades Extra, A, B, etc. sont plus parlants. Une date ne veut rien dire.
F. R. : Elle signifierait l’arrêt de la pêche hauturière !
L. W. : Un poisson de 24 heures mal traité peut être inférieur en qualité à un poisson de huit jours bien traité, éviscéré et glacé. La date de pêche n’est pas pertinente si elle n’est pas accompagnée d’information sur le procédé de traitement du poisson. Pourtant, 80 % des Français pensent que la date de pêche est une mention obligatoire. S’ils posent la question, mieux vaut expliquer le temps des marées…
I. M. : …l’importance du glaçage, dans les bateaux ou les criées. Tout le monde ne glace pas encore. Il faut faire connaître les bonnes pratiques sur le glaçage, la maîtrise des températures. Une température bien maîtrisée, c’est un poisson qui dure plus longtemps. Il faut des contrôles et ce, à tous les niveaux de la chaîne.
L. W. : Il est illusoire de vouloir mettre sur une étiquette un critère qui évolue dans le temps. L’information doit être transmise par les professionnels. Cela peut permettre d’éduquer le consommateur sur les critères de qualité. Certains sont faciles : la brillance, l’absence d’odeur, l’œil…
C. A. : Pour certaines espèces, c'est plus compliqué : seul un vendeur peut rassurer un client sur une lotte « un peu sanguine ».
L. W. : C’est toute la valeur ajoutée des rayons marée, ils exigent un rapport humain. Ne serait-ce que pour répondre à la première demande du client : comment préparer mon poisson ? D’autant que la France dispose d’une centaine d’espèces différentes à commercialiser. Mais pour humaniser un mode de distribution d’un produit haut de gamme, il faut des formations.
C. A. : Beaucoup de choses s’apprennent sur le terrain. Je m’en aperçois tous les jours. Même tombée dans le secteur à ma naissance, la connaissance des produits reste difficile à acquérir.
Je ne cesse de poser des questions. D’où l’idée de créer les fiches espèces, métiers, etc. et de les rendre accessibles à tous, dans l’entreprise notamment. De la même façon, il me paraît indispensable que tous nos salariés soient formés à l’agréage.
|
Le regard des transformateurs Selon l’Adepale, les transformateurs seraient peu impactés par le manque de transmission des informations. L’explication : ils travaillent un nombre d’espèces réduit et achètent des lots plus homogènes, même s’ils constatent parfois des mélanges de lots entre sous-zones et/ou techniques de pêche. À noter que la mise en place au même moment du règlement Inco, obligeant à l’information nutritionnelle, leur a rendu la tâche complexe. |
8- Le conseil est une plus-value du rayon marée. Mais les professionnels manquent à l’appel. L’étiquette peut-elle être un relais, y compris dans les nouveaux circuits de distribution ?
F. R. : Je n’y crois pas. Regardez, le drive n’attire pas les vrais consommateurs de poisson, ils viennent en magasin.
C. A. : Avec la transition numérique, tout est possible. Difficile de savoir où cela entraînera la filière, tant cela modifie les attentes des clients et leur façon d’acquérir les produits. Il y a trois ans, nous n’aurions pas pu imaginer donner une visibilité en temps réel sur les ventes à tous nos acheteurs et vendeurs. C’est possible maintenant avec notre mur d’écrans. Quant à l’application Push, elle génère 3 à 4 millions d’euros, un an après son lancement. Et les ventes se font en 30 minutes. C’est une surprise, mais cela renforce nos convictions.
F. R. : Cela attise la curiosité. À titre personnel, je pense qu’il y a une vraie place pour le commerce en ligne de poisson de qualité acheté en criées. Reste la question de la logistique, encore très onéreuse.
C. A. : Nous avons démarré les livraisons par Chronofresh et Chronofreeze cette année. C’est fantastique que les colis embarqués à 17 heures à Agen soient livrés avant 13 heures le lendemain.
I. M. : Le succès repose sur la confiance des consommateurs dans la qualité des produits, la fraîcheur des poissons. Nous avons demandé des contrôles de température. Il y en a cinq pendant le parcours. De plus, nous utilisons aussi notre ERP pour assurer la traçabilité des emballages qui touchent le produit. Cela participe
à la sécurisation des consommateurs.
C. A. : Aujourd’hui, il faut être à l’écoute du consommateur final. Il a besoin et envie de plus d’information. Chaque maillon doit participer à cette transmission. En ce sens, le règlement sur l’étiquetage nous offre une opportunité de le faire.
L. W. : Vos propos reflètent bien les résultats de l’étude. Beaucoup ont décidé de travailler quelque chose autour de la traçabilité, à défaut de toujours appliquer la réglementation. Pourtant, nous nous sommes rendu compte, en regardant ce qui se passait à l’étranger, que la contrainte réglementaire ne faisait pas forcément émerger les meilleures actions. Au Canada comme aux États-Unis, seules deux mentions sont obligatoires. Pourtant, sous la pression des associations de consommateurs, c’est là que les initiatives les plus intéressantes en matière de traçabilité, allant du bateau au client, sont nées. En Europe, les législateurs semblent ne pas faire confiance aux professionnels pour assurer la sécurité des consommateurs et préfèrent fixer un cadre tellement normé qu’il bride les énergies pour prendre des initiatives.
Ce serait pourtant important. D’autant qu’au sein de l’Europe, les demandes en termes de traçabilité diffèrent d’un pays à l’autre, selon la connaissance de la filière et des produits de la mer.
La durée de la marée, la technique de pêche et le nom latin importent beaucoup plus aux Espagnols, qui ont la culture des produits de la mer, qu’au reste des Européens.
Propos recueillis par Céline ASTRUC - Photos : Thierry NECTOUX