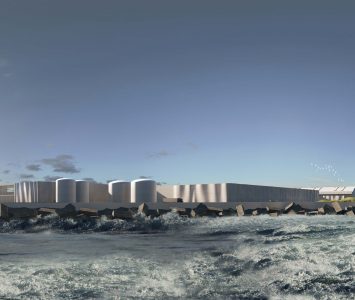L’ikejime, méthode japonaise d’abattage du poisson pour limiter sa souffrance et optimiser la qualité, se développe en France. Mais les résultats varient et risquent de desservir la filière. Comment garantir la qualité et la valorisation, de la pêche à la vente finale ? Quels rôles peuvent jouer les différents maillons ? Beaucoup d’actions restent à mener au sein de cette filière balbutiante.
 |
 |
 |
 |
|||
|
Akiko Morita-Ranchoux, « L’ikejime est avant tout une philosophie pour ôter la vie d’un animal avec respect. Il est meilleur et se garde plus longtemps. » |
Sandrine Thomas, « Ce serait bien d’avoir des viviers disponibles à terre pour laisser les poissons 24 heures et uniformiser l’ikejime. » |
Stéphanie Woods, « Comme pour toutes |
Marine Barbier, secrétaire générale adjointe du comité des pêches du Morbihan (CDPM56) « Il faut encadrer sans pénaliser ceux qui travaillent correctement. » |
 |
 |
 |
 |
|||
|
Érick Vallée, bureau d’études Haliocéan « Est-ce qu’on certifie une pratique ou un produit ? Il faut mettre le curseur au bon endroit.» |
Jean-Marc Lizé, directeur de la criée de Quiberon « Certains sont dans l’ikejime pour gagner des sous. C’est très bien quand c’est bien fait, mais sinon, on tue dans l’œuf cette filière naissante. » |
Alexandre Lebrun, « Celui qui a goûté le véritable ikejime ne peut pas revenir en arrière. Le maître-mot, c’est : goûtez, vous serez bluffé. » |
Céline D’Hardivillé, chargée de mission pêche côtière au CDPM56 « La marge est intéressante en sortant des espèces nobles. Il y a quand même un prix maximum, |
1- Vous êtes ici trois précurseurs de l’ikejime en France. Comment avez-vous appris ?
Stéphanie Woods : J’ai vécu au Japon, j’y ai rencontré quelqu’un de très bien, qui m’a montré. J’ai démarré l’abattage à terre à Saint-Guénolé en 2015. Il ne faut pas se leurrer, c’est beaucoup d’huile de coude, et avant tout de la rigueur et de l’honnêteté envers son client : si un poisson n’a pas réagi correctement à l’abattage, il ne faut pas le vendre en ikejime. Mieux vaut se faire une bonne réputation et dormir sur ses deux oreilles.
Erwan Ranchoux : Ma femme Akiko a travaillé au Japon, avec des clients grossistes en poissonnerie, au marché au poisson d’Osaka. À chaque voyage on faisait des échanges de compétences avec un poissonnier dans le métier depuis soixante ans. On a ainsi découvert l’ikejime. C’est avant tout une philosophie. Dans le bouddhisme, quand on ôte la vie d’un animal pour le manger, on le fait avec respect, sans le faire souffrir. Et il se garde plus longtemps et est meilleur. En France, on voit plus l’aspect business, mais à la base, c’est le respect de la nature. Si on se lance juste pour la plus-value, on n’aura pas un bon résultat. Dernièrement, on est partis cinq semaines avec des professionnels de l’ikejime au Japon. Les poissons ne sont pas tout à fait pareils, ni la réglementation, bien plus souple, et il faut transposer ce qu’on a appris en l’Europe. Nous achetons du poisson vivant à un pêcheur à Lorient, et nous l’abattons dans son local. Akiko a aussi appris la maturation auprès d’un poissonnier et prépare des sushis, des sashimis, des plats pour les clients.
Sandrine Thomas : Moi j’ai vu le reportage de Thalassa sur Stéphanie et je suis tombée amoureuse ! Quand j’ai débuté la pêche, j’avais du mal à voir mourir les poissons, leur souffrance m’était intolérable. Quand j’ai découvert cette pratique, je me suis fait fabriquer mes petits outils par un ferronnier. Il faut se débrouiller seul. J’ai appris par les vidéos, les lectures, mais il y avait peu d’écrits, c’était compliqué. J’ai commencé il y a plus de trois ans. J’ai fait beaucoup d’essais sur toutes les espèces et différents matériels. J’ai eu beaucoup d’échecs, des poissons perforés… La deuxième année grâce aux réseaux sociaux j’ai rencontré Erwan et Akiko et nous sommes partis au Japon. Ça a conforté mes découvertes et m’a apporté des compléments, ainsi qu’une crédibilité. J’ai appris le maintien en vie plutôt avec l’aide d’amis scientifiques, pour retirer l’air de la vessie natatoire. Au début j’avais du mal à être partout : assurer la pêche, surveiller mes viviers, l’eau, l’oxygène… J’en dormais mal. Durant bien six mois, tu n’es pas sûr de toi et tu réussis à peine 30 % des poissons. Même si tu les a tous abattus. 100 % de réussite, ce n’est pas possible. S’il y a un doute je déclasse le poisson : s’il a les ouïes décollées, s’il est déjà en rigor mortis à peine deux heures après l’abattage… Au départ, je n’avais aucune reconnaissance du milieu, ni plus-value, j’étais la risée du port. Il faut expliquer, y croire à fond. On a communiqué seuls, ce n’était pas évident. Maintenant ça se passe bien, le marché s’est développé, mes clients sont fidèles. J’ai fait des pins avec le nom du bateau, Le Goëlo, j’assume complètement. Tu mets tous les jours ta réputation en jeu. Si les poissons sont très bien, c’est moi, s’ils sont mauvais, c’est moi aussi. Des personnes qui avant se moquaient ont vu que je vendais mon poisson plus cher et me demandent de leur montrer… Qu’ils se débrouillent, comme moi, et si ça marche, ça sera grâce à eux.
2- Vous constatez un développement de l’ikejime avec une qualité inégale ?
Érick Vallée : Plein de pêcheurs s’y sont mis en trois clics et quelques jours. L’offre a augmenté de façon anarchique, avec trop de poissons mal ikejimés, décevants. De ce que j’ai vu sous criée, rien que sur des critères externes, j’aurais retiré 50 % des poissons dits ikejime : pliés comme des bananes, avec des branchies écarlate... Un poisson qui a souffert, mal saigné, ça se voit. Ça peut être un très beau poisson traditionnel mais ce n’est pas ce qu’attend un acheteur d’ikejime, en droit de le faire maturer. Des mareyeurs déçus ne veulent plus revenir, on les a perdus. Ça ternit l’image de la filière.
Alexandre Lebrun : En criée, il y a des retours positifs et négatifs. J’ai refusé du poisson mal ikejimé aux pêcheurs, mais je ne suis pas sûr que ce tri soit fait partout.
Jean-Marc Lizé : Aujourd’hui, certains sont dans l’ikejime pour gagner des sous. C’est très bien quand c’est bien fait, mais si c’est n’importe quoi, on tue dans l’œuf cette filière naissante.
S.T. : J’ai parfois des plaintes à propos de collègues. J’ai vu un bateau faire 100 % d’ikejime dès le premier jour, c’est impossible. Il a fait 200 kg de bar en février, pêché à plus de 25 mètres, il n’a pas pu le maintenir en vie. Si tu fais un trou dans la tête d’un poisson déjà mort, ben tu as tué un mort, c’est tout. Et ça se voit tellement, rien qu’à la couleur...
3- C’est ce qui a conduit au guide de bonnes pratiques, piloté par le comité des pêches du Morbihan ?
Marine Barbier : On a commencé à aborder ce sujet en 2017 car on s’est vite aperçu des dérives. Il fallait encadrer sans pénaliser ceux qui travaillent correctement. L’ambition était vaste : guide méthodologique, formation, marque ou label, avec un cahier des charges et du contrôle. Mais c’était précipité, on y va par étape, avec d’abord le guide pratique à l’intention des pêcheurs. Le projet a été élargi au national, avec un soutien financier de France Filière Pêche et d’Eolfi. Des organisations de producteurs, comités des pêches et criées étaient au comité de pilotage. Les bureaux d’études Haliocéan et Ivamer, retenus suite à un appel d’offres, ont fait un bon boulot. Durant une bonne année, ils ont recensé les pratiques, d’une région à l’autre, et tout centralisé. Le budget n’a pas permis d’aller au Japon et il s’agissait de montrer l’ikejime pratiqué en France à bord, avec nos contraintes. Ce guide donne des bases solides à un pêcheur pour s’initier à l’ikejime. Les structures associées le diffusent auprès des pêcheurs. Au comité on en a imprimé cent exemplaires imperméables et utilisables à bord.
É.V. : On a consulté ceux pratiquant l’ikejime en mer et à terre, pour voir les bases techniques communes, incontournables. Sans révéler les astuces personnelles qui sont le fruit de mois de travail. Le guide comprend aussi des notions sur le maintien du poisson vivant, car les deux sujets sont très liés, et sur le cadre réglementaire. Ainsi que les critères qualité : ce ne sont pas les mêmes standards qu’en traditionnel. Des criées ou des mareyeurs étaient perdus et refusaient du poisson car il était encore très souple ou avait les branchies très claires. Tout le monde a appris que le poisson doit être raide, frais, les ouïes bien rouges, et là c’est le contraire.
4- Est-ce que la date d’abattage doit être stipulée ?
S.W. : Je mentionne sur tous mes poissons l’espèce, le poids, le numéro de lot, la zone de pêche très précise, la date de capture et la date d’abattage avec un créneau horaire. Le delta donne le temps de repos en vivier. La date d’abattage n’est pas obligatoire mais c’est une réelle valeur ajoutée et les services vétérinaires adorent. Un poisson ikejime qui a dix jours, des gens sont sceptiques, mais savent-ils qu’un poisson de qualité B a plus de quinze jours de mer ?
S.T. : Pour moi, chaque poisson a un flash code avec dates de pêche et d’abattage accessibles. Souvent, c’est le même jour, sauf sur quelques spécimens qui vont jeûner, pour certains clients.
5- Qu’est-ce qui différencie l’ikejime à bord et à terre ?
S.T. : Il y a des espèces à ikejimer tout de suite. Tous les thonidés, les gros poissons comme des maigres, ne se gardent pas en vivier, il faut qu’ils nagent. Le lieu jaune aussi est sensible à la décompression et ça ne sert à rien de le garder. Ça dépend aussi si le poisson a souffert de la pêche, s’il a avalé l’hameçon et risque une perforation, ou si l’hameçon s’est croché dans une branchie. Alors tu l’abats tout de suite, sinon il sera en souffrance. On voit très bien ceux qu’on peut garder vivants, les maintenir en vivier quelques heures est alors très important pour la qualité. Bar, dorade, sole, raie, il y a plein d’espèces qui se gardent au moins 24 heures.
E.R. : Le poisson plat a besoin de moins de temps. La capacité du poisson à tenir en vivier dépend aussi du milieu où il a passé les dernières heures. Et de la méthode d’extraction, s’il est pêché profondément. C’est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Ikejimer à bord peut être une solution mais l’ikejime à terre permet de faire un premier contrôle qualité et peut être beaucoup plus qualitatif.
S.W. : L’abattage à terre standardise le poisson sauvage. Ça permet d’enlever tous ceux qui ont souffert à la remontée, qui ont des lésions, dont la vessie natatoire a comprimé les organes… Je n’achète à la débarque que le poisson qui paraît viable. En ce moment, j’enlève souvent quelques pagres qui ne me paraissent pas flotter comme il faut. Je ne vais pas risquer d’acheter un poisson si c’est pour le retrouver demain mort dans mes viviers, car ça finit sur ma table. Autant qu’il parte dans le circuit classique sous criée. Il faut avoir l’œil, car sous l’effet du stress, les poissons ont un petit regain de tonicité. Et à terre on n’a pas à manœuvrer de navire, subir la météo, on est concentré, on devient hyper spécialisé dans l’abattage. Les poissons passés en vivier sont abattus de la même manière, par la même personne, et sont au même niveau de repos et de digestion. En sortant ils sont identiques en qualité. Les clients me disent qu’ils n’ont pas besoin d’ouvrir la caisse, il n’y a aucune surprise.
A.L. : Dans les viviers à Quiberon, on assure le suivi du poisson pour voir s’il se stabilise. Ce n’est pas parce qu’il bouge encore qu’il est viable. S’il se traîne dans le bassin, il sort du lot et repart dans le circuit conventionnel. Il faut anticiper car s’il meurt en vivier c’est un déchet, réglementairement. Ça reste du haut-de-gamme, mais pas assez pour l’ikejime.
6- Comment éviter que certains fassent de la mauvaise qualité ?
S.W. : Pour moi, c’est un sujet sans en être un. Vous avez aussi des qualités très variables de poisson de ligne d’un bateau à l’autre : du très beau et du travail de cochon. Des fileyeurs ont du très beau poisson et chez d’autres il est bon à donner aux chats. On a juste une nouvelle gamme de produits, sur laquelle on retrouve les habituelles questions de qualité.
A.L. : Je suis d’accord, des ligneurs mettent des palangres pour occuper le terrain et ont du poisson noyé qui devrait être déclassé B. Et des fileyeurs bossent très bien. Lorsqu’on a commencé à Quiberon la démarche poisson vivant, certains ont voulu le réserver à la ligne, mais chaque métier est capable de faire le meilleur comme le pire. Il ne faut pas exclure un engin. Chacun peut adapter son engin pour atteindre l’excellence.
S.T. : Et les espèces que nous pouvons ramener, nous ligneurs, restent très limitées. Si on veut de la sole, du turbot ou autre, c’est avec des fileyeurs, des caseyeurs. Mais ils doivent se mettre en tête qu’à bord l’ikejime prend au moins 50 % du temps. Le chalut, je n’y crois pas trop.
Céline D’Hardivillé : Dans l’absolu, même un chalutier peut adapter sa pratique.
S.W. : Oui et non, les dimensions font qu’il n’y a pas de petites prises. Même si les traits sont très courts, les poissons sont comprimés. J’ai essayé sur des dorades, vivantes, belles, et au filetage elles étaient pleines d’hématomes.
A.L. : En tout cas il ne faut pas interdire par principe mais plutôt encourager la montée en gamme.
S.W. : C’est aussi une question de filière, à chaque maillon de bien travailler. Le pêcheur doit savoir quel poisson est au top pour aller en ikejime. Sous criée, ils doivent savoir grader les poissons. Un mareyeur compétent est apte à juger de la qualité. Normalement, le restaurateur achète son poisson auprès de quelqu’un qui connaît son job. Normalement. Si c’est plus cher sans être justifié, il ne va pas se faire berner cinq fois, il dira stop. Ça se régule tout seul.
A.L. : Le marché va exclure les moins bons, ceux qui surfent sur une mode. Mais c’est un marché en création, il ne faut pas que la mauvaise réputation de certains ternissent ce créneau au point qu’on passe à côté.
É.V. : Cette filière émergeante a beaucoup déçu. Attention, elle est fragile. Il y en a qui ont essayé et ne reviennent plus après un ou deux achats. C’est dommage, c’était des personnes à fidéliser.
S.W. : Ils reviendront peut-être plus tard. Les gens qui ont goûté à l’ikejime et qui en sont contents ne reviennent pas en arrière.
S.T. : Je suis d’accord avec Stéphanie, les bons et mauvais élèves, c’est commun à tous les métiers en mer ou à terre… La sélection naturelle fonctionnera. Il y a des pêcheurs qui s’y sont mis une semaine, ça les a gavés, ils avaient mal aux doigts et n’avaient pas gagné un euro. Ceux qui font ça pour l’aspect financier, tôt ou tard, seront mis de côté. Punir ou faire marcher la carotte, je ne pense pas que ce soit la peine. Mais il faut un cadre. C’est décevant de voir des pins ikejime sur des poissons lamentables, c’est une mauvaise publicité.
7- Faut-il imposer une formation pour pratiquer l’ikejime ?
É.V. : Quand on interroge les mareyeurs, en effet les attentes envers l’amont portent sur la formation et la certification, pour avoir des garanties. Tout le débat, c’est est-ce qu’on certifie une pratique ou un produit ? On peut se former, mais l’expérience compte. Ça va être couteux et une formation n’assure pas un client satisfait. C’est délicat d’imposer demain de se former à des experts comme vous, à base de l’ikejime en France. Je pense au contraire que c’est à vous d’être le socle d’une démarche. À mon avis, demain, s’il y a un agrément, ce serait plus sur du contrôle inopiné de produit, la régularité ou la qualité, plutôt que sur la pratique. Pour le client, c’est le résultat qui compte. Qu’est-ce que vous en pensez ?
S.W. : Ça me paraît compliqué. Une formation obligatoire, c’est plus facile. En même temps, est-ce que la personne formée appliquera les consignes dans la durée ?
E.R. : Peut-être que tu peux faire une formation, et à l’issue, tu laisses six mois d’entraînement, comme en bio : tu es agréé, mais tu as un délai avant de commercialiser ton produit.
S.T. : On peut déjà vérifier que le navire a le bon équipement : vivier, bulleurs, glace. Et former les agents de criée pour qu’ils fassent la différence. Il faut avoir la crainte que le poisson soit contrôlé.
É.V. : Oui, un audit de l’outil a du sens. Comme un contrôle inopiné du produit sorti. Déjà, une première étape serait d’avoir une codification nationale de ce produit en criée. Là chacun y va de sa petite recette pour rajouter un champ selon la place. Et en formant au moins une personne sous la criée à cet agréage qualité, déjà des poissons décevants rejoindraient la bonne case.
M.B. : Ça permettrait de ne pas brider les pêcheurs, de leur laisser des marges de manœuvre. Une formation en freinerait certains et risque d’être mal perçue par ceux qui pratiquent déjà bien l’ikejime. Alors que si le tri est fait côté criée, ça laisse du temps pour s’initier, prendre ses marques. Par contre, ça n’inclut pas les ventes directes. Suite au guide de bonnes pratiques, on a lancé Valike, étude de faisabilité pour la mise en place d’une filière ikejime valorisée, autour des questions qu’on se pose ici. On a élargi à plus de 25 partenaires autour de la table, en ajoutant l’aval. L’idée c’est d’étudier toutes les pistes : formation des pêcheurs, des criées, des mareyeurs, marque, label… Haliocéan balaie tout selon les problématiques de chaque maillon, en lien avec les acteurs, pour voir s’il se dégage une piste de valorisation qui ne pénaliserait personne et récompenserait les bons.
É.V. : Mais jusqu’où aller dans la certification ? C’est parfois lourd à porter, coûteux, long, avec des retombées pas forcément à la hauteur du travail, des coûts de fonctionnement. Il faut mettre le curseur au bon endroit. On peut s’inspirer de la démarche thon rouge de ligne en Méditerranée. C’est une marque, avec des engagements, un référencement des bateaux et des mareyeurs listés sur un site internet, et de la communication positive. Un organisme qualité vérifie le respect du cahier des charges. L’acheteur connaît les bateaux et mareyeurs agréés. Ça a le mérite de rassurer, il y a des contrôles. Un bateau peut être audité. Tu fais un tri nécessairement. Je ne dis pas que c’est le bon modèle, mais c’est simple, efficace, ça peut être un bon début. Les criées peuvent jouer le rôle de filtre. Il y a là une équation qui peut marcher, à bien calibrer avec les précurseurs de cette filière.
8- Comment s’assurer d’une bonne répartition des marges ?
E.R. : Ce qui est difficile, c’est que le pêcheur parfois surévalue ses produits, et derrière on ne peut pas faire de plus-value sur notre travail. Quand il vend la lotte 9 euros le kilo, vivante, pas éviscérée, donc pleine de flotte, en fait il double le prix. Une lotte de 12 kg dont on tire juste une queue de 4 kg… C’est un gros frein.
É.V. : En même temps, qui est capable de ramener de la lotte vivante aujourd’hui ? Ce n’est pas rien.
S.W. : Maintenir du poisson vivant à bord, ça prend du temps, on pêche moins. Il faut vendre plus cher pour arriver au moins au même revenu. Je défends ceux qui veulent faire de l’argent sur l’ikejime, c’est légitime, si ce n’est pas la seule motivation.
E.R. : Si on veut vraiment valoriser l’ikejime, l’idéal c’est de ne pas partir sur des produits déjà surévalués. Ce matin la sole était à 25 euros, le bar à 22, pourquoi on ne cible pas d’autres espèces ? Une dorade grise ikejime est complètement transformée. La raie aussi. C’est cher, mais moins que le bar. Il faut valoriser des espèces méconnues, sublimer le produit, avoir l’éventail le plus large.
C.D’H. : Oui, la marge est intéressante en sortant des espèces nobles. Sur le bar, on ne va pas pouvoir doubler le prix de l’ikejime. Il y a quand même un maximum, même sur du haut-de-gamme, au-delà duquel les clients ne vont pas aller.
S.T. : À la ligne on est déjà sur des espèces bien valorisées, alors avec en plus l’ikejime, c’est sûr que c’est cher. Oui, on pourrait proposer des espèces un peu moins chères pour le faire découvrir à plus de monde. La vieille par exemple.
A.L. : On a vendu du grondin perlon à prix d’or, jusqu’à 15 euros/kg. On triple le prix.
9- Il y a très peu de criées équipées de viviers comme à Quiberon. Faut-il développer ce modèle ?
S.T. : Oui, ce serait bien d’avoir plus de services pour faciliter la logistique, des viviers disponibles pour laisser les poissons 24 heures et uniformiser l’ikejime. Mes poissons ikejime que je vends à la criée ont rarement plus de sept heures de vivier. Ça semble suffisant pour le stress car j’ai des bons résultats, mais pour la digestion, 24 heures c’est le top. Je me suis équipée avec d’énormes bulleurs, quand j’ai des commandes spécifiques, pour des chefs qui font de la maturation, je suis capable de garder les poissons à bord jusqu’à 48 heures. Avec succès, j’ai déjà retrouvé à Rungis mes poissons toujours beaux, plus de quinze jours après avoir arrêté la pêche. Mais c’est à mes risques et périls, car je suis branchée à quai. À Royan on n’a même pas d’eau de mer, je la pompe au large. L’avantage c’est que je n’ai pas à sortir les poissons, les mettre à sec, les remettre en eau…À La Cotinière, où j’ai commencé à fidéliser quelques acheteurs, on construit un nouveau port, est-ce qu’on ne pourrait pas intégrer des viviers ?
S.W. : Moi aussi j’ai mal choisi, je ne me suis pas implantée à Quiberon ! C’est vraiment compliqué de s’approvisionner en poisson vivant sans dépôt à la criée, il faut tout le temps courir à la débarque, les heures d’arrivée au port sont très approximatives, et soudain on m’appelle, et je plante tout ce que je fais pour remplir le camion dans le quart d’heure. Un vivier-tampon à la criée c’est super important. Et ça résout le problème des week-ends, des ponts, on aurait du poisson de qualité dès le lundi matin.
E.R. : Des criées disent « c’est intéressant », et six mois après il ne se passe rien. À Lorient, on dépend d’initiatives de pêcheurs. Avec des écarts de température entre la mer, le vivier du bord, l’eau à quai, les viviers à terre, ce qui fait au moins quatre stress. Quand le poisson est stressé, l’ikejime perd de l’intérêt.
A.L. : Les criées ont tout leur rôle à jouer. Elles doivent évoluer pour être en mesure d’offrir cette gamme de produit. On a eu de la chance à Quiberon et j’ai de l’écoute à Saint-Malo avec des gestionnaires du port qui croient dans le projet. La première année à Quiberon on n’a fait que 450 kg de poisson vivant ou ikejime, pour monter au fur et à mesure.
Au regard du volume et du temps passé, n’importe quel financier dirait que ce n’est même pas la peine. C’est un vrai pari. Ça grimpe mais ça reste faible, comme la truffe au regard de la production de champignon. Mais les criées doivent accompagner ce mouvement, s’équiper en viviers, répondre aux besoins exprimés par les pêcheurs et acheteurs.
É.V. : Il y a des ports où débarquer et transférer le poisson vivant est difficile, sans eau de mer distribuée à bonne température, c’est un vrai frein. Mieux vaut intégrer des viviers quand des travaux sont projetés, car après c’est toujours compliqué d’y revenir. Mais à part les deux messieurs ici, l’accueil est peu favorable, vu les volumes très faibles. Des criées qui font déjà du crustacé et du coquillage, qui ont des structures adaptées, ne voient pas l’intérêt de rajouter un module ou deux pour du poisson vivant.
10- À Quiberon, vous prévoyez un atelier pour faire l’ikejime…
J-M.L. : C’est la continuité de ce qu’a initié Alexandre. On installe de nouveaux viviers pour avoir une capacité étendue et un atelier d’abattage avec un agrément collectif porté par la criée. On réfléchit à la façon dont cet outil fonctionnera. Celui qui ikejime doit être conscient que s’il loupe son poisson il ne sera pas vendu en ikejime. L’idée est d’engager notre responsabilité et d’avoir une marque déposée. Mais est-ce qu’on maîtrise entièrement l’outil, est-ce que d’autres y accèderont, comment va-t-on commercialiser ces produits ? C’est encore à réfléchir.
11- Transporter du poisson vivant en camion-vivier jusqu’à Paris où il est abattu dans un grand restaurant, est-ce que ça a du sens ?
E.R. : Cela fait transporter énormément d’eau de mer. L’ikejime pallie justement ce problème. Les Japonais ne comprennent pas pourquoi certains transportent du poisson vivant.
S.W. : Entre le stress, le coût, l’empreinte carbone, je n’en vois pas l’intérêt. À part d’avoir du poisson en pre-rigor, encore mou, alors que le poisson abattu en Bretagne arrive en rigor mortis après le transport. Je crois que c’est aussi beaucoup une question d’image.
A.L. : C’est un autre marché, ça permet aussi d’avoir une gestion de stock, de faire tampon. L’un n’empêche pas l’autre.
12- Quelles démarches faut-il mener envers l’aval de la filière ?
A.L. : Le mot ikejime est connu, mais qui sait vraiment ce que c’est, l’a gouté, au sein de la profession ? Il faut des démonstrations. On avait fait venir un maître japonais, c’était une bonne façon d’échanger. Il faut sensibiliser les mareyeurs. Certains attendant la rigor mortis disent, « ton poisson est tout mou ». Non, il est souple, pas mou. Pose ton pouce dessus, s’il laisse l’empreinte, c’est mou ; s’il rebondit, c’est qu’il est souple ! On arrive sur des produits ultra haut-de-gamme encore méconnus. Celui qui a goûté le véritable ikejime ne peut pas revenir en arrière. Le maître mot, c’est « goûtez, vous serez bluffé, c’est ça que vous voudrez ». Quasiment tous les clients soient hors Bretagne, c’est symptomatique.
S.W. : C’est une question de prix beaucoup, mes poissons sont chers, on n’a pas forcément en Bretagne les restaurants pour absorber ça. Il y en a deux, mais ce n’est pas là que je fais le gros de mon chiffre. Ce qui m’a le plus surprise, c’est que sur mon port, à Saint-Guénolé, et même au Guilvinec, pas un mareyeur ne m’a appelée pour essayer ce truc nouveau. Pas un n’a eu cette curiosité ! Je ne comprends pas, d’autant qu’il y en a qui font du beau poisson.
S.T. : Aucun restaurant ne propose mon poisson à Royan. Il faut faire énormément de pédagogie, les clients sont hyper novices. Ils ne savent pas ce qu’ils peuvent faire de ce produit tip-top, comment le conserver, le sublimer pour relever la 6e saveur, l’umami. Je répète de le faire maturer. Un chef m’a appelée : « Mais ça fait 21 jours que j’ai le filet, il est toujours top, qu’est-ce que t’as mis dans ton poisson ? » Je n’ai rien mis dedans ! J’ai enlevé le stress de la pêche et pratiqué le repos, l’abattage en mort cérébrale, l’extraction totale du sang. Il faut mettre en valeur les qualités du produit.
A.L. : Notre système de formation est trop cloisonné. On devrait avoir un module transversal pour expliquer les attentes de chacun. Dans les lycées hôteliers, on peut faire découvrir ce produit aux futurs chefs de demain.
S.W. : En brigade ils l’apprennent normalement. Si tu touches à l’école, tu touches tout le monde. Même ceux qui ne finiront pas chez les étoilés.
E.R. : Si un cuisinier met un certain prix dans un produit et ne sait pas le mettre en valeur, il ne sera pas convaincu. S’il le cuisine avec tomate, laurier, thym, persil et citron, il ne va pas trouver de différence de goût. Nous avons sensibilisé de futurs cuisiniers dans un lycée hôtelier parisien, et l’an prochain, on aura peut-être un partenariat pour qu’ils fassent un petit guide de maturation. Au Japon, chacun a sa technique.
A.L. : On commence à voir pour la viande des caves de maturation pour faire rancir les côtes de bœuf. Pour le poisson, ça va venir.
S.T. : Il faut lever des fonds pour des événements, participer à des salons, proposer des dégustations. Beaucoup de gens seraient surpris de préférer du poisson de quinze jours en test à l’aveugle ! On doit dire pourquoi acheter du poisson ikejime, pourquoi il est un peu plus cher, ce qu’on peut en faire, le faire déguster. Pendant le confinement, des clients ont fermés, on a donc développé la vente directe. J’amenais les poissons tout mous à la porte des gens, surpris, et je leur disais d’attendre pour que le goût se développe, en expliquant la démarche. Ils trouvent la pêche hyper exotique, ils sont contents d’apprendre. En France on est à des années-lumière d’inciter à manger du meilleur poisson, et encore moins cru, ce n’est pas notre gastronomie. Il faut mettre en lumière la qualité et le bien-être animal.
C.D’H. : Il faut raconter une histoire. L’histoire que tu racontes, il faut qu’elle soit racontée jusqu’au bout, tu personnalises le poisson, la façon dont il a été pêché.
13- Est-ce un produit réservé à des marchés de niche, ou a-t-il sa place en GMS ?
S.W. : J’ai des sollicitations de magasins : près de chez moi, du sud de la France, à la frontière suisse… Ma politique c’est de ne pas vendre à la GMS, je n’ai pas donné suite. J’ai une toute petite production, je ne peux pas les fournir. Et ce n’est pas la peine, les gens vont le manger dans les deux jours. Mon poisson est au top, ce n’est pas un produit GMS. Mais des magasins ont de belles poissonneries et mettent les moyens dans du beau poisson. De l’ikejime de bord irait très bien. Le chef de rayon qui veut de l’ikejime connaît sa clientèle, il sait que ça intéresse des gens, il peut leur en mettre de côté.
M.B. : Moi ça me choque qu’une GMS vende de l’ikejime parce que le client ne sait pas forcément ce qu’il achète, et on en perd un peu les vertus. Il doit y avoir du débit, est-ce que le vendeur a le temps d’expliquer ce produit à chaque client ?
14- Comment communiquer envers le consommateur ?
A.L. : Être prêt à répondre en cas de dérive, préparer une cellule de crise, oui. Mais attention. Dire que c’est mieux, c’est sous-entendre que d’autres font moins bien. Il faut montrer que c’est différent, que ça sublime le produit, mais sans décrédibiliser les autres. Déjà qu’on n’est qu’une poignée et qu’on passe pour des hurluberlus, des doux rêveurs. Il ne faut pas que la profession croit qu’on la dénigre, alors que ça n’a pas lieu d’être. C’est une autre approche.
S.T. : Tu ne décrédibilises personne, tu montres ce que tu es capable de faire, tu mentionnes, « abattu avec respect », mais sans dire que les autres les laissent claquer. Il faut mettre en avant les qualités gustatives et l’éthique. Les gens veulent savoir d’où vient la viande.
É.V. : D’où, mais pas comment elle est tuée. On ne montre pas la saignée de la vache, et ça n’empêche pas de parler du bien-être animal. Attention, c’est sensible. Les clients n’ont pas envie de voir ça. La vulgarisation sur internet avec des vidéos de pêcheurs ça a été la double peine : un développement anarchique et des images qui n’ont pas donné envie au client.
S.T. : Je suis peut-être extrémiste. Pour mes premières vidéos, je me suis faite insultée par toute la planète, j’étais un assassin. Mais les images d’ikejime passent mieux maintenant.
S.W. : Moi on m’a demandé si je voulais qu’on me plante un clou dans la tête après Thalassa, c’était une catastrophe. Attention au dérapage. La cause animale devient vraiment un sujet.
A.L. : Dire que c’est dans le respect de l’animal, parler des qualités gustatives, oui. Mais montrer comment il est abattu, il faut faire attention.
C.D’H. : Il faut une communication positive. Quand on est passionné par un sujet, on a tendance à vouloir montrer tout ce qu’on fait. Communiquer, c’est un métier.
15 - L’étude Valike aborde ces questions. Quand aboutira-t-elle ?
M.B. : C’était prévu à la fin de l’été, mais avec le confinement on a pris du retard. On garde en ligne de mire le début de l’automne.
Propos recueillis par Solène LE ROUX - Photos Thierry NECTOUX