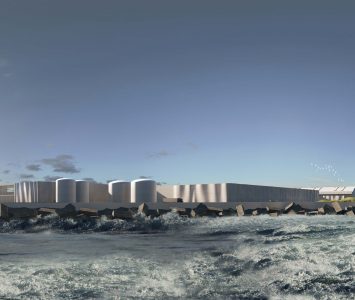Pêche, aquaculture, mareyage, transformation, biotechs marines s’ouvrent aux investisseurs. Qu’ils soient du métier ou extérieurs, comme des fonds d’investissement, l’essentiel est d’évaluer le potentiel de l’activité dans un environnement ouvert et instable.
 |
|
Raphaël Brenier Directeur associé d’Aurignac Finance. Cette banque d’affaires suit la filière des produits de la mer en France et en Europe avec beaucoup d’intérêt depuis plusieurs années. |
1- PdM : Comment une banque d’affaires ou un investisseur entrepreneur intervient dans l’univers agroalimentaire et plus particulièrement dans la filière produits de la mer ?
Raphaël Brenier : Nous sommes une équipe de huit personnes qui a accompagné depuis 2004 plus de 65 clients sur leurs opérations de croissance externe, de cession et de levée de fonds. En 2016, nous avons réalisé sept opérations et une quinzaine de missions sont en cours, dont un tiers dans l’agroalimentaire. Nous travaillons en particulier sur des opérations de haut de bilan et de financement de PME qui ont une valorisation comprise entre 5 et 100 millions d’euros. La filière produits de la mer rentre dans notre champ d’action depuis six ans, avec notamment la réorganisation du capital d’un gros acteur du mareyage. La réflexion a porté sur l’évolution de la filière et sur l’ouverture possible du tour de table à des acteurs étrangers ou à des investisseurs financiers. Aurignac a également conseillé le groupe Pomona dans la cession de son activité mareyage. Un des dossiers en cours concerne un transformateur positionné sur une technologie innovante.
Jean-Pierre Rivery : Historiquement actif au sein du groupe Diana, j’ai recréé en 2014 une activité industrielle à partir de Picama, holding centrée sur les ingrédients marins. Polaris est spécialisé dans les oméga 3 à partir d’huile de poisson purifiée. Nutrifish, dont je suis un des quatre actionnaires industriels, a investi 15 millions d’euros pour extraire du cartilage, du collagène, des peptides pour la nutraceutique et la cosmétique, à partir de coproduits de poisson. À côté, j’ai un projet sur des plantes halophytes sélectionnées, mises en culture bio chez des maraîchers, et à partir desquelles nous allons extraire des actifs, notamment des antioxydants. J’ai investi également en nutrition santé dans Effinov qui fait des compléments alimentaires, dont certains à partir de peptides de poisson. Toute cette panoplie de produits vient en fait de la mer. L’idée est de cibler des entreprises du Grand Ouest dans le domaine marin, créer de la valeur en mettant la main sur le sourcing, transformer sur place et aller à l’international. Les 50 % de poisson qu’on jetait hier après la découpe peuvent se vendre demain plus cher que le filet lui-même.
2- Le mareyage est en pleine mutation. Il y a des opportunités de reprise. Quel profil d’entreprise intéresse un investisseur ?
R. B. : Un des axes essentiels est l’accès à la ressource. Les mareyeurs ont trois moyens de capter du poisson. Être omniprésent à l’achat sous les criées, en particulier en Bretagne, en Normandie et en Vendée, car Boulogne est surtout une porte d’entrée du poisson nordique. Cela concerne au premier chef les gros mareyeurs. L’autre possibilité est de passer des accords avec les pêcheurs, soit capitalistiques en prenant des participations dans des bateaux, soit à travers des contrats-cadres portant sur un certain volume mais sans engagement réel.
La troisième option est d’aller s’approvisionner à l’international.
La différenciation par la transformation avec un savoir-faire particulier en filetage manuel ou en conditionnement d’un poisson de ligne expédié le jour même dans une capitale peut susciter l’intérêt pour un petit mareyeur pointu dans son domaine.
3- Comment nouer des relations avec les mareyeurs, fournisseurs de coproduits ?
J.-P. R. : Le sourcing se construit sur des partenariats durables. C’est important par rapport à la qualité de la matière première. Cela suppose d’aller dans les entreprises expliquer pourquoi les coproduits méritent le même traitement qu’un produit noble avec des bacs propres et tracés, de la glace, un stockage au froid. Tout de suite, la qualité s’améliore, la valeur augmente.
4- Aider un mareyeur à investir dans le froid devient rentable ?
J.-P. R. : Oui, nous avons fait le pari de produire à 100 % en qualité alimentation humaine. Cela signifie aussi investir et payer un peu plus cher son fournisseur. Le travail doit être valorisant pour tout le monde.
Pour revenir aux cessions d’entreprises de marée, qu’est-ce qui peut bloquer un investisseur ?
R.B. : La très forte dépendance de l’entreprise à son dirigeant. Surtout s’il détient la maîtrise des approvisionnements à travers ses relations historiques avec les pêcheurs. C’est problématique si rien ne garantit au repreneur qu’au départ de l’ancien dirigeant, les pêcheurs n’iront pas voir ailleurs. Autre élément lié à l’environnement de travail, si la tenue des ateliers et les pratiques de transformation ou les normes sanitaires laissent à désirer, le repreneur peut s’abstenir. Citons encore la dépendance, ou non, à un gros client ou à quelques clients ; l’équilibre du portefeuille est très important.
J.-P. R. : Ce n’est pas évident dans les petites entreprises, souvent très liées aux personnes qui les ont créées. C’est contraignant lors d’une reprise ou d’une fusion de deux entreprises. Il faut organiser la transition et ce n’est pas forcément facile.
R. B. : Le meilleur repreneur est souvent celui qui connaît bien le secteur et l’entreprise elle-même, soit comme salarié ou en tant qu’entreprise concurrente. Un nouvel actionnaire, quel qu’il soit, aura intérêt à s’appuyer sur une équipe expérimentée. La connaissance du marché et des clients est absolument indispensable.
Alors que les niveaux de marges sont faibles dans le mareyage et l’agroalimentaire en général, quel retour sur investissement peut attendre un repreneur ?
R. B. : Il est rassurant de voir que les niveaux de rentabilité peuvent être très corrects dans la marée. Et cette rentabilité repose sur des éléments basiques : positions fortes sur les criées, bonnes relations avec les armements, la main sur des spécificités comme les crustacés et les coquillages, des complémentarités géographiques et de gammes de produits.
5- À quel taux de marge s’attendent les fonds d’investissement dans la filière produits de la mer ?
 |
|
Jean-Pierre Rivery Président de Picama, holding spécialisée dans les ingrédients marins à travers Polaris (huile de poisson), Effinov (compléments alimentaires) et Nutrifish (valorisation de coproduits en alimentation humaine). Également président d’IDMer. |
R. B. : Il est illusoire d’attendre plus de 10 %. L’ordre de grandeur se situe entre 3 et 5 %, mais plus que le niveau de marge, c’est la régularité qu’attendent les investisseurs.
J.-P. R. : Les fonds ont le pouvoir de structurer, d’organiser et de faire grandir une société. L’effet de taille est particulièrement intéressant.
R. B. : Le mareyage est un secteur traditionnel où les opérateurs sont des experts de leur métier mais l’investissement vers la valeur ajoutée suppose de se projeter à cinq ou dix ans, ce que ne favorise pas le contexte économique. D’une façon générale, les mareyeurs sont bons sur leurs produits mais moins sur le marketing et là, les fonds ont des propositions à faire.
6- La reconstitution des stocks dans les eaux européennes crée-t-elle une hausse de valeur du capital halieutique ?
R. B. : Sans aucun doute, mais j’ai la vision franco-française sur ce sujet-là. Et quand on consulte des opérateurs étrangers sur des opérations françaises dans le mareyage ou la transformation, la première question posée est celle de leur accès aux quotas. À qui appartiennent-ils ? Et là, le bât blesse sur le fait qu’ils n’appartiennent à personne. Quand un gros opérateur canadien rachète un des premiers producteurs de saint-jacques écossaises, il rachète un droit de pêche, un capital en stock dans l’eau.
7- N’y a-t-il pas un danger, pour une filière qui a déjà du mal à se projeter, que des fonds d’investissement viennent piocher à court terme puis s’envoler ensuite ?
R. B. : Dans beaucoup de secteurs, les fonds d’investissement portent une image un peu négative mais cela peut aussi se passer correctement. La marée française a de l’avenir, de vrais atouts, mais elle a besoin de capitaux pour financer sa structuration et des outils de transformation.
J.-P. R. : Sur des entreprises familiales comme le mareyage, les fonds ont vraiment un rôle à jouer pour agrandir, structurer et rassurer aussi. Mais savoir rentrer est une chose, savoir sortir en est une autre. Mieux vaut éviter la succession de fonds sur des fonds pour revenir à une réalité industrielle. Un fonds peut néanmoins être un bon passage de témoin dans la marée, en posant les bonnes questions et pour mettre en valeur un savoir-faire. Surtout lorsque ce sont des fonds spécialisés qui connaissent le milieu.
8- La transformation de produits de la mer peut-elle attirer des capitaux ?
R. B. : Oui, si elle s’appuie sur des process innovants. En poisson frais, l’enjeu est celui de la DLC et l’allonger, par exemple grâce aux hautes pressions, devient extrêmement intéressant. D’autres applications comme le décorticage viennent en complément. Il y a aussi des innovations sur le packaging qui sont créatrices de valeur.
J.-P. R. : Avoir des process qui permettent de sortir les meilleurs ingrédients du poisson est une première phase. La seconde est de savoir les vendre et les mettre en marché.
9- Quels niveaux de marges peuvent procurer des collagènes ou des phospholipides sur les marchés d’ingrédients santé ?
J.-P. R. : Nous devons créer de la valeur. Qu’elle soit de 10 ou 15 %, l’essentiel est de la pérenniser et surtout de valoriser une matière qui ne l’était pas auparavant. Après, les ingrédients rentrent dans une gamme qui fait leur force.
10- Le coproduit marin génère-t-il plus de valeur que le coproduit végétal ?
J.-P. R. : Non, les deux en créent s’ils sont de qualité au départ pour aboutir à un produit actif intéressant. Tout ce qui touche à la nutrition santé est dans l’air du temps, encore plus si cela vient de la mer. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir des volumes car la recherche, l’innovation et l’extraction représentent des coûts.
11- La hausse des prix réactive-t-elle l’investissement en aquaculture ?
R. B. : Nous ne nous sommes pas penchés jusqu’à présent sur les entreprises aquacoles. Nous pourrions orienter des investisseurs vers elles car la croissance de l’aquaculture est plus rapide que prévu mais ce sont des métiers très techniques, qui peuvent paraître risqués aux yeux des investisseurs classiques, en particulier à cause des questions sanitaires. Les cycles de production sont également longs et donc gourmands en capital. Les investisseurs interviendront plus facilement dans le cadre d’un regroupement de sociétés aquacoles qui se dote d’une usine de transformation plutôt que sur une infrastructure d’élevage en démarrage ayant un besoin de financement.
J.-P. R. : En tant que fournisseur d’ingrédients, j’ai beaucoup travaillé sur l’aquaculture à l’international et je vous rejoins sur ces questions d’investissements. La France est bien armée en recherche et en ingénierie aquacole mais jusqu’à présent, nous avons surtout accompagné des projets à l’étranger.
12- Algues, insectes et biotechnologies suscitent de l'innovation et attirent les capitaux. Le mouvement est-il durable ?
J.-P. R. : Il existe de nombreuses micro-entreprises éparpillées dans ces domaines mais elles devront se consolider, se rapprocher, changer de dimension ou rentrer dans des projets collaboratifs. Une niche, plus une niche, plus une niche, cela finit par faire un vrai métier. En ce sens, le rôle d’ID Mer est de fédérer les centres techniques bretons sous Act Food. L’ensemble permet de croiser les compétences que ce soit du carné, du végétal terrestre, des algues, des coproduits marins, dans des domaines techniques et en process. Le terreau est favorable en Bretagne. La Région soutient les projets et des fonds d’investissement locaux du type Breizh Up les accompagnent. Go Capital également, en tant que fonds partenaire de la Région. J’attire cependant l’attention : innover, c’est bien ; lever des fonds, très bien ; mais le projet doit rapidement s’exécuter.
13- Les investisseurs regardent-ils si les collectivités ou l’Europe portent aussi un projet ?
R. B. : C’est une composante mais pas l’essentiel. Ils regardent avant tout si l’activité est porteuse et quel est son potentiel. Si des compétences peuvent se mettre en commun, c’est un atout intéressant. Car les investisseurs n’ont pas forcément conscience des complémentarités entre métiers, par exemple entre mareyage et valorisation des coproduits ou mareyage et activité de première mise en marché d’autres produits alimentaires.