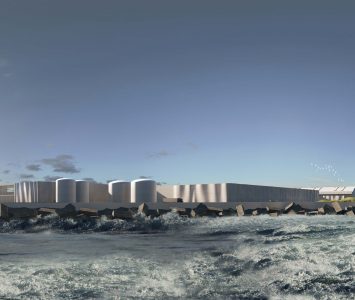L’aquaponie, production en symbiose de poissons et plantes, passe du rêve à la réalité : reconnaissance comme métier émergeant, lancement en janvier prochain de la première formation certifiante, structuration avec la remise en route de la Fédération française d’aquaponie… et un tout premier salon dédié, où toutes ces belles énergies ont convergé.
Vendredi 9 octobre à Louverné, près de Laval, le tout premier Salon de l’aquaponie se tient sur le magnifique parc Echologia. Alors que les événements sont annulés en chaîne, ce pari osé d’Aquaponia, exploitant du site, est un franc succès. Dans une salle comble, des scientifiques exposent leurs travaux sur l’aquaponie, des exploitants témoignent de leur expérience. Et le public boit leurs paroles : quelque 200 personnes, dont la moitié de porteurs de projets en aquaponie. Il y a une belle mixité hommes-femmes chez ces jeunes candidats à l’installation, comme chez les fournisseurs en mode start-up, animés d’un enthousiasme rafraîchissant. Dans les allées de ce lieu verdoyant, qui cumule accueil touristique et pédagogie, le showroom attire l’œil, avec quatorze systèmes aquaponiques différents destinés aux professionnels ou au grand public, que le salon accueillera dans le week-end.
Toute cette émulation est révélatrice du dynamisme autour de l’aquaponie. Cette activité de production en symbiose d’animaux aquatiques et de plantes est en plein essor. Sa reconnaissance dans la short-list des métiers émergeants est un signal fort. Le dossier avait été déposé par Echologia auprès de l’instance France compétences en 2019, parmi 107 organismes de formation ayant fait la même démarche pour 227 métiers. Seuls 17 ont été retenus, dont ouvrier et technicien supérieur en aquaponie. Cette belle réussite n’est qu’une étape. Suite logique : la formation, pour aller au-delà des initiations proposées par des exploitants et bureaux d’études. Echologia a donc proposé des formations continues d’ouvrier et technicien supérieur en aquaponie, validées par l’État début 2020 et inscrites au répertoire national des certifications professionnelles. La première promotion démarrera en janvier 2021.
Ce salon est tout trouvé pour recruter des candidats à l’installation, mais aussi leur faire prendre conscience des défis qui les attendent : complexité technique, démarches réglementaires, investissement financier, délai avant de tirer un salaire… Ce métier fascine, souvent pour des reconversions professionnelles, mais pour certains, c’est la douche froide à entendre les études technico-économiques. L’espoir regonfle à l’écoute des exploitants, même s’ils ne cachent pas leurs difficultés. Richard Dittmer, ex-ingénieur automobile, a eu le déclic en découvrant l’aquaponie il y a trois ans : « C’est ce que je voulais faire. » Sa ferme Fish’n’Veg est en construction dans les Yvelines. « C’est beaucoup de travaux, 1 700 mètres de tuyaux, 2 500 raccords PVC, du bois, du gravier, des parpaings. Je me suis retrouvé avec des croisements impossibles de tuyaux, un manque de place de stockage… Il y a intérêt à anticiper avec des plans très détaillés. » À la ferme De l’eau à la bouche, montée par cinq associés il y a cinq ans, « les débuts ont été difficiles, témoigne Paola Biton, cofondatrice et exploitante. Sur 900 m2 de serres, à trois personnes, on produit de la truite, fumée, et du végétal, qui pèse une grosse part du chiffre d’affaires. On visait le modèle des paniers, mais on alimente maintenant des restaurateurs étoilés en mini-légumes, jeunes pousses, fleurs et légumes. »
Des bureaux d’études, souvent lancés par les pionniers de l’aquaponie en France, accompagnent le montage de projets. Aquaponie France, fondé par Pierre Harlaut, aussi connu pour son site aquaponie.fr, conçoit des projets jusqu’à 2 500 m2, plutôt low-tech, activité cumulée avec de la formation, une boutique B2B et B2C et de la R&D autour de l’aquaponie et de la permaculture. Le bureau Urban Leaf de Marie Fiers, auteure de L’aquaponie en pratique, accompagne les porteurs de projets en aquaponie et agriculture urbaine, de la conception à l’assistance à maîtrise d’ouvrage. En plus de la formation et de la fourniture de petites unités aquaponiques aux écoles et particuliers. La Ferme aquacole d’Anjou conjugue pisciculture d’étang et en bassins, aquaponie, fourniture d’unités pour les particuliers et de démonstrateurs et réalisation de sites (comme Les jardins du Saumonier à Cherbourg, et Asnières-sur-Seine pour AMP Saumon de France). Les associés à l’origine de la ferme aquaponique Eauzons! sont à la tête à Toulouse de Bioponi (bureau d’études) et d’Hydroccitanie (équipements et montage), et représentants des fournisseurs Filclair, leader français sur les serres en plastique, et H2Hydroponics, équipementier assez high-tech. Enfin, Grégory Biton, cofondateur de la ferme De l’eau à la bouche, dirige le bureau Aquaponie.net, qui accompagne la réalisation de fermes.
Des structures publiques sont aussi des appuis, comme les chambres d’agriculture. Celle des Pays de la Loire se rapproche d’ailleurs du Smidap, centre technique régional d’appui aux filières pêche et aquaculture, autour de l’aquaponie. L’institut technique Itavi est aussi une ressource précieuse. Il mène 22 projets de R&D chez les aquaculteurs : « Aquaculture multi-trophique, pisciculture d’étang, aquaponie, incorporation d’insectes dans l’aliment, bien-être en élevage, plan de progrès en salmoniculture, suivi sanitaire des zones, veille réglementaire…, liste Aurélien Tocqueville. Des travaux rendus publics. »
Des fournisseurs de l’aquaculture se penchent aussi sur l’aquaponie, comme le fabricant d’aliments Le Gouessant Aquaculture, et Ynovea, qui produit des aliments naturels à base d’insectes, en Corrèze. D’autres font plutôt partie du paysage agricole : CERFrance (comptabilité et conseil en gestion), Terra Aquatica (solutions organiques pour l’hydroponie), Koppert (leader mondial des alternatives aux pesticides comme les insectes auxiliaires, phéromones, biostimulants). Et des start-up se frayent un chemin, comme Eautours, qui a breveté pour l’aquaponie et l’hydroponie un système de production verticale modulaire à base de polypropylène alvéolaire. « Léger, transportable à plat, il s’intègre dans de nombreux design, avec ou sans substrat », argumentent les quatre jeunes associés.
Ces structures ont parfois des visions de l’aquaponie qui divergent, notamment sur le degré de technologies à mettre en œuvre : systèmes couplés ou découplés, low-tech ou high-tech... « L’objectif du salon est de se faire rencontrer les acteurs, d’en finir avec la guerre des clochers et s’unir, dans notre diversité », plaide Guillaume Beucher, co-fondateur d’Aquaponia et Echologia. « Il faut une vraie structuration de la filière pour construire un cadre réglementaire adapté à cette activité, à la croisée des modèles », ajoute Aurélien Tocqueville. C’est un des gros enjeux du salon. La Fédération française d’aquaponie (FFDA), créée en 2017, mais alors plutôt tournée vers les particuliers, dispose de peu de moyens et de forces vives : juste une quinzaine d’adhérents sur 90 historiques. Son président, Laurent Queffelec, exploitant de la Ferme aquaponique du Cotentin, l’assume avec humilité : « Nous n’avons pas la légitimité pour représenter la filière. Il faut redéfinir nos missions autour des attentes des professionnels. » Il a succédé à Pierre Harlaut en février 2020 : la fédération a alors revu sa gouvernance et ses statuts, et a décidé de ne représenter que l’aquaponie professionnelle.
Le samedi matin du salon, encore limité aux professionnels, est donc consacré à un atelier pour élaborer la nouvelle feuille de route de la FFDA. Plus d’une centaine de personnes répartie en petits groupes définit et hiérarchise des priorités d’actions, notes à l’appui pour une synthèse objective. Les participants estiment d’abord urgent d’adopter une définition claire de l’aquaponie, acceptable pour ses acteurs et sans trahir la philosophie du système, qui se veut écologique. « S’accorder sur une définition commune n’est pas simple, souligne Guillaume Beucher. Depuis 2014, à Aquaponia, nous présentons au public des poissons et des plantes cohabitant en symbiose, avec une recirculation de l’eau, en vantant les économies d’eau et d’énergie, les déchets des uns nourrissant les autres. Ça plaît, et c’est vrai, c’est génial, mais aucun système aquaponique n’est complètement fermé, et il y a des biais à le faire industriellement. Il faut une reconnaissance de l’aquaponie par le grand public avec une présentation claire, sans cacher les intrants, pour éviter que les gens aient l’impression d’avoir été bernés, et se retrouver au détour d’un reportage avec une crise du saumon bis à la veille de Noël. »
Une fois l’aquaponie définie collectivement, la FFDA pourra établir un cahier des charges ou un guide de bonnes pratiques, créer une marque collective, voire un label. Le pôle Aquimer expose les différentes démarches à l’assemblée, qui s’interroge : veut-on valoriser la qualité finale ou le mode de production ? S’inspirer de la charte qualité Aquaculture de nos régions du Cipa ? Jouer la production locale via des marques régionales collectives ? Intuitivement, les acteurs veulent se rapprocher du bio. Mais la production en eau recirculée est exclue du règlement européen bio et le modifier est un défi à long terme…
Autre urgence pour la FFDA, faire du lobbying sur les questions réglementaires et de financement. Les pisciculteurs le savent, il faut régulièrement se battre : une norme sur le repeuplement a failli faire couler 95 % des piscicultures d’étang… La liste des chantiers est longue : autoriser l’aquaponie sur des terres non agricoles ; optimiser le recours aux subventions publiques (noyé entre fonds Feamp, Feader, régionaux…) ; élargir la liste des espèces autorisées (notamment au tilapia, ni autorisé ni interdit, qui nécessite une autorisation préfectorale) ; revoir le seuil de 20 tonnes pour les installations piscicoles classées, même si la plupart des projets se situent bien en-deçà. Et établir un cadre réglementaire sur les rejets : « On est sur la ligne rouge », alerte Laurent Queffelec. Face à cette épée de Damoclès, la FFDA a tout son rôle à jouer, pourquoi pas en ralliant la Fédération française d’aquaculture (FFA), qui dispose déjà de l’écoute des autorités.
Le brainstorming révèle aussi un fort besoin d’accompagnement des porteurs de projets : annuaire, compilation de données technico-économiques, visibilité sur les guichets de subventions, partage d’expérience, lettre d’information, harmonisation des process des bureaux d’études, orientation des travaux de recherche et diffusion des résultats. Et certains sollicitent des relais régionaux pour avoir des interlocuteurs proches. À l’image de l’association toulousaine d’aquaponie. « C’est un réseau d’entraide avec toutes les compétences : fermes, bureaux d’études, équipementiers », liste Patrice Astre, son président, qui, après 30 ans de pisciculture, a monté un bureau d’études en aquaponie. Cet ancrage local a ainsi permis de mettre en relation des municipalités ayant des sites disponibles et des entreprises.
Mais il s’agit aussi de ne pas trop se disperser face à toutes ces ambitions. « La FFDA n’existe que par ses adhérents », rappelle Laurent Queffelec, appelant au soutien de toutes les parties prenantes. Les rangs devraient grossir. « L’aquaponie va se multiplier dans les dix ans, elle attire les jeunes, se réjouit Jean-Yves Colleter, président de la FFA. C’est l’avenir. »
Solène LE ROUX
| ❱ Hors sol, mais les pieds sur terre | |||
|
Guillaume Beucher, |
L’aquaponie est enseignée en formation initiale, comme au lycée Olivier Guichard de Guérande, avec 50 heures en bac pro aquaculture et 80 heures en BTS. L’école intervient aussi dans la licence professionnelle d’agriculture urbaine à l’université de Nantes. À Nancy, l’enseignant-chercheur Fabrice Teletchea sensibilise à l’aquaponie ses élèves en licence aquaculture continentale et aquariologie. Et l’Agrocampus ouest propose un court module dédié. En formation continue, il n’y avait jusqu’ici que de courtes formations. Par exemple, cinq jours à Echologia sur la conception d’une installation. « Ça permet de dégrossir le terrain, on ne peut pas former quelqu’un en deux jours et le jeter dans l’arène du lion, les porteurs sont paumés, observe Guillaume Beucher. Ce métier réunit trois domaines, pisciculture en eau recirculée, horticulture-maraîchage en hydroponie, ce qui est déjà de la haute technicité, et chimie. Tout en étant hydraulicien et chef d’entreprise… C’est pourquoi on a tenu à organiser une formation solide. » Avec celles d’ouvrier et de technicien, reconnues par l’État, qui débutent en 2021, « les élèves seront formés de A à Z sur les cinq domaines ». Le BTS se déroule dans trois structures associées. Surtout à Echologia (Mayenne), ferme pédagogique atypique où l’aquaponie y est expérimentée sous différentes formes, avec près d’une vingtaine d’espèces aquatiques : écrevisses, omble de fontaine, omble chevalier, truite fario… « On veut aussi tenter le sandre, le silure, le black bass. Le cadre se prête à créer un terreau fertile pour l’aquaponie. Mais voir une vraie ferme, qui tourne, c’est important. » D’où l’envoi des élèves chez Les Sourciers (Occitanie), ferme hydroponique, et à Aquaponie.net (Gironde), bureau d’études combiné à la ferme De l’eau à la bouche. Le BTS représente 595 heures de formation obligatoire, dont sept semaines de stage et 210 optionnelles, pour un coût de 10 500 euros, éligible au compte personnel de formation et d’autres financements (Opco, Vivea, Pôle emploi, régions). « La formation fait partie de l’investissement dans son projet, pour acquérir des connaissances, mais aussi un réseau. Et un titre certifiant est plus crédible auprès d’une banque qu’une attestation. » Les élèves seront accompagnés sur leur projet, présenté à l’examen final. « On va les challenger. Puis ils pourront compter sur nous. On espère qu’ils s’installeront, et qu’à leur tour ils accueilleront des stagiaires. C’est ainsi qu’on bâtira la filière. » |
||
| ❱ Plutôt low-tech ou high-tech ? | ||
|
Laurent Queffelec estime sa Ferme aquaponique du Cotentin low-tech. « J’enrichis le moins possible mon eau. Un peu de fer, de correcteur de pH, pas d’oxygène. J’essaie d’avoir un système en équilibre, les plantes et poissons font des compromis ! C’est moins productif mais j’ai peu de charges, le but est de sortir deux salaires. Ce modèle est bien perçu par les clients. Le système, sur 1 000 m2, reste assez fermé, et on sédimente nos boues. Avec l’automatisation, j’aurais peur que ça m’échappe. » |
||
| ❱ Vous avez dit symbiose ? | ||
|
Performances, rentabilité, degré de technicité… Ça phosphore en France comme en Belgique autour de l’aquaponie.
L’aquaponie se réapproprie de vieux concepts : tilapia en riziculture, pisciculture d’étang… Elle associe généralement aquaculture en eau recirculée, culture maraîchère hors sol et traitement d’eau, optimisant l’espace et les transferts entre compartiments. « Des éléments peuvent s’accumuler et devenir toxiques », préviennent Pierre Foucard et Victor Dumas, qui conduisent le programme Apiva (aquaponie innovation végétale et aquaculture) à l’Itavi, avec des pilotes à l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae) et au lycée de Lacanau. Le degré d’ouverture du système conditionne les facteurs limitants, donc les technologies. Plus il faut d’eau par kilo d’aliment produit, plus le système est ouvert et low-tech. Par exemple, à 100 m3/kg, un brassage de l’eau suffit. Vers 40 m3/kg, l’eau trop chargée en particules et CO2 nécessite une filtration mécanique, un dégazage du CO2 et un apport d’oxygène dissous. À 5 m3/kg, l’ammoniac s’accumule : il faut une filtration biologique. Puis recourir à la désinfection UV ou ozone, la déshydratation des boues… |
||