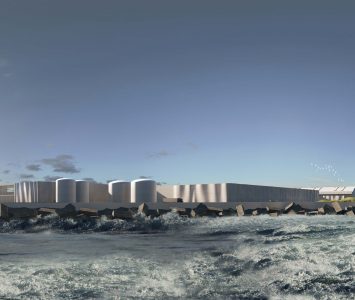Espèces marines rares, convoitées, braconnées : comment déjouer les trafics illégaux ? S’assurer d’approvisionnements irréprochables ? Quelles alternatives pour se différencier ? Concombres de mer, ormeau, oursin, civelle-anguille, palourde, thon rouge… Le circuit peut être très court, du plaisancier au restaurateur du coin. Ou complexe avec des gangs organisés à l’international. Les victimes : la ressource, mais aussi les professionnels honnêtes face à cette concurrence déloyale.
|
Jacques Doudet - Secrétaire général du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne « Durant longtemps, trafiquer des produits de la mer rapportait gros, sans trop de risque. Les choses ont changé. » |
Guillaume Sellier – Directeur interrégional de la mer Nord Atlantique Manche ouest (Dirm Namo) « Nous avons mis l’accent sur la lutte contre le trafic et nous continuerons, afin que tous comprennent que l’administration est déterminée à agir jusqu’au bout. » |
Thierry Quéméner – Président de la commission milieux estuariens et amphihalins (CMEA) au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) « En quoi envoyer la civelle en Asie est plus préjudiciable à l’espèce que de la vendre en Espagne ? » |
 |
 |
 |
||
|
Vanessa Lhotellier -Directrice commerciale des Viviers de Saint-Marc « On se retrouve sur un double marché : aujourd’hui des plaisanciers pêchent en plein jour des ormeaux et les revendent à moitié prix à la restauration. » |
Olivier Canonne, responsable développement durable de Sysco France « Un point d’avenir, face aux trafics internationaux comme en France, c’est la technologie blockchain, déjà utilisée sur le saumon et le thon. »
|
Charlotte Nithart – Présidente de l’association Robin des Bois « Les lieux de transit pour l’engraissement sont des points sensibles où le blanchiment est favorisé. »
|
2- Quel rôle jouent les mareyeurs dans ces circuits ?
SOMMAIRE :
1- Quels sont les modes d’action du braconnage d’espèces marines sensibles ?
4- Du côté de Sysco, comment vous assurez-vous que vos achats proviennent d’une pêche légale ?
7- Quelles sont les espèces marines braconnées à l’international impliquant ainsi la France ?
1- Quels sont les modes d’action du braconnage d’espèces marines sensibles ?
Charlotte Nithart – Les réseaux sont très diversifiés. Ça va de pêcheurs « de loisir » qui vendent en direct aux restaurants, aux gangs internationaux avec des ramifications lointaines – Vietnam, Chine – où il est très difficile d’agir. Les prix sont très hauts, parfois plusieurs milliers d’euros le kilo, que ce soit les civelles, concombres de mer, ormeaux, thons, tortues marines, hippocampes… Les réseaux sont réactifs pour déjouer les contrôles. La lutte contre les trafics fait intervenir tous les échelons : les vigies de terrain que sont les pêcheurs respectant la réglementation, les conventions et actions internationales… Le cas de la civelle est intéressant, vu sa raréfaction et son prix. Même si la pêche aujourd’hui est encadrée, les efforts seront vains s’il y a une relâche des contrôles.
Thierry Quéméner – J’ai pêché la civelle durant 38 ans. Après une diminution, maintenant les bateaux en voient énormément. On a drastiquement limité l’effort de pêche, passant de 1 400 bateaux à 413 en quelques années. La nature a horreur du vide. Les filières mafieuses se sont installées et les braconniers sont si virulents qu’on leur laisse du terrain. La profession veut des contrôles. C’est compliqué car on a des points de débarque multiples. Depuis deux ans, des lieux sont annoncés en début de saison, et contrôlés. Il y a des fiches de pêche, une pesée à bord, on ne va pas à son véhicule si on n’a pas estimé le poids à 300 grammes près ; c’est strict. On a balayé devant notre porte et on aura du mal à faire mieux. Nos détracteurs voudraient que la pêche ferme, mais on doit exercer pour endiguer le braconnage. On ne comprend pas que l’Europe ait fermé l’exportation en Asie, très demandeuse de poisson à 3 500 euros le kilo, soit un euro la civelle ! On avait 12 à 15 tonnes de marché légal sur la Chine, que le marché illicite a repris. En quoi envoyer la civelle vers l’Asie est plus préjudiciable à l’espèce que dela vendre en Espagne ? Une filière traçable à l’export permettrait de financer le repeuplement. Par le passé, la civelle a transité par des élevages nord européens, revendant en Asie. On a supprimé les contrats intercommunautaires (CIC) qui permettaient la traçabilité en Europe, c’est incohérent.
Charlotte Nithart – Le trafic était antérieur à l’arrêt de l’export légal. Il y avait trop de civelles braconnées partant vers les élevages en Chine ou au Japon. La Cites a inscrit les civelles et anguilles à l’annexe II pour les soumettre à un contrôle du commerce. Puis les pays européens, face à une chute des effectifs de civelle et l’impossibilité de tracer le commerce, ont interdit l’export hors Union européenne. Forcément, il y a eu des effets d’opportunisme, mais le trafic existait déjà. La traçabilité est plus facile à assurer entre la France et l’Espagne qu’avec l’Asie. Pour les CIC, je vous rejoins, c’est dommage de les avoir retirés. Et en effet depuis au moins 15 ans la profession fait le ménage, c’est un cas exemplaire, les pêcheurs sont volontaires, et parmi les plus contrôlés.
Thierry Quéméner – Oui, les trafics ont toujours existé, pour toutes sortes de poissons. C’est la nature humaine. On peut faire tous les contrôles qu’on veut, les filières mafieuses rebondissent vite, et ce qui est exfiltré, c’est toujours une trentaine de tonnes sur la Chine.
Jacques Doudet – Pour élargir aux autres espèces, ce cas montre quatre éléments importants dans la lutte contre le trafic organisé à grande échelle. D’abord, la différence de perception entre une ONG, dénonçant de gros trafics internationaux, et le pêcheur dans une filière bien gérée : ça soulève des incompréhensions. Les règles internationales frappant tout le monde peuvent paraître disproportionnées aux acteurs locaux. Ensuite, il n’y a pas de transparence sans traçabilité, c’est indispensable. Et pour la civelle ça a été compliqué, un outil spécifique a été créé, télécacivelle, pour déclarer quasiment à l’heure près ce qui est pêché. L’application devenue télécapêche a été étendue à d’autres espèces. De plus, Thierry (Quéméner) l’a dit : là où les professionnels ne vont plus, malheureusement, ça laisse la place aux trafiquants. La présence continue de professionnels, dans un cadre réglementé, limite les trafics. Enfin, durant longtemps, trafiquer des produits de la mer rapportait gros, sans trop de risque. On se prenait une petite contravention et on continuait. Les choses ont changé. Maintenant, les infractions de pêche relèvent du tribunal correctionnel, ça change d’ambiance. J’ai suivi de nombreux dossiers, dont des affaires mémorables, et depuis dix ans il n’est plus rare, pour des récidivistes, de voir des peines de prison et des amendes très lourdes. Récemment, au tribunal correctionnel en Bretagne, un braconnier a eu de la prison ferme et un mareyeur une amende de plusieurs milliers d’euros.
Guillaume Sellier – Le braconnier est comme un agent économique qui calcule l’intérêt à sortir selon le volume espéré, le prix de vente, la probabilité de se faire prendre et l’amende qu’il risque. Cela concerne à peu près toutes les espèces réglementées. J’ai travaillé dans le Morbihan de 2000 à 2004, avec une unité de lutte contre le braconnage. Il y en a de plusieurs types. L’individu qui dispose de toutes les autorisations de pêche professionnelle et se fait un peu de gras en plus, et rentre dans le rang au premier procès-verbal. Celui à qui il faut deux ou trois procédures. Et enfin celui qui a ça dans le sang et le fera toute sa vie, même après les peines les plus lourdes. J’en ai connu un en régime de semi-liberté qui braconnait en journée et revenait en maison d’arrêt le soir. On a envoyé de nombreux braconniers en correctionnelle avec de sévères condamnations, mais de retour sur la scène du crime 20 ans après, on en retrouve certains. Cette activité sans fin pose problème. Il est anormal qu’à côté des professionnels astreints à des règles, certains s’en moquent éperdument. Le risque est de produire une réglementation de plus en plus restrictive qui ne touche que ceux qui la respectent. Notre devoir est de veiller à l’application de l’encadrement de l’activité, pour obtenir le rendement durable maximum, et par principe d’équité des citoyens devant la loi. Nous avons mis l’accent sur la lutte contre le trafic et nous continuerons, afin que tous comprennent que l’administration est déterminée à agir jusqu’au bout. S’ils s’amusent à ce jeu, ils risquent d’y perdre gros.
Charlotte Nithart – Pour être efficace, il faut répartir la charge des contrôles et des réglementations sur les différents maillons. Ça se joue aussi au niveau des criées, mareyeurs, transformateurs, afin qu’un pêcheur arrivant avec un lot braconné soit mis à la porte. Ou que le mareyeur soit sanctionné s’il l’a accepté.
2- Quel rôle jouent les mareyeurs dans ces circuits ?
Guillaume Sellier – Cela varie selon les espèces, mais dans les affaires élucidées, des acheteurs (mareyeurs ou grossistes) indélicats mélangeaient les produits de trafics illicites aux circuits légaux. C’est du blanchiment. Ne faire que du recel de braconnage est très rare et très risqué. Au sein de la Dirm Namo, notre cellule de lutte contre ces trafics, à l’instar du trafic de stupéfiants, fait d’abord du renseignement. Une fois les réseaux identifiés, elle transmet le dossier au procureur de la République, qui souvent ouvre une information judiciaire. Cela a abouti récemment à la condamnation de quatre mareyeurs impliqués dans du trafic de civelles. La saisie des avoirs frauduleux est une arme très efficace. Il s’agit d’opérations interservices, impliquant l’Office français de la biodiversité, la gendarmerie nationale ou maritime, la douane, les Affaires maritimes et l’administration fiscale, tous sous l’autorité des parquets. En général il y a des redressements fiscaux. Pour la civelle, les réseaux sont internationaux. Une affaire a mis en cause des opérateurs britanniques et est suivie par Interpol. Mais les braconniers sont très agiles, la rapidité des réseaux à se réorganiser est sans commune mesure avec la capacité de réaction de l’administration, obligée d’intervenir dans un cadre procédural normé. Pour la civelle, comme par hasard, quand les frontières ont été fermées avec la Chine, l’export s’est massifié vers l’Europe de l’Est.
3- Vous avez évoqué le but de cette lutte : pour l’état des ressources et par principe d’équité. Sur ce point, du côté des acheteurs présents, subissez-vous la concurrence déloyale de produits issus de trafics ?
Vanessa Lhotellier – Tout à fait. Nous, en tant que mareyeur, on le subit sur l’ormeau de pêche depuis toujours. Peu à peu, parmi les fournisseurs, on s’est aperçu que l’un avait eu des histoires, puis un autre. Il faut tout le temps être sur le quivive, dans la vérification. Ça devient de plus en plus lourd, administrativement, mais aussi dans les rapports entre nous. Par exemple, quand mon pêcheur d’ormeau vient, on notifie la pesée, l’heure, et même si je l’aime beaucoup et que j’ai confiance en lui, je vérifie le document d’enregistrement, l’heure de marée, car il a pu faire une erreur de déclaration. Je dois faire cette double vérification en permanence, parce qu’on remonte les informations auprès de Visiomer, on doit être irré- prochable. Ça entache les relations commerciales avec nos partenaires et les liens se tendent. Je le vis au quotidien. Après, on se retrouve sur un double marché : aujourd’hui des plaisanciers pêchent en plein jour des ormeaux et les revendent à moitié prix à la restauration. C’est simple à repérer, ce sont les restaurants qui ne mettent pas l’ormeau à la carte, mais juste un jour en suggestion. Résultat, vous ne savez plus comment vendre vos ormeaux achetés légalement. Et vous dites à votre pêcheur, « aujourd’hui, n’en pêche pas trop, parce qu’on ne pourra pas l’écouler… » On fait tous les papiers, et à côté, le produit est distribué comme ça, et on rame commercialement. Franchement, au bout d’un moment, on n’a plus envie de distribuer le produit, ça nous écœure.
Thierry Quémener – J’ai pêché le bar de ligne au Croisic. On vendait très bien jusqu’aux beaux jours, puis en avril-mai, nos copains mareyeurs n’avaient plus le marché pour ces poissons de 700, 800 grammes, car il était pris par la plaisance. On a même vu une société de revente de bateaux de plaisance expliquer à ses clients que leur bateau serait rentabilisé en deux ans avec la vente du bar aux campings et restaurants. J’étais atterré.
Vanessa Lhotellier – C’est ce qu’on retrouve sur les ports, ça fait peur. Les plaisanciers pêchent comme ils veulent et se font leur billet tous les mois. Ça devient un petit marché bien organisé.
Guillaume Sellier – La pêche plaisancière est un sujet différent. Souvent on a un maillage très diffus, impliquant de nombreuses personnes et une commercialisation très éclatée. Avec un outil réglementaire pauvre, car le code rural ne limite pas précisément la pêche plaisance. Souvent, les gens pris avec des captures anormales défendent une consommation personnelle. Lorsque j’étais directeur du parc naturel régional de Port-Cros, en lien avec le comité des pêches et les associations de pêcheurs plaisanciers, nous avons défini des plafonds journaliers pour les principales espèces. Du coup, c’est binaire. Si le plaisancier a droit à trois pagres par jour et qu’il est pris avec un de trop, c’est 1 500 euros. Ce type d’initiative donne un cadre solide aux unités de contrôle pour intervenir, avec des suites pénales quasiment garanties, et ça responsabilise. Le parc national des Calanques a engagé la même démarche. C’est important car en Méditerranée, le prélèvement de certaines espèces par la pêche plaisancière non déclarée nuit à la gestion de la ressource. La durabilité des pêches est inscrite dans le projet de plan d’action du document stratégique de façade Nord Atlantique Manche Ouest. Cette pêche plaisancière occulte fait du tort, en commençant par les mareyeurs qui paient des charges et sont soumis à des règles sanitaires drastiques. Il ne faut pas se faire d’illusion, on ne montera pas des opérations du même acabit que celles contre des trafics très ciblés comme la civelle ou certains coquillages, qui nécessitent des moyens humains colossaux. Mais limiter les captures pour la pêche de loisirs est un moyen simple et efficace de freiner ces comportements, pour que l’économie confidentielle n’altère pas le circuit économique légal, tout en permettant la pêche de loisir en toute quiétude.
Charlotte Nithart – Lors de Grenelles de la mer ou de l’environnement, on a demandé des permis de pêche de loisir pour encadrer l’activité. Les seuls soutiens venaient des pêcheurs professionnels, sinon ça a été une levée de boucliers, des élus littoraux nous mena- çant d’émeutes populaires. Il faut encadrer les pêcheurs de loisir. de plus en plus nombreux qui impactent la ressource et créent de la concurrence déloyale. Et il faut des peines efficaces à l’encontre des restaurateurs concernés, surtout les récidivistes, avec des saisies. Là, l’information passe. Récemment à Marseille, quatre braconniers dans le parc des calanques ont été condamnés à environ 400 000 euros de dommages et intérêts et 35 000 euros au titre du préjudice écologique. Mais les cinq poissonniers et restaurateurs, clients réguliers pour des milliers d’oursins, n’ont été condamnés qu’à 3 000 euros d'amende. Ce n’est absolument pas dissuasif, c’est même ridicule.
Vanessa Lhotellier – Alors qu’on sait pertinemment qu’il y a plein d’acheteurs concernés. Ce qui nous gêne, c’est que tout le monde le sait, mais il y en a un sur dix qui est pris. Certains passent toujours par les mailles du filet. Est-ce qu’on va continuer ainsi ou bien taper du poing sur la table, avec de vraies amendes, dissuasives, et des peines de prison lourdes ?
Jacques Doudet – C’est une frustration et un sentiment d’injustice partagés par les pêcheurs professionnels. C’est un fléau, une délinquance plus diffuse que celle évoquée avant, mais avec un impact fort. Dans plusieurs dossiers où on était partie civile, on a vu des acheteurs indélicats disparaître de l’instruction ou être relaxés. Au final, quand l’affaire passe au tribunal, il n’y a plus que les braconniers. Parfois, c’est que les enquêteurs n’ont pas réussi à prouver le lien entre le braconnier et l’acheteur. Récemment dans les Côtes-d’Armor, un bar-restaurant a dû fermer, mais c’est rare.
Guillaume Sellier – Il est difficile de montrer au juge qui préside le tribunal correctionnel que le poissonnier ou le restaurateur a sciemment acheté des produits braconnés. Or l’intention caractérise le délit. Il faut sensibiliser le procureur de la république, qui juge si une procédure est passible de suites judiciaires, et desquelles : audience pénale, comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, audience au tribunal correctionnel… Parfois le tribunal est sensible aux affaires maritimes, mais s’il gère des trafics de stupéfiants, des vols de voitures, et que vous arrivez avec 3 kilos d’oursins non déclarés, il se demande ce que cela fait à l’audience. À Lorient, il y a 20 ans, le procureur considérait qu’il avait mieux à faire que poursuivre pour 10 kilos de palourdes pêchées sur le Scorf ou le Blavet en zone insalubre. On a ciblé d’abord des affaires portant sur de grosses quantités, en verbalisant pour 300 kilos de coques pêchées sur la Laïta par exemple. Ça a marqué les esprits. Peu à peu le montant des amendes a augmenté pour atteindre le niveau du tribunal correctionnel de Vannes, habitué aux « audiences bleues ». Ça fait partie du rôle de l’administration d’expliquer l’importance de poursuivre, sous une forme ou une autre, pour donner une suite pénale rapide à ces affaires.
Charlotte Nithart – Les braconniers sont parfois d’anciens pêcheurs professionnels à la retraite, voire des responsables de la filière !
Jacques Doudet – Des pêcheurs prennent leur retraite mais conservent une activité déclarée, avec licences, charges… Après il y en a peut-être quelques-uns qui se prêtent à de la pêche de loisir et vendent néanmoins. Parfois ça s’explique par une retraite faible, ce n’est pas bien pour autant. Mais j’ai le sentiment que c’est moins le cas aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Il faut aussi avoir la condition physique pour continuer.
4- Du côté de Sysco, comment vous assurez-vous que vos achats proviennent d’une pêche légale ?
Olivier Canonne – On participe à la réflexion internationale sur les pêches illégales via des partenariats noués avec les ONG WWF et SFP, qui disposent d’experts au fait des pratiques de pêches et des acteurs en présence. Un travail important est mené pour sécuriser les approvisionnements, grâce à une amélioration de la traçabilité. Une des pistes principales est de donner la priorité aux produits de la mer labellisés MSC, ASC, Global Gap, Bap... WWF et SFP nous aident à identifier les produits les plus durables et ceux à éviter, voire les espèces à s’interdire. Ces ONG vérifient les pêcheries qui nous approvisionnent, y compris certifiées. Malgré cela, on ne s’arrête pas aux labels, car de petits acteurs n’ont pas forcément les moyens d’être certifiés, ça coûte cher. On s’appuie donc sur ces ONG pour identifier des pêcheries aux pratiques durables : surveillées, avec un suivi scientifique de stock, des mesures techniques, etc. On accompagne aussi des pêcheries dans leurs progrès, par exemple on soutient depuis plusieurs année un Fip (fishery improvement project) sur la pêcherie de cabillaud de Terre-Neuve, dont l’état du stock se reconstitue peu à peu. Aujourd’hui, 79 % des 32 000 tonnes de produits de la mer qu’on achète par an peuvent être considérés comme « durables et responsables ». Pour les 21 % des volumes restants, la difficulté est souvent la traçabilité. Ça ne veut pas dire qu’ils proviennent de pêches illégales, mais il faut s’assurer de la chaîne d’approvisionnement. Et on s’interdit de vendre certaines espèces sur liste rouge internationale, même si elles sont autorisées, pour des raisons de risques en termes de qualité sanitaire et de durabilité, comme certains requins. À mon avis, la vigilance de toute la chaîne est un levier au moins aussi important que les contrôles, et moins coûteux. Jusqu’au consommateur qui doit s’intéresser à l’origine du produit et aux enjeux.
5- Est-ce qu’il y a des espèces qui, via un blanchiment, obtiennent les documents de traçabilité, avec des acheteurs ainsi piégés ?
Charlotte Nithart – Les lieux de transit pour l’engraissement sont des points sensibles où le blanchiment est favorisé. Dans une affaire avec de la corruption à un niveau élevé, des thons rouges capturés illégalement étaient acheminés vers des fermes d’engraissement au large de Malte d’où ils ressortaient sous des données officielles. Les civelles, braconnées en Europe, exportées et grossies en Asie, repartent blanchies, notamment en filets d’anguille pour approvisionner les magasins de restauration de sushi. Il y a peu de contrôles alors que c’est une étape où stopper la contrebande. Des analyses génétiques sur des filets d’anguille dans des conteneurs venus de Chine jusqu’en Allemagne ont montré qu’environ 20 % de la cargaison étaient en fait de l’anguille européenne, donc venant d’alevins braconnés en Europe. De même aux États-Unis, avec la moitié des filets congelés d’anguilles issus des fermes asiatiques n’étant pas des anguilles japonaises, mais européennes. Il n’y a pas d’obligation à vérifier chaque livraison, pour autant, les grossistes spé- cialisés pourraient diligenter eux-mêmes des analyses régulières etbannir les fournisseurs douteux, se faire leur liste noire.
6- . Les analyses génétiques peuvent aussi déceler une espèce vendue pour une autre. Les mareyeurs sont-ils parties prenantes pour déjouer ces ruses ?
Vanessa Lhotellier – Ça reste compliqué à l’arrivée, une caisse est vite dispatchée, et vendue dans les 48 heures. Si on vous délivre le bon de livraison conforme à la marchandise reçue, il n’y a pas de raison que vous ne fassiez pas confiance à votre fournisseur.
Olivier Canonne – Compte tenu des volumes que nous achetons, nous avons notre propre laboratoire d’analyses à Dieppe, avec notamment un plan de contrôle fin sur les produits de la mer, et systématique sur les lots d’import. Il n’y a pas d’analyse génétique mais plusieurs niveaux de contrôle pour éviter des risques sanitaires et des fraudes. On peut déjà lever des doutes selon l’aspect visuel et organoleptique. Sur la question des contrôles, il me semble qu’un point d’avenir, face aux trafics internationaux comme en France, c’est la technologie blockchain, déjà utilisée sur certaines espèces comme le saumon et le thon. Elle permet de manière a priori infalsifiable de tracer un lot du bateau jusqu’au consommateur. Chaque opérateur de la chaîne rentre ses informations. En croisant les pratiques – date et lieu de pêche, volumes, données satellites, GPS… – on arrive à des garanties extrêmement fines. À titre expérimental sur le saumon fraisFilière Qualité Carrefour, il existe déjà la possibilité pour le client de scanner un QR code pour savoir où, quand, par qui il a été pêché. Ces méthodes se développeront et c’est une piste intéressante pour alléger les mesures de contrôles et le travail administratif, avec une traçabilité garantie.
Vanessa Lhotellier – Oui, sur le thon rouge, acheté en Espagne ou sous les criées françaises, avec l’outil etuna et traffic.com, on peut à partir des numéros de bague vérifier le port de débarque, l’identité du vendeur, etc. Le premier acheteur valide, puis le deuxième… jusqu’au bout. En tant que mareyeur on délivre ce document au client. Pourquoi aujourd’hui ce type de document d’enregistrement et de vérification ne pourrait pas être appliqué sur tous les produits sensibles ?
Guillaume Sellier – Le thon rouge est suivi de façon quasiment individuelle. On ne peut pas suivre les autres espèces sensibles à l’unité.
Olivier Canonne – Je pense vraiment qu’au-delà de l’aspect contrôlesanction, bien sûr à renforcer, la responsabilisation de l’acheteur, du restaurateur, y compris du consommateur, sera un levier important pour lutter contre la pêche illégale. Si le client s’aperçoit qu’à un moment il y a un trou dans la traçabilité, qu’il questionne son interlocuteur, qui lui-même se tourne vers son fournisseur… on peut identifier des problématiques.
Vanessa Lhotellier – Je suis tout à fait d’accord. Aujourd’hui, on responsabilise déjà le consommateur par les logos Pavillon France, MSC, etc. Et les gens adhèrent, même sur la crevette. Ils sont sensibles au mieux-manger, au respect des espèces. Demain on peut les impliquer encore plus en les informant en poissonnerie, au restaurant, sur des supports ludiques ou via des QR codes. Avec aussi la répression, malheureusement indispensable.
Thierry Quémener – Pour la civelle, beaucoup de pêcheurs ont adhéré au Seg, Sustainable eel group, qui représente l’anguille en Europe. De la civelle labellisée Seg donnera une anguille Seg, avec une traçabilité. Et pour s’y adosser, la filière anguille française a lancé un projet de marque collective. Ça ne va pas résoudre l’exfiltration de la civelle vers l’Asie, mais hormis l’ouverture d’un quota légal à l’export, une solution serait d’implanter une unité de grossissement et transformation asiatique en France, alimentée par la pêche professionnelle, pour fournir l’Europe avec du kayabaki, des filets d’anguille et autre.
Charlotte Nithart – Ça permettrait la traçabilité et réduirait les risques, on est d’accord. Oui, il faut informer le consommateur, c’est le décideur final, et le faire bien pour qu’il ne croule pas sous les informations. Mais ça concerne nos marchés, où l’acheteur est attentif à ces informations. Or c’est quand même en Asie que les produits braconnés sont surtout consommés. On peut y sensibiliser des ONG et consommateurs, mais c’est difficile, ce sont des marchés de plusieurs milliards de personnes. Et il n’y a pas que l’alimentaire. Il y a aussi un marché énorme pour des produits, comme les concombres de mer, les hippocampes, auxquels on prête des vertus prétendument aphrodisiaques, ou bénéfiques contre le cancer, le sida, etc. Le segment logistique a aussi une grosse responsabilité, que ce soit les compagnies aériennes ou maritimes. On est une terre de transit de par nos hubs maritimes, comme Le Havre, ou aérien, avec Roissy. Des contrôles peuvent être faits quand les cargaisons sont groupées, avant d’être dispatchées chez les grossistes. On y fait régulièrement des saisies d’espèces marines. Il y a des engagements volontaires, comme CMA-CGM qui a sa blacklist pour les espèces menacées, mais aussi le bois.
7- Quelles sont les espèces marines braconnées à l’international impliquant ainsi la France ?
Charlotte Nithart – On est préoccupés par les concombres de mer. Seules trois espèces sont inscrites à l’annexe II de la Cites sur une quarantaine ciblées, et déjà ça a été long à obtenir. Et je le redis, c’est un contrôle du commerce, pas une interdiction. Trop souvent les pêcheurs légaux prennent ça comme punitif alors que c’est une manière d’écarter les trafiquants. En Nouvelle-Calédonie, des blueboats (bateaux) vietnamiens, avec des équipages en surnombre et parfois de l’esclavagisme, pillent les concombres de mer dans les eaux françaises. Les pêcheurs légaux voient la ressource disparaître sous leurs yeux. Il y a eu de grosses opérations de contrôle, avec des frégates de la Marine nationale, une cinquantaine de bateaux arrêtés, certains coulés. Depuis ça va un peu mieux, mais c’est pré- caire. Globalement, il y a de gros enjeux de surveillance de nos eaux outre-mer, très vastes, et notamment de gros trafics dans l’arc antillais, ainsi que du braconnage de tortues marines à Mayotte. On craint aussi de voir un report, sur la France, du braconnage d’ormeaux qui sévit en Afrique du Sud. Quelle que soit l’espèce, c’est le même scénario. Les mafias souvent asiatiques ratissent au maximum un endroit, et quand il n’y a plus rien, elles vont ailleurs. Ainsi la mafia sur l’ormeau en Afrique du Sud – qui fait aussi du narcotrafic – épuise la ressource. Même dans les aires naturelles, les autorités sont dépassées. En plus de ça il y a de la corruption, avec des drames dans les familles entre gardes-pêche et braconniers. C’est un facteur de dislocation de la société. On a le pressentiment que ces mafias vont arriver en Bretagne s’approvisionner, d’abord légalement, et une fois les réseaux établis, via la contrebande. Pour lutter face au trafic d’espèces menacées, il faut donc activer une mosaïque de solutions. Il faut des centaines d’enquê- teurs, des filatures, des colis suivis, des écoutes téléphoniques ; des moyens comparables à ceux de la lutte contre le narcotrafic, car ce sont les mêmes procédés. Avec une répression dure. Jusqu’à l’information du particulier. En passant par la logistique. Ces solutions ne peuvent être efficaces que mises bout à bout.
Texte : Solène LE ROUX
Photos : Thierry NECTOUX