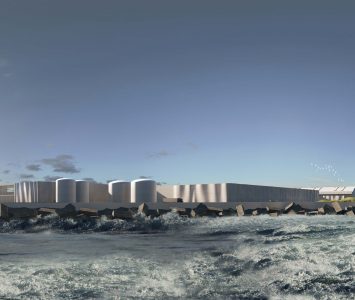La restauration forme un paysage hétéroclite. Statistiquement, les dépenses et les volumes de produits aquatiques ont tendance à baisser. Pourtant, aussi bien chez Flunch que pour Transgourmet Seafood, poissons, coquillages et crustacés sont de plus en plus stratégiques en restauration. Au-delà de la qualité, les chefs attendent du conseil et du service : l’approvisionnement est fort complexe.
 |
|
Joseph Goethals Au sein du groupe Agapes restauration (Auchan), Joseph Goethals est chargé des achats pour les plats principaux de Flunch (poissons, viandes, plats cuisinés…). |
PdM : Dans votre quotidien, quelle place occupent les produits de la mer ?
Joseph Goethals : Chez Flunch, le poisson est choisi une fois sur quatre par les clients. Sur un an, nous servons près de 500 tonnes de filets nature, 600 t de panés, sans compter les calamars et les plats cuisinés. Autre grand succès : la moule, fraîche et vivante, dont nous vendons 1 500 tonnes. Ce coquillage est stratégique. Sa présence fait venir des gens. Ce n’est pas le cas d’une entrecôte... La question du prix intervient peu dans le choix du poisson. Un alignement existe entre les produits carnés, les plats préparés, les poissons, les grillades : le plat principal s’affiche à moins de 9,95 €.
Jean-Philippe Bataille : J’ai le sentiment, au sein de Transgourmet Seafood, que la place du poisson en restauration ne cesse de progresser. Là où, avant, une seule espèce figurait sur les menus, on en trouve désormais trois ou quatre. Les Français n’aiment pas toujours les préparer chez eux, mais déguster des produits de la mer cuisinés par des chefs, c’est un bonheur pour tous.
Les statistiques globales disent l’inverse !
J.G. et J.-P.B. : (En chœur) Je ne suis pas certain d’être d’accord avec les statistiques.
J.G. : ... et suis plutôt en ligne avec Jean-Philippe Bataille. En parlant de statistiques, je suis inquiet : baisse des volumes et hausse de la valeur sont des tendances continues pour la pêche française. Ce n’est pas une situation pérenne.
J-P.B. : En même temps, les jours du poisson « pas cher » sont comptés. Avec la raréfaction des ressources, les produits de la mer frais ou surgelés deviennent des produits de luxe. Aujourd’hui, les jeunes chefs branchés, que nous accompagnons sur le salon Omnivore, n’hésitent plus à demander du rouget grondin, du chinchard, du maquereau, du poulpe, de l’anguille en lieu et place de la sole ou du turbot. Même les étoilés s’intéressent à ces espèces plus accessibles. La tendance est perceptible, nous devons l’encourager : bon ne doit pas forcément rimer avec cher.
J.G. : Les grands chefs seront les seuls à travailler les espèces nobles, et c’est une bonne nouvelle de les voir aussi vulgariser par leurs savoir-faire des espèces plus modestes ou moins connues. Cela dit, toutes les espèces ne sont pas menacées. Nous en avons dressé la liste et, pour des raisons philosophiques comme pragmatiques, nous les travaillons, à l’instar du lieu noir, une espèce phare de Flunch pour laquelle la satisfaction client est au rendez-vous.
Et en restauration collective ?
J.-P.B : Nous avons été surpris par les demandes des collectivités pour du poisson frais afin de développer le goût des produits, notamment chez les enfants. Les expériences rencontrent du succès. Pourtant 600 kg de pavés frais de rascasse désarêtée dans une cantine, ce n’était pas gagné ! Comme le frais est plus cher, les collectivités alternent avec le surgelé. Mais lorsque le frais arrive à table, nous réalisons des supports éducatifs sur les espèces…
J.G. : Sur les fiches de vulgarisation poisson, ce qui est amusant, c’est que les gens sont curieux de voir la tête de l’espèce, alors que dans la viande, on évite de la leur montrer. Sinon, plus que la notion de produit frais, j’utiliserai la notion de produit brut. Frais ou surgelés, ce qui compte c’est la qualité intrinsèque du poisson qui sera servi cuit et cuisiné. Le surgelé de qualité existe. Ce choix de filière reste, pour Flunch, le meilleur moyen de s’approvisionner en poisson durable. Cela dit, nous ne pouvons pas en faire un outil de communication. Le surgelé, sauf chez Picard, est mal vu en restauration. La charte du fait maison voulait même l’exclure au départ. C’est une hérésie. Notre lieu noir certifié MSC, pêché et surgelé bord par un armement français, porteur du logo Pavillon France, a plus d’allure que beaucoup des lieus noirs d’étals de poissonniers !
MSC, Pavillon France… Les chefs sont-ils en demande de marques et de labels ?
J.G. : Le logo Pavillon France a un impact auprès de la clientèle comme des salariés, fiers de servir des produits français. Dans la restauration en libre-service, le positionner sur nos photos est assez simple. Notez que presque 50 % de nos volumes de poissons sont origine France si, au-delà du merlu et du lieu noir, nous comptons les steaks de thon pêché dans l’Océan indien par un armement français. Ce plat n’arbore pas le logo Pavillon France. Pour le MSC, alors que 90 % de nos filets naturels ou panés sont certifiés MSC, nous privilégions la notion de sauvage, naturel et durable, origine Alaska. Le logo reste trop abscons pour les clients.
J.-P.B. : Filiale de Coop Suisse, pays où le MSC est reconnu, nous nous sommes fait certifier MSC, ainsi que bio. Un plus pour les grands groupes de la restauration, qui, souvent dans le cadre de partenariats avec WWF, nous demandent d’encourager leurs chefs à opter pour les espèces certifiées MSC. La question prend de l’importance.
J.G. : Les opérateurs de la restauration utilisent de plus en plus les labels, mais ne communiquent pas forcément dessus.
Quid les indépendants ?
J.-P.B : Le programme Mr Goodfish répond peut-être plus à leurs attentes. Il définit, en collaboration avec les scientifiques de l’Ifremer, une liste de produits durables de nos côtes, au fil des saisons et des zones de pêche. Selon qu’elle vienne de la Manche ou de l’Atlantique, la bonne période pour la sole n’est pas la même. Nous nous appuyons beaucoup sur le programme pour expliquer aux chefs l’importance de suivre les saisons.
J.G. : C’est important de responsabiliser les acteurs.
J.-P.B. : Aujourd’hui il faut leur raconter l’histoire des produits, dire d’où ils viennent, comment ils ont été pêchés ou élevés. C’est une véritable attente des chefs. Dans un restaurant gastronomique, plus un chef ne veut inscrire simplement « turbot ». Ils veulent préciser « du Guilvinec », pêché par untel, etc. Une sortie au restaurant se doit d’être festive, les gens n’y viennent pas seulement pour manger. Entendre l’histoire des produits qu’ils dégustent participe à la fête. Ils vont l’exiger de plus en plus souvent et dans tous les styles de restauration. Nos structures doivent faire remonter l’ensemble des informations pour qu’elles puissent ensuite être diffusées en salles.
J.G. : Les exigences réglementaires en matière de traçabilité imposent cette remontée des données. Mais les informations brutes sont tristes. Les commerçants doivent les faire vivre et satisfaire la curiosité des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles aux avis des ONG sur les questions de pêche durable. Cette culture naissante crée un contexte favorable à la magie d’une histoire. Inscrire « merlu de l’île d’Yeu » sur les photos mises en avant en restaurant me ferait vraiment plaisir. Mais attention : il faut que l’histoire soit vraie !
J.-P.B : C’est sûr ! Il ne faut pas faire de poésie ou de roman fiction. Les consommateurs veulent bien dépenser un peu plus dans un contexte difficile, mais il faut que la qualité soit au rendez-vous. Inscrire « bar de ligne » si ce n’est pas le cas, ça n’a pas de sens.
 |
|
Jean-Philippe Bataille Le directeur du développement marée de Transgourmet Seafood se définit comme un « poissonnier ». La filiale marée du grossiste généraliste, détenu par le groupe Coop Suisse, est installée à Rungis. |
C’est même une tromperie !
J.-P.B. : Heureusement, on sent aujourd’hui les chefs très en alerte sur les produits qu’ils achètent, certains deviennent de vrais experts. Ils sont avides de conseils et n’élaborent plus leurs cartes seuls. Nous discutons avec eux, les incitons à respecter les saisons et les périodes de reproduction. C’est fondamental. Il faut savoir dire non pour de la sole au mois de mars ou du bar en janvier. À nous de les orienter vers des alternatives et de leur donner les clés pour justifier leur position, notamment dans les palaces, face à des clients exigeants. Ce n’est pas facile pour eux de dire non aux clients, surtout vu la situation économique depuis les attentats, mais le mouvement est en marche. Nous en sommes aux prémices.
J.G : À défaut le législateur risque de s’en mêler. En faisant le choix du surgelé, où, comme en frais, il existe des filières d’excellence y compris pour les poissons de nos côtes, nous savons que nous ne prélevons la ressource qu’en saison, tout en étant certains de répondre à nos besoins au fil de l’année. Nous évitons aussi les conséquences des tempêtes.
J.-P.B. : Elles nous donnent du fil à retordre ! Et expliquent aussi pourquoi, dans le frais, il faut avoir un peu de latitude au niveau budgétaire. Vos contraintes sont importantes et c’est vrai qu’il existe de beaux
produits en surgelés.
En matière de découpes, quel est le degré d’élaboration demandé ?
J.-P.B. : Sur les 12 tonnes vendues par jour, 80 % sont découpées, portionnées, désarêtées la nuit juste avant la livraison. À part les étoilés, les restaurateurs n’ont plus de personnel pour préparer le poisson. Ils se concentrent sur la mise en place du produit, l’élaboration des sauces… Il y a trente ans, on ne livrait que de l’entier !
J.G. : Parfois à peine vidé ! Chez Flunch, les restaurants reçoivent du prêt à l’emploi, cru, portionné et desarêté. La décongélation se fait sur place, selon des procédures strictes.
J.-P.B. : L’entier, c’est un peu comme les arêtes. Les restaurateurs n’en veulent pas. Mais le sans arête a un coût. La meilleure découpe pour y parvenir, c’est le dos. Le rapport entre un poisson entier et un dos est de 1 à 3. Pour les collectivités, c’est un casse-tête.
J.G. : La chasse aux arêtes est source de gaspillage. Je suis heureux de voir les chefs se mobiliser contre le gaspillage alimentaire, notamment les grands chefs dont les choix de découpes généraient beaucoup de déchets ! Désormais, ils mettent aussi leur talent à valoriser ce qu’ils mettaient avant à la poubelle. Ce point me tient particulièrement à cœur ! Sinon, en termes de découpe, le grand changement vient du retour des « filets avec peau ». Facile à enlever, elle donne un aspect naturel au filet et protège la chair à la cuisson.
J.-P.B : Surtout que cette dernière se fait de plus en plus souvent à la plancha. Mais la présence de la peau donne aussi plus de goût.
Pour revenir sur la lutte contre le gaspillage, nous tentons de valoriser les chutes de découpes en les proposant aux chefs pour réaliser des terrines. Mais on ne gagne pas grand-chose !
Quelles sont les attentes en termes de services ? Du prix, des volumes, une logistique fluide… ?
J.G. : Pour être honnête, chez Flunch on essaie surtout de savoir ce que nos fournisseurs attendent de nous ! Pour être faciles à livrer, nous avons internalisé la logistique et nous travaillons sur des partenariats de longue durée. Sans eux, vous courrez le risque de ne pas être servis lorsque les captures sont à la baisse. Cette année les apports de saumon d’Alaska sont faibles, mais comme nous travaillons avec le même opérateur depuis 20 ans, j’ai bon espoir que ma commande soit honorée. Pour la filière merlu, plus jeune, il a été difficile au début d’accepter de passer son tour lorsque les prix du frais tiraient vers le haut. Mais comme nous sommes au rendez-vous chaque année, nos fournisseurs font l’effort. Je crois à la fidélité. Côté prix, le marché des produits de la mer est un paradoxe. Moins vos besoins sont importants, plus vous pouvez négocier !
J.-P. B. : Je partage. Or, pour servir la restauration vous avez besoin de certains volumes dans des tailles parfaitement calibrées ! Heureusement, le prix n’est pas encore le premier thème évoqué par les chefs. Le type de découpes, l’horaire de livraison viennent d’abord. Après on évalue… et ça passe ou ça casse. Le poisson est cher. Il faut trouver des solutions pour que pas une miette n’en soit perdue. Et si l’on veut les servir en temps et en heure, nos livraisons pour Paris doivent être parties à 6 h 30 maximum, tant la densité des embouteillages est monstre dans la région. Pour mieux servir les restaurants et les aider à gérer la volatilité de leur activité, nous réfléchissons à livrer sept jours sur sept. En matière de services, on ne dit jamais non.
On essaie...
Propos recueillis par Céline Astruc
Photos Thierry Nectoux