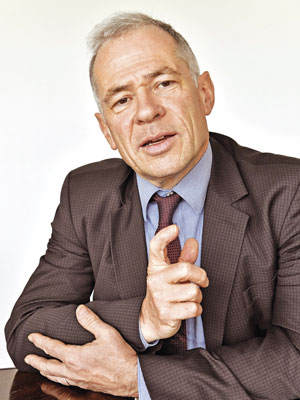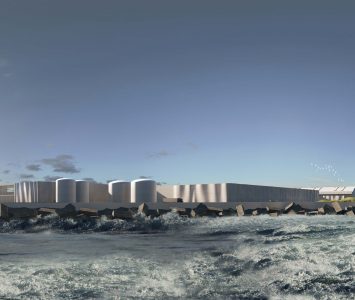Ceta, Jefta, Mercosur… La liste des accords de libre-échange dans lesquels l’Union européenne s’engage s’allonge, sous le regard plutôt bienveillant du secteur. Mais pour Isabelle Thomas, députée européenne socialiste, cette libéralisation, sans exigences suffisantes sur le plan environnemental et social et sans moyens de contrôle adaptés, nuit à la production européenne. Entretien.
|
Sommaire 3- Les professionnels du secteur et les parlementaires sont-ils impliqués dans les négociations ? 10- Avez-vous une autre préconisation pour limiter cette concurrence déloyale ? |
|
À propos du rapport Engström Dans ce rapport sur « la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne », la commission pêche du Parlement européen dénonce les défaillances des contrôles de l’Union européenne, tant sur le respect des règles sanitaires que sur les questions de lutte contre la pêche illégale. Défaillances qui remettent en cause l’intérêt pour l’Union des accords de libre-échange. |
1- PdM : L’Europe multiplie les négociations autour d’accords de libre-échange. Une politique à l’opposé de celle menée par les États-Unis du président Donald Trump, qui ravive la menace d’une guerre commerciale. Qu’en pensez-vous ?
Isabelle Thomas : Je renvoie dos à dos l’attitude d’un Donald Trump qui risque de provoquer des tensions commerciales et celle de l’Union européenne qui développe ses accords de libre-échange sans réfléchir ni à sa stratégie économique interne ni à sa stratégie budgétaire. N’oublions pas que les droits de douane constituent des recettes. Si elles s’effondrent, le budget européen s’affaiblit. Mais surtout, la multiplication des accords de libre-échange pose à l’Europe et ses opérateurs un problème de standards. Les règles du jeu sont différentes des accords commerciaux classiques.
2- Les accords de libre-échange définissent aussi des règles, sur les questions sanitaires notamment, non ?
I. T. : Oui, mais ces standards sont l’objet d’une négociation, qui ne tire pas les exigences vers le haut. Bien sûr, l’Europe peut refuser d’importer des poulets chlorés mais en contrepartie, devrait-elle accepter du saumon OGM ? Cela se fait souvent en contrepartie d’autres choses. Les pays qui ont une législation aussi sévère que la France sur le sujet ne sont pas nombreux.
Si demain, la France refuse l’arrivée de saumon OGM sur son territoire, en dépit d’un accord européen, elle risque de se faire condamner par un tribunal d’arbitrage si les acteurs du saumon OGM s’estiment floués.
Pour moi, cela pose un vrai problème de démocratie. Les juges allemands ont soulevé le problème, les arbitres des tribunaux ne sont pas issus de la fonction publique et peuvent facilement placer les intérêts commerciaux au-dessus de l’intérêt général. Certains pays comme l’Australie, le Canada ou l’Afrique du Sud ont déjà été condamnés à verser des dédommagements aux investisseurs.
3- Les professionnels du secteur et les parlementaires sont-ils impliqués dans les négociations ?
I. T. : Même si des progrès ont été réalisés, l’opacité du processus de négociation a souvent été critiquée. Il reste encore beaucoup à faire. Car si le Parlement européen comme les parlements nationaux ont leur mot à dire, ils n’ont comme choix que deux solutions : mettre leur veto ou valider l’accord tel quel. Nous aurions tout à gagner si des représentants du Parlement pouvaient être impliqués dans la définition de l’accord.
En réalité, si les accords de libre-échange me choquent, ce n’est pas parce que les États membres perdent une part de leur souveraineté nationale. Après tout, nous avons construit un marché unique. Ce qui me dérange, c’est que bien souvent, les accords de libre-échange se font au détriment de la production européenne. Or, sur les produits de la pêche et de l’aquaculture, le niveau des importations est tellement élevé qu’il faut faire attention.
|
Accords de libre-échange
Pierre Commère, « L’industrie française et européenne de la transformation de produits de la mer est clairement favorable à l’abaissement des barrières douanières pour les matières premières. La production européenne ne suffit pas à alimenter nos établissements et nos marchés ! À l’inverse, nous serons sur la défensive pour les produits finis, notamment les conserves de thon, susceptibles de concurrencer nos propres fabrications. Dans des proportions différentes, évidemment, selon que l’on dialogue avec les pays du Mercosur qui n’exportent pas de conserves de thon ou avec la Thaïlande, géante du secteur. Dans ce cas, nous demanderons la mise en place de contingents tarifaires, etc. |
4- La majorité de ces importations alimente le secteur de la transformation. La production européenne de produits aquatique est limitée.
I. T. : C’est le discours que l’on entend partout ! Sauf que d’années en années, la part des produits de la pêche et de l’aquaculture déjà transformés vendus dans l’UE ne cesse de s’élever : de 15 milliards d’euros en 2009 à 20 milliards en 2015. Et certains producteurs européens transforment ailleurs que dans l’UE.
5- Sur le saumon, les crevettes, le colin d’Alaska… les grandes espèces de transformation, le manque de matière première est réel.
I. T. : L’Écosse, l’Irlande, la France produisent du saumon ! Pas assez me direz-vous. Mais la vraie question à se poser, c’est pourquoi ? Pourquoi la Norvège seule produit plus de saumon que l’Europe réunie ? Nous avons le potentiel maritime et les savoir-faire ! Pourquoi ne pas tenter de domestiquer les crevettes sauvages de nos côtes ?
Non ! L’Europe a préféré mener une politique commerciale de libre-échange au détriment d’une politique de production. Or, en baissant les tarifs douaniers et en n’imposant pas de standards élevés en matière sociale, sanitaire ou environnementale, elle favorise l’importation de produits forcément meilleur marché. Tels qu’ils sont, les accords de libre-échange maintiennent en Europe une pression en défaveur des normes sociales, sanitaires et environnementales. Il faut mettre en place des exigences vertueuses.
6- Dans un secteur très concurrentiel à l’achat de matières premières poisson, l’Europe, et notamment la France, est déjà considérée comme très exigeante, ne serait-ce qu’avec les mesures contre la pêche illégale. Certains pays fournisseurs la délaissent au profit d’autres marchés !
I. T. : D’abord je vais m’inscrire en faux sur les exigences supérieures de tel ou tel pays. Les Allemands, les Suédois, etc. sont comme les Français : ils estiment tous que leurs exigences sont les meilleures. Au final, cela ne fait que tirer vers le bas l’ensemble.
Cela dit, au niveau européen, des progrès ont été accomplis, notamment en matière de lutte contre la pêche illégale et non déclarée (INN). Le rapport Engström, dont je suis shadow rapporteure pour mon groupe, le souligne. L’application du règlement INN démontre que l’Union européenne peut avoir une influence considérable sur la pêche mondiale. Il faut donc aller plus loin dans nos exigences.
C’est une attente des peuples européens. Ils poussent le Parlement à voter en faveur de textes visant à augmenter les normes sociales, environnementales, sanitaires et climatiques. Mais face à une Commission européenne néolibérale et arc-boutée sur les accords de libre-échange, les confrontations sont de plus en plus sévères. Y compris sur des sujets qui ne touchent que ses pays membres, comme la pêche électrique. Ce qui a été fait sur cette pêcherie est révélateur des états d’esprit et du poids des lobbys.
7- La montée des exigences des consommateurs sur l’aspect social, environnemental ou sanitaire est réelle dans le déclaratif. Toutefois, dans les actes d’achat, c’est moins vrai. Car les exigences ont un coût.
I. T. : Ne prenons pas la question à l’envers ! S’ils avaient des salaires corrects, la question se poserait moins. Mais les salaires n’augmentent pas et tout le monde s’en inquiète, de la Banque centrale européenne au Fonds monétaire international.
Ensuite, si l’on regarde au niveau des premières ventes, on constate qu’effectivement, les prix versés aux pêcheurs ont augmenté. Mais tout se vend. Signe que les efforts pour revenir au RMD ont payé !
Quant aux transformateurs, dont les préoccupations sont de défendre des marges, de payer des salariés, etc., il ne faut plus qu’ils soient en concurrence avec des produits décalés en prix. Si le décalage est grand, le consommateur choisira bien souvent le produit le moins cher, même s’il se doute que la qualité est moindre. Toutefois, si le décalage de prix est trop important, il n’y a pas de mystère. Cela signifie que des gens ne vivent pas de leur travail, voire tombe dans l’esclavagisme comme au Vietnam, ou alors que les conditions sanitaires ne sont pas respectées, ou que finalement, la matière première est issue de la pêche illégale. Prenez l’accord que l’Union a signé avec les Philippines, connues comme étant une plateforme de blanchiment de poisson dans le Pacifique. Les produits qui y sont transformés peuvent ainsi, grâce à l’accord avec les Philippines, entrer en Europe. Mais d’où vient le poisson ?
8- Les accords sont négociés avec une définition des règles d’origine. C’est même avec le Mercosur un point de tension, puisque l’Union européenne et les pays d’Amérique du Sud n’en ont pas la même définition.
I. T. : Oui, des règles sont définies et la règle d’origine est essentielle, à condition d’en avoir la même définition. Mais encore faut-il contrôler le respect de ces règles.
Or, l’Agence européenne de contrôle des pêches n’a pas de droit de regard sur la façon dont vont être menés les contrôles des partenaires commerciaux.
Il faut que cela change. Aujourd’hui, chaque pays fait un peu ce qu’il veut. Prenez le Japon. L’an dernier, en vue de l’accord de libre-échange avec le Japon, j’y suis allée quelques jours avec la commission pêche. J’en suis revenue effondrée. Je pensais que le Japon était un pays où les normes et les modes de contrôle étaient proches de ceux de l’Europe. Nous en sommes loin. Seules sept espèces sont sous quotas. Parmi elles, il n’y avait même pas le thon rouge. Au total, 66 % de la pêche japonaise n’est pas sous quotas ! Quant aux contrôles, nous avons posé quinze fois la question et n’avons jamais entendu la même réponse. Certains nous ont même répondu que les personnes chargées des contrôles étaient les opérateurs de la filière. Il n’est pas possible d’être juge et partie ! Cela m’inquiète.
Mais je suis convaincue que les opérateurs des pays tiers sont tout à fait partants pour travailler selon des cahiers des charges aux normes et aux standards élevés s’ils sont payés plus cher. Cela se fait aujourd’hui. Et l’Europe peut aider ses transformateurs à mieux rémunérer la matière première si elle prend en main les contrôles. Ce n’est pas à des opérateurs privés de les assurer, mais aux acteurs publics, financés par l’impôt.
9- Les contrôles ne sont pas inexistants non plus. Avant de s’engager dans un accord de libre-échange, l’Europe établit des systèmes d’équivalence sur les règles sanitaires, nourris par des contrôles vétérinaires…
I. T. : Sur le papier, les contrôles existent. Sur le terrain, il n’en va pas de même.
Le rapport Engström relève de nombreuses défaillances. Il faut agir. Cela passe en partie par une révision et une harmonisation du règlement contrôles au sein comme à l’extérieur de l’Union. Un projet de texte devrait sortir en mai 2018. J’espère être rapporteure sur le sujet car il me tient à cœur.
Le texte actuel, qui prend en compte les contrôles sur la pêche, du filet à l’assiette, est truffé de conditionnels. Chaque pays peut l’interpréter comme il le veut, alors qu’il est censé s’appliquer à tous de la même façon. Dans mon rapport d’initiative sur l’harmonisation du contrôle des pêches en Europe, je souligne aussi les problèmes posés par la disparité des modes de contrôle dans les pays membres. En France, cinq corps de contrôle appartenant à des administrations différentes coexistent ; en Italie, il n’y en a qu’un. On peut multiplier les exemples !
Il importe de rendre le texte lisible et d’élargir son champ d’action à nos partenaires commerciaux, afin de limiter la concurrence déloyale en interne de l’Union ou en externe.
10- Avez-vous une autre préconisation pour limiter cette concurrence déloyale ?
I. T. : Mon collègue, Édouard Martin, a proposé pour défendre l’acier européen de réaliser un ajustement aux frontières de l’Union avec une taxe carbone. Objectif : rétablir une équité entre nous et les pays producteurs qui ne tiennent pas compte de l’impact carbone. L’acier n’est pas plus stratégique que l’autonomie alimentaire. Faisons la même chose dans la pêche et l’aquaculture, en tenant compte, en plus du carbone, des aspects sanitaires, sociaux, etc. Nous pourrons alors booster notre production et favoriser la transformation de produits de la pêche européens et éviter l’effondrement de nos valeurs.
Propos recueillis par Céline ASTRUC
Photos : Thierry NECTOUX
|
Les accords de libre-échange sont toujours bénéfiques
Enrico Brivio,
« Les accords de libre-échange sont d’abord et toujours bénéfiques aux consommateurs qui obtiennent de meilleurs prix. Les différents secteurs économiques, y compris celui de la pêche, de l’aquaculture et des produits de la mer, en bénéficient. Nous consultons les représentants professionnels comme la société civile pour arriver au meilleur équilibre possible, en fonction du poids économique du secteur et du profil du futur partenaire. |