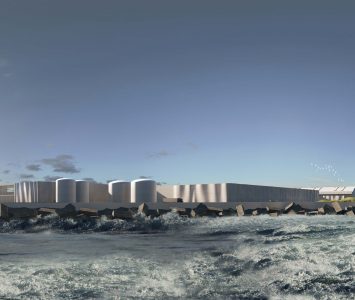Plutôt orientés à la hausse dès 2013, les cours moyens en halles à marée ont progressé de 9 % entre 2014 et 2015, alors même que les volumes ne diminuaient que de 3 %. Depuis le début d’année, le haut niveau des cours se maintient. Est-ce durable ? Quelles sont les incidences pour la filière française et notamment le mareyage ? Les avis sont nuancés entre François Gallen, mareyeur, et Benoit Vidal-Giraud, du cabinet Via Aqua. Le plus optimiste n’est pas celui qu’on croit.
 |
|
François GALLEN Mareyeur indépendant, |
Élevés en France comme en Europe, les prix en criées risquent-ils de grimper encorenbsp]?
François Gallen : Impossible de séparer le marché français du marché européen. Les produits de la mer ne sont pas à l’abri de la mondialisation et, en 30 ans, j’ai pu constater cette internationalisation, à l’achat comme à la vente. Sur les dernières années, la demande chinoise a tiré les cours vers le haut, sachant que l’offre était limitée par des quotas très restrictifs. Le déséquilibre entre l’offre et la demande a fait flamber les prix de 9 % en 2014, en France. Depuis, nous avons atteint un palier. La demande chinoise a été absorbée, les prix devraient gagner en stabilité.
Benoit Vidal-Giraud : Je partage le constat. Avec l’augmentation du niveau de vie, l’Asie s’est mise à consommer les produits halieutiques qu’elle réexpédiait auparavant. Cela rompt l’équilibre entre l’offre et la demande. Mais les tensions risquent de s’accentuer !
F. G. : Peut-être, mais, lorsque les prix flambent trop, les consommateurs français se détournent. Cela rééquilibre la demande. Je suis convaincu que l’on a atteint un palier.
B. V.-G. : La stabilité apparente depuis deux ans s’explique peut-être par les perspectives des pêches européennes et l’arrivée au RMD (rendement maximum durable) d’une bonne partie des stocks européens. Désormais, les variations de quotas sont moins extrêmes et surtout moins chaotiques. Cela donne de la visibilité.
F. G. : Les chiffres m’ont heureusement surpris. Le RMD va dans le bon sens. Lorsque l’Union s’est engagée dans cette politique, seuls cinq ou six stocks des 65 suivis étaient au RMD. Aujourd’hui, c’est 40. C’est génial ! La filière va pouvoir embaucher, construire des bateaux. Les banques pourront aider les jeunes à s’installer…
B. V.-G. : C’est là un sacré résultat de l’Europe.
La stabilité moyenne des cours cache-t-elle des variations par espèce ? Les moins valorisées profitent-elles de la hausse ?
F. G. : Oui, le meilleur exemple est celui de la sardine. Pour mes collègues, le filet de sardine au rayon frais devient un gros marché. Mais la tension sur les prix est perceptible sur toutes les espèces, en témoigne l’absence de retraits.
B. V.-G. : Même s’il est difficile d’analyser les répercussions d’une hausse des prix en première vente sur la dernière commercialisation, force est de constater qu’aujourd’hui, les consommateurs achètent moins de kilos. Par contre, les données de Kantar Worldpanel montrent que le nombre d’euros dépensé au kilo a beaucoup progressé. En contrepartie, les consommateurs délaissent le brut pour des produits élaborés, prêts à l’emploi comme les sardines étêtées et désarêtées des rayons marée. Cela fonctionne pour toutes les espèces.
F. G. : Effectivement, notre rôle de mareyeurs est de proposer à cette nouvelle génération de consommateurs des produits de plus en plus finis. La demande est perceptible, y compris dans la restauration. Écailler, fileter, portionner fait partie de notre quotidien.
Le déséquilibre entre l’offre et la demande explique le niveau élevé des cours, mais quid du travail des pêcheurs ?
F. G. : Il a un impact ! Face à des quotas restreints, les pêcheurs cherchent à optimiser leurs revenus en ciblant les espèces au moment où les cours sont bons. Ils adaptent presque instinctivement les espèces ciblées et les temps de marée pour profiter de prix attractifs. Cela participe à une certaine hausse des cours dont l’impact sur le mareyage n’est pas forcément mauvais. Des prix trop bas dans les halles à marée révèlent une absence de demande, un marché atone, sur lequel il sera impossible de valoriser l’espèce. Les mareyeurs cherchent des prix équilibrés. Des cours qui permettent aux pêcheurs de vivre et qui leur permettent de vendre.
Le temps des « coups » en criée est bel et bien fini. Le marché est devenu trop interactif. Tout le monde est présent sur tous les ports. En Europe, les prix s’ajustent à la minute. Aujourd’hui, un mareyeur doit surtout se positionner comme un partenaire vis-à-vis de ses clients et tâcher de trouver la plus belle qualité au meilleur prix. Sachant que la qualité s’est standardisée et améliorée.
B. V.-G. : L’information circule si vite qu’il est impossible qu’un opérateur ne soit pas au courant des espèces qui montent ou descendent. Personne ne peut plus tromper personne. Néanmoins, dans l’étude que nous avons menée pour FranceAgriMer*, il apparaissait que les cours à la première vente en France étaient légèrement supérieurs au reste de l’Europe.
F. G. : La logistique explique le différentiel. Prenons l’exemple d’une lotte entière. Si on met 7 euros dans une criée de Bretagne, on ne mettra pas plus de 6,50 euros en Écosse parce qu’il faut compter presque 50 centimes pour la ramener en France !
 |
|
Benoit Vidal-Giraud, Associé fondateur du cabinet Cette étude, remise en juin 2016 |
La hausse des cours n'est pas forcément mauvais, mais le mareyage souffre, non ?
F. G. : Oui, les conditions sont difficiles. Les prix ont augmenté, mais ce n’est pas le cas de nos marges au kilo. Or, globalement, les volumes vendus sont en baisse. Au quotidien, nous sommes aussi confrontés à un manque de matières premières, à des apports irréguliers. La mise en place d’outils semi-industriels destinés à élaborer nos produits s’avère donc difficile. Organiser le travail du personnel est complexe…
B. V.-G. : Ne pourriez-vous pas nouer des contrats de gré à gré avec certains armements, comme Porcher ?
F. G. : Non, il préfère que tout le monde puisse avoir accès à son poisson. Pour moi, l’équilibre naît de la confrontation entre l’offre et la demande et je pense que la multiplication des contrats de gré à gré pourrait faire disparaître de petits intervenants.
B. V.-G. : En même temps, s’engager sur des prix et des volumes sur plusieurs mois, comme dans les pays du Nord, éviterait aux pêcheurs de jouer leur quota à la roulette et donnerait à ceux qui deviendraient leurs partenaires mareyeurs plus de visibilité. C’est une sécurité, non ? Reste à savoir quelle est la proportion idéale.
F. G. : Dans les produits élaborés, cela peut fonctionner, mais dans le frais, la concurrence sur les prix est telle que ce n’est pas possible. Imaginer un Carrefour ou un Leclerc engagé dans un contrat, via son mareyeur, à 6 euros, si les prix tombent à 4,50 euros. Ce n’est pas tenable lorsque les prix changent heure après heure. La pression sur les prix est d’autant plus phénoménale que la qualité n’est plus un sujet. Elle doit être au rendez-vous.
La guerre des prix touche aussi la marée ? Y compris les espèces de nos côtes qui ne font pas le gros du marché ?
F. G. : Oui, et comme dans d’autres univers de la consommation, la guerre des prix nous déstabilise. Mais quand les produits sont trop chers, les consommateurs se détournent des rayons. Alors ?
Le seul moyen de résister est de tenter de diversifier ses débouchés : restauration, export, poissonneries. Il faut aussi tenter d’être plus imaginatif en matière de découpes pour faciliter la consommation d’espèces oubliées. L’entier et même les darnes, c’est fini.
B. V.-G. : Souvent, lorsque l’on évoque la guerre des prix, on accuse la grande distribution, mais on n’insiste pas assez sur le rôle du consommateur. En 50 ans, la part de l’alimentaire dans son budget a été divisée par trois. L’alimentation n’est pas sa priorité. C’est cela, surtout, qui met la pression sur les fournisseurs. Mais nous avons peut-être atteint un plancher. Certains consommateurs décident de réinvestir leur alimentation, prenant conscience qu’elle joue sur leur santé… Si le mouvement s’amplifie, le consentement à payer un peu plus pourrait s’affirmer.
F. G. : Pour l’heure, la demande porte plus sur des produits de pêche durable certifiés MSC.
B. V.-G. : Face à la durabilité des produits halieutiques et du consentement à payer plus, le baromètre réalisé pour FranceAgriMer montre le chemin qui reste à parcourir. Sur 1 000 personnes interrogées, la moitié seulement considère qu’un produit durable est un produit dont les stocks sont bien gérés et dont l’impact sur l’environnement est limité. Seuls 35 % considèrent en plus qu’il doit permettre aux producteurs de bien en vivre. C’est un symbole du déséquilibre entre le consommateur et le citoyen.
Avec des cours légèrement plus élevés que dans le reste de l’Europe, les places françaises restent-elles attractives ?
B. V.-G. : Si l’on ne regarde que les prix, les criées françaises ne sont pas attractives. Mais la diversité des espèces proposées et la réactivité des acteurs présents sont reconnues partout en Europe. C’est une rente de situation. Mais elle risque de ne pas être éternelle. Le marché se détourne des produits bruts, exige des produits plus élaborés. Or, deux types de flux existent : les espèces côtières et variées d’une part, et de l’autre, les espèces à gros volumes, importées, souvent du nord de l’Europe. Grosso modo, des saumons et cabillauds que l’on découpe. Sauf que les opérateurs des pays du nord de l’Europe souhaitent récupérer la valeur ajoutée des découpes. Ils n’envoient plus de VDK mais des dos. Un mouvement qui va s’accélérer.
Or, dans les rayons, les espèces côtières se retrouvent face au même consommateur. Je crains que la diversité des pêches françaises soit de plus en plus marginalisée. Que peuvent faire les mareyeurs français pour valoriser leurs savoir-faire, leur réactivité ?
F. G. : Nous ne sommes pas taillés en France pour faire des dos de cabillaud, etc. Il faut des volumes, des machines... Ce que nous n’avons pas. Les importer pour les transformer pose aussi un problème logistique. Ces flux transitent par Boulogne, or, les coûts de transport entre Boulogne et la Bretagne sont rédhibitoires. Sur un produit fini, ce serait presque 1 euro. Il faut jouer avec nos atouts. Les deux marchés sont complémentaires. Le nôtre, lié à la diversité de produits de qualité, est peut-être un marché de niche, mais nous devons défendre sa place. Je préfère faire ce que je maîtrise.
Quitte à être absorbé par des groupes, plus grands, d’Europe du Nord ?
F. G. : Difficile de répondre. Les bouleversements au sein de la profession depuis deux ou trois ans sont tels que je n’ai pas de visibilité sur l’avenir. J’en ai sur les apports, avec l’arrivée de 40 stocks au RMD. C’est positif. Mais, le reste, je ne le maîtrise pas. Et c’est une vraie question : comment rester indépendant face à une concurrence structurée et à des géants comme Mariteam, Intermarché, Métro… ?
B. V.-G. : L’idée de valoriser votre proximité avec les centrales et de jouer sur votre réactivité en achetant des produits semi-finis congelés, que vous pourriez, en refresh, proposer à des GMS, en portions, en brochettes… peut-elle être une piste ?
F. G. : Lerøy ou Marine Harvest le font, mais je ne suis pas convaincu que le mareyage français a les reins assez solides pour investir de cette façon-là. Je n’y crois pas. Je doute que les distributeurs viennent voir le mareyeur Gallen pour le fournir en cabillaud ou saumon de Norvège. C’est un intermédiaire de trop.
Mais il faut rester optimiste, l’arrivée au RMD de plusieurs stocks devrait aussi permettre de libérer des quotas et, peut-être, de faire baisser les prix en criées.
B. V.-G. : Je ne partage pas cet optimisme. La part qui reste à la filière française sur le marché est petite et mal installée. Ceux qui dominent le marché poussent leurs pions pour le formater. Il faut que pêcheurs, mareyeurs, criées se prennent en main pour rester maîtres de leur place. Il faut faire vite, les bouleversements se feront dans les quelques prochaines années.
Propos recueillis par Céline ASTRUC
Photos : Thierry NECTOUX