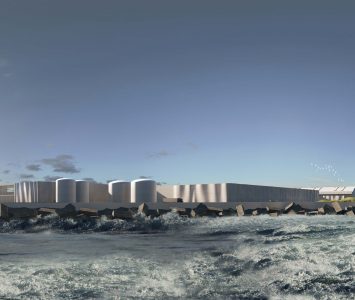Avec une pyramide des âges vieillissante et des prévisions de départs nombreux dans la décennie à venir, le secteur du mareyage est confronté à un véritable défi en termes de main-d’œuvre. L’Union du mareyage français (UMF) et les organismes de formation avancent groupés sur le sujet. Rencontre avec trois acteurs impliqués.
“ Le certificat de qualification professionnelle (CQP)
est l’exemple parfait de l’action pragmatique
d’une branche professionnelle. ”
Peter Samson, secrétaire général
de l’Union du mareyage français
Quel est le paysage du mareyage français aujourd’hui, alors que l’on a observé des concentrations ces dernières années ?
Peter Samson : Cette dynamique est effectivement caractéristique du secteur, avec l’émergence de quelques opérateurs d’envergure nationale. Concrètement, la branche mareyage réuni 480 opérateurs et 10 700 salariés. Il s’agit avant tout d’entreprises installées sur le littoral, plutôt des TPE-PME, mais 15 % d’entre elles assurent désormais 70 % du chiffre d’affaires. Le mareyage demeure le plus gros acheteur des criées avec 65 % de leur chiffre d’affaires et 160 000 tonnes d’achats. Il repose sur trois piliers : le traditionnel, le négoce et la transformation.
Quelle est l'évolution démographique de la profession ?
P.S. : Nous aurons 2 000 départs à la retraite dans la décennie à venir et une pyramide des âges qui n’est pas dans une bonne dynamique : les plus de 45 ans sont désormais 39 % et les moins de 25 ans, 12 % ; le premier chiffre étant à la hausse et le second à la baisse. Les difficultés de recrutement concernent tous les postes, des métiers en tension, comme dans les achats, ou émergents, comme les responsables qualité, même si les ouvriers sont les plus représentés.
Les besoins resteront-ils importants ou peut-on envisager une automatisation et une baisse des besoins de main-d’œuvre ?
P.S. : À schéma constant de production et d’organisation de la filière, l’automatisation ne devrait pas faire une entrée rapide. Nous ne sommes pas dans les pays nordiques et disposons d’une flottille éparse, de la Manche à la Méditerranée, de 4 500 navires, d’une multiplicité de points de débarquement, d’espèces, de calibres… Cela pourrait être un choix, mais il nous ferait aller vers une standardisation des produits à l’heure où le marché demande plutôt l’inverse.
Le recrutement passe par une nouvelle dynamique et de la formation. Pouvez-vous nous détailler cette approche concrètement ?
P.S. : Parallèlement à la formation initiale, l’UMF s’occupe de la formation continue. Il s’agit d’une politique publique mais aussi de branche, avec différentes échelles. Agefos collecte des fonds privés dans la filière et mutualise des moyens pour différents mécanismes : contrat de professionnalisation, compte personnel de formation…
On parle d’une relance des certificats de qualification professionnelle (CQP)...
P.S. : Le CQP est l’exemple parfait de l’action pragmatique d’une branche professionnelle. Ce diplôme, obtenu en six mois, un temps relativement court, n’est pas forcément très coûteux et s’effectue en alternance, donc avec du temps en entreprise. Nous avions déjà créé un CQP d’employé polyvalent des produits de la mer en 2005, dispensé par deux établissements, le Centre de formation aux produits de la mer et de la terre (CFPMT) de Boulogne-sur-Mer et le lycée maritime de La Rochelle. Mi-2017, nous avons lancé un appel d’offres pour élargir leur nombre et sommes passés à neuf aujourd’hui. Soixante personnes ont été formées depuis cette relance, avec un très bon taux d’embauche. Un second appel d’offres, en cours, devrait voir aboutir deux nouvelles candidatures. Fin 2018, nous avons donc décidé de lancer un nouveau CQP sur un autre métier spécifique, celui d’acheteur/vendeur marée. Notre observatoire prospectif des métiers et de la qualification de la branche mareyage a identifié cette opportunité que nous sommes en train d’élaborer précisément.
Qu’en est-il de l’apprentissage ?
P.S. : Il s’agit d’un autre dispositif que la nouvelle réforme de la formation nous permet aussi d’accompagner, mais auquel les CQP ne sont pas éligibles. Le CAP mareyage, oui, même si le contenu doit évoluer, être modernisé et redynamisé. C’est en cours. Et nous tentons de mettre pour cela d’autres acteurs dans la boucle comme les transformateurs et les criées par exemple.
Avez-vous des partenaires dans ces démarches ?
P.S. : Agefos, les régions, Pôle emploi, les missions locales sont des partenaires. Les CQP, notamment, fonctionnent bien avec les dispositifs de retour à l’emploi. Dans un schéma classique, Agefos recherche le dispositif le plus adapté entre les coûts pédagogiques et ceux du salarié ou de la personne formée.
La filière souffre-t-elle d’un déficit d’image et quels arguments faites-vous valoir auprès des jeunes salariés ou en recherche d’emploi ?
P.S. : Nous avons élaboré six vidéos sur différents métiers, que l’on peut retrouver sur notre site internet. Agefos et l’Éducation nationale ont monté la plateforme Bouge ton avenir, sur laquelle nous sommes présents avec des visites à 360°, des interviews, des descriptions de postes… Notre observatoire a réalisé un référentiel d’activités et de compétences qui a abouti a des fiches de poste précises. Nous communiquons en propre mais mettons aussi à dispositions de nos partenaires (adhérents, organismes de formation, syndicats…) du contenu et essayons d’être plus présents dans les salons de l’emploi.
La filière souhaite aussi moderniser le secteur en s’intéressant à des problématiques sociales, comme l’égalité homme-femme ou la réduction des risques au travail (troubles musculo-squelettiques, blessures…). De quelle manière ?
P.S. : Il y a du travail dans cette branche. Elle recrute et les métiers sont variés : production, qualité, R & D, dirigeant… Et comme il existe beaucoup de PME, les progressions possibles sont réelles et inscrites en général dans un véritable développement local. Nous sommes dans le schéma d’une lente érosion et le recrutement est impératif. Mais le mareyage n’est pas seul face à ce défi. Il se situe entre la production et la consommation. Donc tout le monde fait des efforts.
Nous nous saisissons de tous les leviers pour faire avancer la filière. Les conditions d’emploi constituent effectivement un axe important et nous avons négocié un accord d’égalité homme-femme dans un univers à dominante masculine. Les femmes occupent plus de postes à temps partiel, avec des salaires moins bien valorisés.
Par ailleurs, les statistiques révèlent que la branche est accidentogène. Nous avons signé, l’année dernière, une convention nationale d’objectif avec l’Assurance maladie métiers de la mer pour que les entreprises investissent sur cette thématique, accompagnées par les Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat). Nous valorisons aussi des dispositifs moins sectoriels, mais qui constituent des leviers pour des actions concrètes.
Nous avons encore répondu à un appel à candidatures de la plateforme Responsabilité sociale et environnementale (RSE) de France Stratégie pour accompagner les TPE-PME dans cette voie. Nous pensons que le mareyage a beaucoup de choses à dire dans ce domaine et que la thématique peut être très fédératrice.
Propos recueillis par Dominique Guillot
| ❱ Nadine Poitevin, directrice du centre de formation des apprentis (CFA) de Lorient |
|||
|
|
« Nous accompagnons les acteurs
|
||
|
Quel regard portez-vous sur le mareyage vu du côté de la formation ? En janvier 2017, une rencontre était organisée avec le conseil régional et les acteurs de l’emploi et de la formation : Pôle emploi, UMF et l’Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche (Abapp), sur les difficultés de recrutement dans les entreprises de mareyage du port de Lorient. Les mareyeurs ont alors identifié un besoin en compétences au regard de la pyramide des âges élévée et des difficultés à recruter du personnel qualifié. Ils évoquaient aussi un turn-over important. Suite à ce constat, vous avez accompagné la relance des certificats de qualification professionnelle ? Quels arguments faites-vous valoir auprès des jeunes salariés ou en recherche d’emploi ? |
|||
| ❱ Vincent Coatanea, directeur du Centre de formation aux produits de la mer et de la terre (CFPMT) |
|||
|
|
« Une belle dynamique
|
||
|
Qu’elles sont les spécificités du CFPMT en matière de formation ? Quel regard portez-vous sur l’avenir de la filière ? Comment lutter contre le déficit d’image, susciter des vocations et revaloriser les métiers ? |
|||