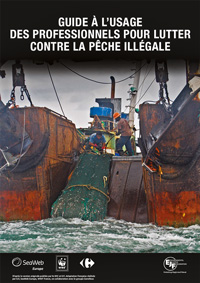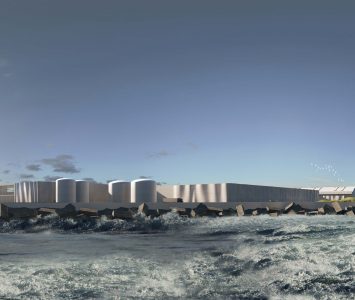Black fish, corruption et fraude économique, trafics d’êtres humains et de drogue, naviguent souvent sur un même bateau. En combattant toutes les racines de la pêche illégale, les États, les ONG, les agences internationales et les professionnels obtiennent des résultats.
 |
|
Antonia Leroy, |
1- PdM : Que pèsent les pêches INN dans les captures mondiales ?
Antonia Leroy : Il est difficile d’évaluer l’économie souterraine. Les estimations se basent sur des données du marché, parfois sur des données provenant des États. La dernière étude de référence l'estime pour la pêche à 23 milliards d’euros par an. La FAO pense que cela s’approche de 15 % des captures. L’organisation planche sur une méthodologie globale pour mesurer si la pêche illégale augmente ou diminue. Il est illusoire de croire à son élimination, en revanche, il est possible de la réduire radicalement en suivant les réseaux financiers pour trouver les bénéficiaires finaux. Comme il est difficile de tout contrôler, il faut travailler là où il y a du risque.
2- Quelles sont les zones les plus touchées par la pêche illégale ?
A. L. : Faute de capacité de surveillance et de contrôles, ou par l’opacité des filières, certaines zones sont plus sensibles que d’autres. Mais la pêche illégale a lieu partout dans le monde. Au-delà de la zone géographique, c’est surtout le commanditaire qui est derrière qui compte. Par exemple, un armement espagnol ou asiatique peut opérer dans les eaux sénégalaises. L’échelle de délit diffère également selon qu’il s’agisse de pêche artisanale ou industrielle.
Stéphane Vrignaud : Les estimations aux États-Unis rejoignent les 20 % de captures totales pêchées illégalement, à ceci près qu’elles englobent la fraude fiscale associée à la pêche illégale. Cela augmente sensiblement le chiffre de 23 milliards d’euros qui représente, à nos yeux, une fourchette assez basse. Selon le secteur géographique, l’espèce, le type de pêcherie, les pratiques de black fish diffèrent, il est donc difficile de savoir si le phénomène régresse ou pas. Des améliorations se dessinent dans certaines parties du monde. En Afrique notamment, grâce à des opérations de contrôle à bord menées conjointement par l’Europe et les États-Unis. Nous travaillons beaucoup avec l’Agence européenne de contrôle des pêches basée à Vigo (Espagne). Depuis l’instauration des règlements INN (1) de l’Union européenne, les flux en provenance de la pêche illégale ont tendance à diminuer. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans la mesure où ce règlement concerne la totalité des produits de la pêche. Une approche basée sur le risque nous paraît plus efficace.
Stéphanie Mathey : La Commission européenne, que nous avons sollicitée sur l’évaluation de la pêche illégale, reprend l’estimation de 20 % dans ses publications. Ce chiffre date d’avant la mise en place de la réglementation et il est question de faire une nouvelle estimation. Même s’il est très difficile de mettre des chiffres sur une activité illégale. En l'absence de mise à jour, les professionnels se démobilisent sur la question : ils se disent que puisque les autorités contrôlent la pêche illégale, cela résout le problème sur le marché européen. Sauf que les procédures diffèrent d’un pays à l’autre, certains saisissent les lots illicites, d’autres les renvoient et ils sont toujours là.
 |
|
Stéphanie Mathey, chargée de mission SeaWeb Europe, nouvellement Ethic Ocean, ONG ayant pour objectif |
3- Le système de carton rouge ou jaune est-il efficace ?
S. M. : L’Europe applique un système de carton jaune, rouge ou vert aux pays à risques mais certaines réalités demeurent. En particulier en Afrique de l’Ouest où les pêcheurs artisans souffrent du pillage des ressources au large par des flottilles inconnues. En Asie, il y a des cartons rouges en cours et beaucoup reste à faire. L’organisation Environmental Justice Foundation (EJF) accompagne les gouvernements asiatiques pour changer les procédures de contrôle au port et de transbordement en mer, pratique très risquée, qui, si elle n’est pas interdite, doit être réglementée. Doivent se mettre aussi en place des procédures de sanctions, sans oublier une surveillance satellitaire digne de ce nom. Autant de moyens qui contribuent à réduire le risque de pêche illégale.
A. L. : Certains gouvernements interdisent le transbordement, d’autres non. Les opérateurs, de leur côté, essayent de trouver des biais pour contourner les mesures. Suite à l’application de la réglementation européenne, des navires changent de port de débarquement vers des ports plus complaisants. Alors que d’autres ports sont moins touchés par les pêches INN. L’enjeu de la coopération internationale est déterminant, en particulier avec des pays comme la Chine où les besoins en poissons sont très importants. Ce marché est particulièrement attractif pour la pêche INN, il y a là une vraie question économique. Mais globalement, les pays s’améliorent.
S. V. : Les pays s’améliorent, c’est vrai, mais rappelons que les produits de la mer font l’objet d’un intense commerce international. Le fait qu’Interpol s’intéresse à la pêche INN montre aussi qu’il y a derrière un trafic qui rapporte beaucoup, quasiment autant que celui de la drogue. Certains pays travaillent bien pour contrecarrer le crime organisé, encore faut-il une collaboration internationale robuste et permanente ainsi que des financements. Toutes les nations n’ont pas les capacités de mettre en place des systèmes de contrôles et de sanctions. C’est là que des organismes comme l’OCDE, le FMI, la Banque mondiale ou l’Union européenne interviennent, mais cela implique une coordination. Ce qui n’est pas toujours le cas. Or, cela paraît indispensable dans l’accès au financement pour éviter, au mieux les doublons, au pire l’argent qui disparaît quelque part sans régler le problème.
4- Quelles sont les avancées en matière de coopération internationale ?
A. L. : Au niveau des organisations internationales, il y a eu des progrès. Chacune avec des mandats différents : l’OCDE a un mandat économique, la FAO un mandat de gestion des ressources marines, Interpol un mandat d’investigation. L’approche criminelle de la pêche illégale montre qu’il y a non seulement de la fraude fiscale mais aussi du trafic d’êtres humains, de drogue et parfois des liens avec le terrorisme. Un premier workshop consacré à la pêche INN et à la criminalité associée a réuni, en octobre, des représentants des ministères des finances et des ministères des pêches, ce qui est assez novateur dans la coopération interagences. Dans un monde de plus en plus intégré et interconnecté, nous devons plus que jamais aider les gouvernements à mettre ces mécanismes en place.
S. V. : En 2013, le président Obama a créé un groupe de travail sur la pêche illégale qui, en moins de 18 mois, a fait travailler ensemble une douzaine d’agences. Ce qui est une révolution aux États-Unis. Elles ont toutes collaboré pour créer un plan d’action qui tienne la route avec un système de traçabilité contre la fraude. Le règlement final a été publié le 8 décembre dernier pour une application au 1er janvier 2018. Sur le plan international, la collaboration des ONG est une composante fondamentale de notre travail pour établir des preuves de pêche illégale. Notre rapport du congrès s’appuie en grande partie sur ceux d’ONG comme EJF ou Oceana, qui ont identifié des navires en pêche illégale. Cela nous sert à pointer du doigt les pays qui ont des bateaux engagés sur ce type d’activité. Nous leur demandons ensuite ce qu’ils font pour les contrer. Diplomatiquement, cette mise en avant est une arme en soi, assez efficace, notamment vis-à-vis de pays réputés « sûrs », y compris dans l’Union européenne. Une fois identifiés, ces pays sont sollicités pour redresser la situation et nous les aidons dans ce sens. Si ces activités sont sanctionnées à leur juste mesure, nous certifions positivement le pays en question et il sort du rapport. S’il ne fait rien, il est certifié négativement et en dernier ressort, ses exportations peuvent être bannies des États-Unis. C’est un exemple de collaboration intergouvernementale avec les ONG pour lutter contre la pêche illégale.
 |
|
Stéphane Vrignaud, représentant européen de la Noaa, |
5- La coopération existe-t-elle déjà au niveau national ?
A. L. : Oui, le ministère norvégien du commerce a géré la coopération interagence et le travail avec le département des taxes a permis de retracer des navires en situation illégale. Il est vrai que les contrôles en mer sont très coûteux, les investigations financières aussi, mais à un niveau moindre si les services coopèrent. Remonter la filière financière permet de déboucher sur le vrai bénéficiaire dont la condamnation mettra un terme à l’activité.
S. V. : À l’échelon international aussi, il y a l’exemple d’un armement espagnol bien connu qui a été condamné et quasiment démantelé. L’armateur a été condamné aux États-Unis, fiscalement et administrativement, avec la collaboration de l’Espagne et de l’Union européenne.
6- L’argument économique pèse-t-il beaucoup dans la lutte contre la pêche INN ?
A. L. : Lorsqu’un navire ne déclare pas ses captures, il ne paie ni taxes ni impôts. Avec la crise financière, les États ont compris qu’il y avait beaucoup de dollars dans la mer. L’argument économique a pris du poids et il s’ajoute à l’argument environnemental. À travers le projet Scale d’Interpol, on s’est rendu compte que la pêche illégale finançait le terrorisme. Il y a aussi de vraies problématiques de financement dans certains pays, notamment au Kenya, où des trafiquants de drogue s’impliquent dans le trafic de poisson. Les armements illégaux réduisent aussi leurs coûts en exploitant abusivement leurs marins. Tous ces éléments incitent les gouvernements à s’y intéresser et cela devient une priorité du G20.
S. M. : Nous avons peu évoqué les coûts environnementaux et humains mais la baisse des captures pousse parfois les pêcheurs à aller plus loin et à pêcher illégalement dans les pays voisins. C’est le cas en Thaïlande. Or, plus ils vont loin, plus il y a de transbordements et les conditions sociales se dégradent à bord. Politiquement, les efforts s’organisent en régions. Plusieurs pays asiatiques se sont rencontrés il y a quelques mois pour répondre aux attentes de la réglementation européenne.
S. V. : L’esclavagisme et le trafic humain commencent à être pris en compte par le règlement INN européen. En Asie, la prise de conscience est tardive mais assez forte de la part des pouvoirs en place pour éradiquer ce fléau. La ministre thaïlandaise des pêches est une femme assez énergique. Elle va même jusqu’à faire couler les bateaux de pêche sous pavillon thaï par sa propre marine nationale afin de s’attaquer au sujet. Si les cas de pêche INN et les abus qu’elle génère arrivent jusqu’aux consommateurs, ils pourront aussi agir à leur niveau.
S. M. : Identifier la pêche illégale nécessite un gros travail d’investigation mais les résultats sont trop rarement portés à la connaissance des consommateurs. Ces derniers attendent implicitement que le poisson soit pêché dans des conditions durables.
A. L. : Grâce au travail des ONG, les abus de la pêche INN sont dénoncés publiquement. Cela concerne les consommateurs mais aussi les banques et les assurances qui pourraient couvrir ou financer l’industrie de la pêche. Alertées sur les questions de trafic humain, elles redoutent que leur image soit associée à des activités illicites portées au grand jour. Il y a également un risque à couvrir ou financer la pêche INN. Le démantèlement d’une filière peut entraîner la banqueroute d’établissements financiers.
S. V. : Je reviens sur la raréfaction des ressources : deux milliards d’êtres humains comptent sur le poisson comme apport en protéines. Si la pêche INN continue dans certaines zones, il n’y aura plus rien. Des conflits émergeront ainsi que des mouvements de population. En ce sens, la pêche illégale est un facteur aggravant de conflits internationaux.
7- Y a-t-il un lien entre pêche illégale et substitution d’espèces ?
S. V. : La substitution d’espèces s’associe parfois à la pêche illégale. Une pêche peut être autorisée sur une espèce et pas sur une autre qui lui ressemble. Il suffit de faire passer la seconde pour la première, c’est du blanchiment de poisson. Cela se passe partout, dans les ports, en criées…
S. M. : Et lors du transbordement en mer. Un bateau « pirate » transborde ses prises sur un bateau « légal ».
|
Un guide à l’usage
Fruit d’un travail entre EJF, Ethic Ocean, WWF et avec la collaboration de Carrefour, le guide présente le système réglementaire européen et les outils d’évaluation du risque à l’import. La responsabilité des opérateurs réside à minima dans la recherche d’informations sur la chaîne d’approvisionnement. En complément d’un travail approfondi sur la traçabilité, l’ouvrage, disponible auprès d’Ethic Ocean (ex-SeaWeb) devrait les y aider. |
8- Quelle est l’approche réglementaire aux États-Unis ?
S. V. : Les États-Unis ont une approche complémentaire à celle de l’Europe. L’Union européenne se base sur l’État du pavillon pour contrer le problème. Nous nous basons sur les importateurs qui doivent démontrer, par leurs propres moyens, que leur poisson est légal, avec les documents qu'ils souhaitent et dont ils disposent. Un bon opérateur doit disposer d’une comptabilité matière digne de ce nom, accompagnée d’un document officiel, qui, si on lui demande, atteste la légalité du produit. L’objectif est de ne pas mettre d’obstacles sur les flux. Ce cadre réglementaire cible 15 espèces pour limiter les coûts.
C’est pourtant facile de mettre un tampon officiel sur un papier…
9- C’est pourtant facile de mettre un tampon officiel sur un papier…
S. V. : Cela existe. Prenons l’exemple d’une cargaison de 100 tonnes de poisson entier qui part des États-Unis vers un autre pays pour y être transformée et revient sous forme de filets avec un certificat de capture en bon et due forme. Au pays transformateur d’attester que le poisson travaillé provient bien de ce lot légalement identifié. Sauf qu’il est difficile de savoir, quand le poisson ressort du pays, s’il n’a pas été mélangé dans l’usine avec d’autres provenances. Même les systèmes les plus précis sur le plan administratif n’arriveront pas à éviter ce genre de pratique. Nous avons choisi l’efficacité en responsabilisant l’importateur. Le règlement américain s’appuie en parallèle sur des textes dissuasifs qui prévoient la prison, le cas échéant.
S. M. : Le poids qui pèse sur l’importateur est déjà lourd. L’analyse du risque suppose de répondre à de multiples questions. Ce métier implique d’aller dans les ports d’origine ou dans les usines pour cerner au mieux les problèmes. Mieux vaut savoir ce que l’on achète. Si le prix proposé est anormalement moins cher que les autres, il y a là un indice. Le guide que nous avons sorti (encadré p.18) pour lutter contre la pêche illégale facilite la démarche de questionnement. Au professionnel, ensuite, d’adapter son plan de contrôle.
10- Qu'attendez-vous de plus pour combattre la pêche INN ?
A. L. : Davantage de volonté politique pour renforcer la transparence, échanger les données, éviter la redondance entre les actions des États, des ONG et des agences, mobiliser aussi des moyens. Cela demande du temps mais ce temps est nécessaire pour lutter efficacement.
S. V. : Une collaboration internationale plus poussée et permanente, c’est fondamental. Convaincre les États, les importateurs du bien-fondé de la lutte contre la pêche INN en insistant sur les effets bénéfiques d’une filière propre. Ne pas relâcher la pression publique, y compris auprès des consommateurs : si l’acheteur boycotte le produit, la source se tarit d’elle-même.
S. M. : Il faut mettre en avant, auprès des États, des initiatives comme le registre unique de navires avec un numéro de l’Organisation maritime internationale. Les inciter à ratifier les mesures du ressort de l’État du port, premier accord international de la FAO contre la pêche illégale. Idem avec la convention OIT 188 sur le travail en mer, une base très claire, très complète pour contrôler les problèmes de travail forcé. Dans l’absolu, le combat contre la pêche INN supposerait une surveillance satellitaire universelle, et même des cartes où l’on voit les navires se promener, en temps réel !
Propos recueillis par Céline ASTRUC et Bruno VAUDOUR
Rédaction : Bruno VAUDOUR - Photos : Thierry NECTOUX
|
FAO : les mesures du ressort de l’État du port
C’est le premier accord international contraignant pour la pêche illégale, 30 pays et l’Union européenne l’ont déjà ratifié en juin 2016. L’accord FAO indique les mesures de contrôle portuaire et prévoit de refuser l’accès des ports aux navires suspects. Les bateaux étrangers ne peuvent débarquer que dans les ports listés par les pays ayant ratifié l’accord. Ils se soumettent aux inspections et apportent la preuve de leurs droits de pêche. |