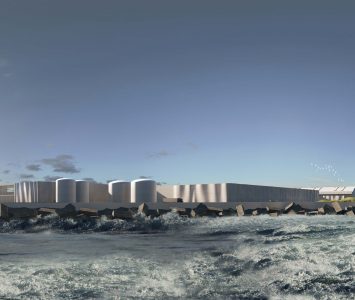Métiers peu connus, manque d'attractivité de la filière, nouvelles attentes des jeunes sur le marché du travail, le tout sur fond de crise sanitaire, font que la filière des produits de la mer peine à recruter et former. Poissonnerie, mareyage et grande distribution font tout pour attirer les plus jeunes, et les écoles et centres de formation se mobilisent. Pour quels résultats ? Avec quels leviers d'action ? Comment ramener les jeunes vers les métiers de bouche ?
[Les participants]
- Vincent Coatanea – Directeur du centre de formation aux produits de la mer et de la terre à Boulogne-sur-Mer
- Pierre-Luc Daubigney – Secrétaire général de l’Organisation des poissonniers écailleurs de France.
- Peter Samson – Secrétaire général de l’Union du mareyage français
- Laurent Vichard – Directeur marché Marée à Carrefour
- Audrey Allien – Responsable recrutement opérationnel à Carrefour.
- Véronick Alba – Chargée de recrutement métiers de bouche à Carrefour.
- Sylvain Monier – Responsable Formation à Carrefour, en charge de l’école PFT
- Louis-Laurent Preux – Directeur de projet, en charge des passerelles et prospectives métiers à Carrefour.
PDM – Quels sont les métiers sous tension, et à votre avis pourquoi ?
Vincent Coatanea – Il faut dissocier la production et les métiers de bureau. En ce qui concerne le mareyage, il y a une pénurie de fileteurs et d'ouvriers de marée. Cela peut s'expliquer par plusieurs phénomènes, à commencer par le manque d'attractivité de la filière. Et c'est paradoxal, car les entreprises ont fait beaucoup d'efforts pour diminuer la pénibilité, améliorer l'ergonomie ou les bâtiments. Le métier est moins dur qu'il y a trente ans ! La polyvalence est un autre sujet. Elle est de plus en plus prônée par les TPE et PME. Un opérateur doit par exemple savoir faire des contrôles qualité, car dans le mareyage, les approvisionnements peuvent être aléatoires. Pour les métiers de bureau, le poste de commercial est devenu crucial. Du fait des difficultés de sourcing, il faut désormais parler deux ou trois langues. Enfin, plus des deux tiers des dirigeants d'entreprises de mareyage ont plus de 50 ans, ce qui est très inquiétant pour l'avenir. En ce qui concerne l'industrie, en première transformation, les machines restent simples. Les besoins sont donc peu ou prou les mêmes que dans le mareyage. Dans des usines de seconde transformation, on se dirige vers la robotique, voire la cobotique, et les industriels recherchent des profils plus attirés par l'informatique et le numérique.
Peter Samson – Le constat de Vincent Coatanea est sans doute plus vrai à Boulogne qu'ailleurs, car le marché y est très tourné vers l'import. Les 31 métiers du mareyage sont sous tension. Pour rappel, la branche du mareyage est constituée à 60 % d'ouvriers, où la pénurie est particulièrement palpable, en particulier sur le filetage. Mais les métiers du commerce sont également très recherchés. Les marges se construisent à l'achat ! C'est une tendance de fond et très structurelle, ce qui la rend très inquiétante. Depuis le Covid, la situation s'est dégradée sans que l'on puisse très bien l'expliquer, mais ce phénomène inquiète les chefs d'entreprise. Les métiers du mareyage sont mal connus, et souffrent en plus d'une image de métier difficile. Les contraintes sont réelles, comme le froid ou l'humidité, mais il y a aussi de vrais avantages : perspectives de carrière, conditions de travail améliorées. Nos métiers ont du sens.
Pierre-Luc Daubigney – Les mêmes tendances se retrouvent dans la poissonnerie, avec un regain de dynamisme dans l'artisanat depuis deux ans. De nombreux chefs d'entreprise contactent l'Opef pour recruter, mais mettre en adéquation l'offre et la demande n'est pas aisé. La dissémination des poissonneries sur le territoire complique les recrutements. Pour y remédier, nous organisons des formations très localisées sur les côtes. La transmission d'entreprise constitue un autre enjeu majeur. Une étude de 2017 montre que seulement 13 % des chefs d'entreprise âgés de plus de 50 ans connaissent leur repreneur. Certains doivent rester en activité plus longtemps que prévu. Depuis la crise, beaucoup de petites structures traditionnelles et artisanales ont vu le jour : pour celles-là, le cap des trois ans sera crucial. Comme l'amont, nous avons un défaut d'attractivité. Difficile de vendre le métier de poissonnier à un collégien aujourd'hui ! Le recrutement passe par le bouche-à-oreille, les étudiants qui se reconvertissent après un stage, l'atavisme familial, etc. En 2018-2019, on comptait 156 apprentis en poissonnerie pour 8 000 salariés, ce qui est particulièrement faible. L'offre crée aussi sa propre demande, grâce à des centres de formation efficaces comme le CFPMT à Boulogne, mais on manque de relais locaux. En boucherie, les apprenants sont logés pendant les formations, c'est une piste dont nous pourrions nous inspirer.
Véronick Alba – Je crois que les distributeurs ont fait l'erreur de trop miser, pour les chefs de rayons, sur des profils diplômés bac + 5. On a cassé une chaîne d'évolution, avec des seconds de rayons qui n'ont plus de perspectives. Pour les chefs de rayon, un niveau BTS est suffisant à mon avis, avec des profils qui sont plus pratiques et pragmatiques.
PDM – Quelles solutions mettez-vous en œuvre dans vos structures pour améliorer l'attractivité de la filière ?
Vincent Coatanea – Le CFPMT a mis en place avec les branches diverses formations, comme un CQP « Employé de la mer polyvalent » pour répondre aux besoins des entreprises de mareyage. Nous avons par ailleurs développé une formule en douze semaines, pour former au CAP poissonnerie, en excluant les matières générales grâce à une dérogation de l'Éducation nationale.
Sylvain Monier – Pour redonner de l'attrait aux métiers de bouche, Carrefour a mis en place des formations en interne avec, notamment, la création d'une école des produits frais et traiteur. Cinq classes ont été ouvertes depuis janvier 2022, dont une dédiée au rayon marée. Pour cette dernière, l'objectif est de proposer une formation certifiante aux collaborateurs qui exercent au rayon marée principalement. À l'issue du cursus, ils obtiennent un CQP « Vente de produits marée », leur permettant de faire reconnaître leurs compétences. Nous espérons que cela va susciter l'intérêt d'autres employés en magasin, et aussi des apprentis. Il suffit de mettre le pied à l'étrier dans les rayons pour susciter des passions. Cette école offre aussi l'opportunité à des collaborateurs d'autres rayons que les métiers de bouche d'accéder à ces formations. L'expérience montre que, souvent, ils y vont « à reculons ». En revanche, une fois qu'ils occupent le poste, ils sont la plupart du temps très satisfaits et ne veulent plus revenir à leur ancien poste. Il s'agit donc bien d'un problème d'image.
Laurent Vichard – Ce sont des changements importants qui impactent nos organisations en interne notamment les fonctions support comme l'achat. Par exemple, les acheteurs interviennent de plus en plus en support des magasins. Par ailleurs, les changements de consommation font aussi évoluer la filière, avec de plus en plus de libre-service. Les acteurs de l'amont vont aussi devoir prendre en compte ces nouvelles attentes.
Peter Samson – L'UMF pilote une convention collective en propre, c'est précieux. Nous avons également développé au sein de la branche nos CQP, qui sont des formations courtes avec du temps en entreprise, avec un taux d'embauche de 95 % dans le mareyage. Notre CQP « Employé polyvalent » fonctionne bien, et compte une centaine de diplômés depuis 2017. Fort de ce succès, nous avons créé en 2020 le CQP « Acheteur-vendeur marée », avec des fonctions de plus en plus partagées. Je rejoins le constat de Laurent Vichard sur l'organisation de la filière. Le mareyage en particulier est en pleine révolution, notamment sur les nouvelles compétences de l'acheteur-vendeur, désormais reconnues par France Compétence. Ces métiers sont à la fois en pénurie, et en pleine évolution.
Véronick Alba – Pour rebondir sur les propos de Laurent sur l'évolution des habitudes de consommation, dans le cadre de notre programme Act for Food, Carrefour promeut le « mieux-manger ». Le rayon marée y contribue aussi en commercialisant, par exemple, des produits issus de la pêche responsable.
Vincent Coatanea – S'agissant de l'attractivité des CFA, on peut se poser la question du défaut d'image de la filière. Au CFPMT, nous avons créé deux logiciels pour rendre la formation plus « fun » et adaptée à la nouvelle génération connectée. L'un d'eux est par exemple utilisé pour apprendre à reconnaître les espèces. Le numérique est un bon levier pour redorer le blason de ces métiers. Il faut aussi changer de modèle d'enseignement, miser sur la pédagogie inversée et rendre les formations plus participatives. Nous devons faire confiance aux apprenants. Pour acculturer les gens, que ce soit en formation initiale ou continue, il est nécessaire d'être en contact étroit avec les entreprises car elles connaissent bien la filière, le marché et l'évolution des métiers. Nous accrochons donc des options productions halieutiques à nos BTS commerce, et pro-posons un master en management de PME. Le but est de rendre les diplômés opérationnels dès la sortie des études. Nous avons à mon sens besoin de formation initiale externalisée. Je respecte totalement les formations internes mais, sur certains aspects, je reste sceptique. Par exemple, pour former un groupe d'apprenants au filetage, nous avons utilisé l'an dernier 20 tonnes de matières premières. Former des jeunes à ces métiers réclame du volume et le respect de certaines contraintes, comme le respect de la chaîne du froid.
Pierre-Luc Daubigney – Je partage complètement ce qui a été dit par Vincent Coatanea. L'attractivité par le numérique est fondamentale, et nous devrions mutualiser ces outils au sein de la filière pour les diffuser sur tout le territoire. Les CFA boucherie ont développé des outils de découpe virtuelle ou encore le « prêt » de viande : des boucheries artisanales leur fournissent de la matière première qu'elles récupèrent ensuite une fois transformée pendant la formation. Une telle solution est plus difficile à imaginer en poissonnerie, notamment car le poisson est plus fragile que de la viande. Mais c'est inspirant. Il faut traiter du volume pour être bien formé.
Laurent Vichard – Pour revenir sur l'attractivité de la filière de manière générale, il ne faut pas hésiter à communiquer de manière positive afin de la valoriser et la défendre ; notre filière a énormément d'atouts, de points forts. Nous travaillons avec France Filière Pêche sur une campagne de communication autour de l'attractivité des métiers de la pêche et de l'aquaculture, visible depuis le 20 janvier.
Peter Samson – Cette campagne France Filière Pêche, avec la campagne du gouvernement et du plan de relance Entrepreneurs du vivant, sont des actions très importantes. C'est essentiel de travailler en filière à ce type d'action. Le mareyage a un enjeu d'image, mais une communication grand public sur notre seul maillon ne serait pas forcément pertinente. Collectivement, on peut être plus efficace. Je trouve le parallèle de Laurent Vichard entre l'attractivité d'un point de vue métier et d'un point de vue consommation très inté-ressant. Nous ciblons le même type de public, plutôt jeune et qui se détourne de la filière que ce soit pour consommer ou travailler.
Vincent Coatanea – Effectivement, l'attractivité, c'est le cœur du sujet. Avec le CFPMT, nous avons créé des partenariats avec des clubs de sport locaux. Au-delà d'un simple sponsoring financier des clubs, nous avons cherché avec eux comment travailler au service de tous. D'un côté, nous recherchons des apprenants. De l'autre, eux ont un certain nombre de licenciés au chômage ou sans formation. Par ce biais, nous avons signé les premières conventions il y a quatre ou cinq mois, et trois stagiaires ont déjà été recrutés.
PDM – Des mesures sont-elles prises par les pouvoirs publics pour faciliter l'accès à la formation et le recrutement ?
Vincent Coatanea – La réforme Macron a bouleversé la formation et boosté l'apprentissage. Avant, nous devions nous charger de récupérer la taxe d'apprentissage pour financer les centres de formation. Le gouvernement a décidé de s'occuper du financement, ce qui nous a donné une bouffée d'oxygène. Les coûts contrat ont été bien négociés au niveau de la branche.
Pierre-Luc Daubigney – La réforme des coûts contrat a donné un appel d'air aux centres de formation, qui n'ont plus à gérer des campagnes de taxes d'apprentissage très chronophages. Mais il a fallu pour cela monter des dossiers très techniques, pour montrer aux autorités que nous avions besoin de coûts contrat élevés. Nous avons réussi à les obtenir à l'arraché en poissonnerie traditionnelle.
PDM – Quels sont les leviers pour communiquer sur l'intérêt de la filière des produits de la mer, et en général des métiers de bouche ?
Peter Samson – La question de la formation a été largement évoquée, mais les conditions de travail sont tout aussi importantes. Dans le mareyage, les taux d'accidentologie restent plus importants qu'ailleurs. En tant que branche, nous avons une responsabilité en la matière. 95 % des entreprises de mareyage sont des PME qui n'ont pas forcément les équipes RH pour gérer ces questions d'ergonomie des postes de travail, de pénibilité et de sécurité. L'UMF outille les entreprises et porte plusieurs projets, comme la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences [GPEC]. La plateforme Mes outils RH permet de générer des fiches de poste, des grilles d'entretien annuel, etc. Dans le même état d'esprit, nous portons le projet PRISM [prévention des risques mareyage] au titre du Feamp pour créer un référentiel risque et pénibilité, et venir enrichir l'outillage RH de l'UMF. Travailler sur ces points répond aux contraintes réglementaires, mais joue aussi sur l'attractivité de nos métiers. Les entreprises doivent être pro-actives sur ces questions. Nous arrivons à faire ces investissements grâce au Feamp, et aussi aujourd'hui au plan de relance. Le dialogue social fait également partie intégrante des conditions de travail, avec par exemple une négociation salariale chaque année, qui est aussi une part de l'attractivité. Du fait des très faibles marges dans le secteur, le mareyage a toutefois du mal à proposer des grilles de salaires incitatives.
Laurent Vichard – Le mareyage a d'autres avantages que la rémunération, il offre aussi le cadre et la qualité de vie sur les côtes comparé aux grandes villes.
Peter Samson – C'est tout à fait juste. Surtout depuis la crise sanitaire, le littoral attire de plus en plus. Nous espérons que les campagnes de communication mettront aussi cela en avant.
Audrey Allien – En 2021, nous avons travaillé avec Bonanza, une start-up spécialisée dans le recrutement via les réseaux sociaux, à la réalisation d'une campagne originale diffusée sur Tik Tok et Instagram. Adaptée aux jeunes, elle nous a permis de créer du lien et d'interagir avec eux grâce à des stories ludiques sponsorisées, renvoyant au site de recrutement de Carrefour. Ce nouveau mode de communication de recrutement nous a permis de rentrer en contact avec 478 profils, aboutissant au recrutement de sept personnes. Nous comptons réitérer cette année ce mode de promotion de nos métiers de bouche.
Vincent Coatanea – Je reviens sur la RSE [responsabilité sociale des entreprises]. Cette notion est vraiment dans l'air du temps, et c'est une vraie chance. En tant que centre de formation, nous avons des devoirs en la matière vis-à-vis de nos clients. Par exemple, ne pas enseigner le travail d'espèces de grands fonds – menacées –, ou veiller à la sécurité de nos apprenants. Nous avons également travaillé avec Veolia sur un programme qui a permis d'économiser 6 000 litres d'eau par jour. La RSE c'est aussi la transparence, et je souscris totalement à la certification Qualiopi. Nous avons des obligations de transparence sur la qualité, cela nous permet de nous remettre en question en tant qu'organisme de formation. Aujourd'hui, la RSE est presque devenue un mode de vie pour nous. Cela joue aussi largement sur l'attractivité de nos métiers.
Sylvain Monier –J'abonde totalement dans le sens de Vincent Coatanea sur la certification Qualiopi qui est un gage de qualité. Notre centre de formation interne vient d'ailleurs d'être référencé Qualiopi. Quant à notre campagne de recrutement sur Tik Tok et Instagram, dont parlait Audrey Allien, c'est une réussite. Il faut savoir changer nos voies de recrutement pour s'adresser aux jeunes là où ils sont, c'est-à-dire sur certains réseaux sociaux. Il faut intégrer davantage le digital dans nos façons de travailler et de communiquer.
Pierre-Luc Daubigney – Notre difficulté dans la poissonnerie, c'est la décentralisation. Chaque campagne de communication demande d'énormes moyens. En la matière, le travail avec France Filière Pêche est essentiel pour communiquer à large échelle. Au niveau de la branche, je rejoins Peter Samson sur les référentiels de pénibilité, les fonds d'action sociale pour la sécurité au travail. La volonté de l'Opef est de créer un carcan protecteur. Le salaire est aussi un facteur d'attractivité. En poissonnerie, nous avons la grille des métiers de l'artisanat la plus élevée juste derrière les bouchers. Ce salaire relativement élevé nous rend peu compétitif en ville ou à Rungis, mais est très attractif en région, avec des entreprises plus fragiles et des coûts de la vie plus bas qu'à Paris. Il nous manque encore, mais on y travaille, une communication métier à destination des jeunes, qui promeut la profession. La boucherie est vraiment en avance sur nous sur ces questions, nous échangeons avec eux pour nous inspirer de leur communication et leurs formations.
Peter Samson – La notion de RSE, qui à mon sens reste un moyen et non une fin, pourrait être mieux mobilisée au niveau du mareyage. Elle peut être un levier de communication en termes d'économie locale ou de qualité des produits. Il est possible de raconter de belles histoires autour du mareyage, mais c'est davantage un problème de formalisation que de fond. L'UMF a pour ambition d'outiller ici aussi les entreprises sur cette question, avec notamment un outil d'autoévaluation de leur démarche RSE.
PDM – Merci à tous pour ces échanges riches et constructifs, qui nous montrent qu'en additionnant des petits pas, la filière peut trouver des solutions.
Vincent Coatanea – Ce sont des échanges fondamentaux à avoir au sein de la filière, nous devrions discuter davantage, entre recruteurs et formateurs, entre l'amont et l'aval.
Sylvain Monier – C'est effectivement grâce à des petits pas, chacun à sa manière, que l'on fait progresser cette filière, qui a beaucoup de qualités et d'attraits.
Texte : Fanny Rousselin-Rousvoal