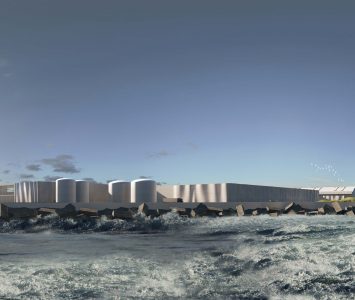Les dixièmes Assises de la pêche et des produits de la mer, organisées par Produits de la mer, le marin, Cultures marines et Ouest-France, se sont déroulées à Granville les 12 et 13 septembre. Entre image de la filière, nouveaux consommateurs et professionnels, crises sanitaires et, Normandie oblige, bulots et coquilles Saint-Jacques, le programme des tables rondes était dense.
Dominique GUILLOT - Photos Ilago
| ❱ Répondre aux attaques contre l’image de la filière |
||
| Avec : Étienne Bourmont, éleveur laitier ; Jean-Charles Pentecouteau, directeur du programme France du MSC ; Sandrine Place, gérante de Rep-publica ; Chloé Serre, directrice d’Interbev Normandie et Jacques Woci, président de France Filière Pêche. | ||
|
“ Les pêcheurs, comme les agriculteurs, sont engagés Didier Guillaume, Ministre
|
||
|
Lors de son discours inaugural des Assises de la pêche et des produits de la mer à Granville, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, a déclaré : « Les pêcheurs, comme les agriculteurs, n’ont pas envie d’empoisonner ni de polluer la mer et la terre. Ils font néanmoins face à l’agribashing. Or, les nouveaux investissements visent une empreinte réduite sur l’environnement et l’État vous soutient. Vous êtes engagés dans la transition écologique et devez être respectés. » Bonne entrée en matière pour la table ronde consacrée à l’image de la filière, qui présentait l’originalité de croiser les expériences entre filières. Sandrine Place, de l’agence de conseils Rep-publica, a souligné d’emblée le contexte de défiance généralisée dans lequel s’inscrivent ces attaques. « Vous n’êtes pas les seuls : l’agroalimentaire, l’agriculture mais aussi les sociétés de services et l’industrie sont pris à partie, notamment via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, il faut se rendre acceptable, disposer d’un permis d’opérer face notamment aux ONG, pas forcément représentatives, mais disposant d’une grande visibilité et qui font l’opinion. » Étienne Fourmont, éleveur de vaches laitières dans la Sarthe a, lui, décidé de devenir agri-youtubeur pour partager le quotidien de son métier : « Il faut expliquer, sinon d’autres vont le faire sans rien y connaître. Et le message ne doit pas venir d’une interprofession ou d’un syndicat », perçu comme une communication financée et donc biaisée. « La mer déclenche toujours de la passion et le pêcheur de la sympathie, constate de son côté Jacques Woci, président de France Filière Pêche. Mais, situation paradoxale, son travail, la pêche, est mal perçu et méconnu. » Le MSC peut-il constituer un pare-feu ? « Le consommateur, perdu, a besoin de repères », estime Jean-Charles Pentecouteau, son directeur France. Tout en rappelant que « nous sommes aussi visés, car nous sommes partie prenante. On nous reproche de soutenir des techniques controversées comme le chalut de fond ou les dispositifs de concentration du poisson. Alors que les pêcheries sont à considérer par zone, espèce… Mais nous sommes certainement une partie de la solution pour la filière. Nous devons affirmer notre légitimité et notre indépendance ». En conclusion, Jacques Woci a détaillé les axes stratégiques choisis par la filière : une communication sur les aspects positifs (qualité, produits, préservation…), reconquête des jeunes générations, vulgarisation d’une filière compliquée, mais encadrée et réglementée, etc. « Il faut instaurer une confiance avec les prescripteurs d’opinion et continuer à valoriser notre marque Pavillon France. » |
||
| ❱ Comment faire face à la baisse de consommation de produits de la mer chez les jeunes ? |
||
| Avec : Jérôme Lafon, délégué filière pêche et produits de la mer de FranceAgriMer et Bernard Benassy, directeur de la société coopérative artisanale de poissonniers professionnels Poissonnier Corail. | ||
|
|
||
|
« Oui, il existe une baisse de la consommation chez les jeunes, mais c’est en fait l’ensemble de la consommation des produits de la mer qui diminue », recadre d’emblée Jérôme Lafon, de FranceAgriMer. Ils ne représentent qu’1 % de ce que l’on mange, alors que les politiques de santé publique recommandent d’en consommer deux fois par semaine. Malgré cela, les volumes baissent. « Notre objectif, en tant que puissance publique, est d’aller chercher le tiers des Français qui n’en consomme quasiment jamais. » Et ne pas perdre l’autre tiers qui n’en achète qu’une fois par semaine. Le dernier tiers, recruté parmi les plus âgés (et effet prix oblige, les CSP +), reste fidèle à la double ration hebdomadaire. Pour les enfants, en général, la cantine représente un quart de la consommation. Globalement, la restauration hors foyer constitue un secteur important pour la filière. Les habitudes de consommation méritent ensuite d’être observées plus en détail : « Au chapitre des conserves, les actes d’achat varient fortement entre thon listao, miette et germon. La moitié des achats des jeunes en poisson est réalisée sur du préemballé, alors que c’est seulement 20 % pour le reste de la population. Autre exemple, la part du saumon bio chez les moins de 35 ans est deux fois supérieure à celle des autres générations. » D’où la pertinence du label Pêche durable lancé par FranceAgriMer. Dans la poissonnerie traditionnelle, le constat est plus tempéré pour Bernard Benassy, de Poissonnier Corail, qui réunit 130 boutiques en France. « Nous privilégions les installations hors centre-ville, là où il y a de la place pour le stationnement et pour une offre importante de produits : poissons et coquillages, préparations et services, mais aussi du traiteur cru et chaud, qui représente désormais 30 % du chiffre d’affaires. Notre panier moyen est de 40 euros. » L’offre doit être facile et large avec des produits prêts à consommer. « La casquette de marin et le tablier, c’est fini. Il faut des concepts plus modernes. Raconter une histoire, oui, mais cela passe davantage par de l’information : sur la technique de pêche, le lieu, la ressource… » |
|
|
| ❱ Bulots, saint-jacques, comment mieux gérer ressource et prix ? |
||
| Avec : Didier Leguelinel, pêcheur bulotier, membre de la commission bulot de Normandie Fraîcheur Mer (NFM) et Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie et président de NFM. | ||
|
|
||
|
« En Normandie, le bulot pèse 8 000 à 10 000 tonnes pour une valeur de 20 millions d’euros. » Didier Leguelinel, pêcheur bulotier, plante le décor. « Dans l’ouest Cotentin, il se pêche depuis les années soixante et depuis plus récemment en Manche est. Or, lorsque l’on est en monoactivité, la pêche doit être durable et il faut valoriser les prix. Au début, nous avons beaucoup pêché et mal vendu, avant de constater qu’en diminuant la pression de pêche, nous augmentions les prix. » D’où des quotas, une taille minimale européenne, un temps de repos biologique… Les mesures de valorisation ont suivi celles de protection. « Il y a dix ans, nous avons lancé les projets MSC et IGP (indication géographique protégée). » Obtenues respectivement en 2017 et 2019, elles permettent de gagner 50 centimes/kg |
|
|
| ❱ Gérer et anticiper les problèmes sanitaires : l’Anisakis et les crises en conchyliculture |
||
| Avec : Mélanie Gay, cheffe d’unité adjointe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; Hélène Keraudren, chargée de mission chez France Filière Pêche et Thierry Hélie, président du comité régional de la conchyliculture Normandie - mer du Nord. | ||
|
|
||
|
Vendre des produits de qualité et sains, c’est le souci de toute la filière. Gérer en toute transparence les parasites dans les poissons et les virus dans les coquillages constitue donc un impératif pour son image. « Il existe beaucoup de parasites dans les produits de la pêche, mais tous sont loin de présenter de réels dangers pour l’homme, rappelle en introduction Mélanie Gay de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). L’Anisakis, un ver que l’on trouve dans les poissons mais qui ne se développe pas chez l’homme, peut néanmoins induire des pathologies, digestives ou allergiques par exemple. La recommandation est de congeler les poissons sauvages avant de les consommer crus. » Aucun facteur simple n’explique la présence du parasite. Selon un plan de surveillance récent, jusqu’à 60 % des produits (filets, darnes…) étaient touchés. « Mais nous avions ciblé les espèces les plus à risques : cardine, merlu, lingue bleue, merlan, lotte… » Un problème face auquel la profession avance groupée. « L’Union du mareyage français nous a sollicités sur le sujet dès 2015, indique Hélène Keraudren, de France Filière Pêche. Ont émergé des besoins en termes de communication, pour dépasser la méconnaissance et les tabous. Nous avons alors élaboré un guide des bonnes pratiques à destination de l’ensemble de la filière. » Les points positifs en France ? Nous consommons le poisson plutôt cuit et la réglementation sanitaire protège bien le consommateur. Reste que, dès le pont du navire, le nettoyage de la cavité abdominale est un impératif. Un projet Feamp baptisé Attila s’attache à l’élaboration d’un outil technique efficace. Un autre analyse les conséquences des rejets en mer des parties contaminées. |
|
|
Moment de bonheur…

|
Un sentiment de fierté et de bonheur s’est diffusé dans la salle dense des Assises, en fin de matinée, le vendredi 13 septembre. Quatre jeunes venaient d’évoquer leur parcours pour arriver à des postes de mareyeur, marin-pêcheur et conchyliculteur. |
Pierre Gouix, responsable commercial chez Rouen Marée ;
Julien Mouton, pêcheur ; Ambroise Vendé, pêcheur
et Malo Vivier, ostréiculteur.