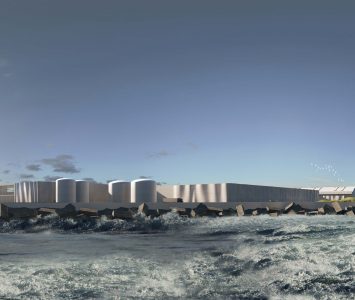Face à la vague locavore, les produits d’importation n’ont pas forcément bonne presse. D’autant plus quand ils sont surgelés et que les médias grand public multiplient les enquêtes sur les dessous du panier de la ménagère. Ce qui passe souvent par la dénonciation de fraudes et autres malversations. Retour avec Pascale Maugy, Pdg de Cosmos Foods, spécialiste du sourcing, et Alexandre Bonneau, du SNCE, le syndicat des produits surgelés, sur les outils de protection de la filière.
 |
 |
|
|
Alexandre Bonneau, secrétaire général du Syndicat national du commerce extérieur des produits congelés et surgelés (SNCE). Celui-ci rassemble une soixantaine d’opérateurs de l’importation des produits |
Pascale Maugy, Pdg de Cosmos Foods, administratrice du SNCE. |
1- PDM : Le Syndicat national du commerce extérieur des produits congelés et surgelés (SNCE) dénonce le traitement médiatique des filières alimentaires. À votre avis, les opérateurs disposent-ils d’outils pour se prémunir des fraudes ?
Alexandre Bonneau : Dans le documentaire Mollo sur le cabillaud de Julie Lotz, diffusé sur France 5, par exemple, nous avons observé l’utilisation d’images brutales d’injection de produit par aiguille, totalement déconnectées des produits échantillonnés et analysés dans le reste du reportage. C’est à notre sens ce qui marque les téléspectateurs, alors que les résultats ne fournissent, au final, pas d’éléments litigieux. Dans la veine de nombreux reportages à charge contre l’alimentaire, le doute s’installe et les gens s’inquiètent sur ce qu’il consomme. Or, sur le sujet de l’eau ajoutée dans les aliments particulièrement, nous disposons d’un outil simple et efficace d’identification des risques.
2- Vous voulez parler du contrôle du H/P élaboré à la suite de l’étude Fraud’filets ?
Pascale Maugy : Le contrôle du H/P (humidité/protéine) est le résultat de l'étude Fraud’filets, initiée en 2010 et finalisée en 2013. Il s’agissait d’une mobilisation d’acteurs professionnels. Nous n’avons pas attendu que les médias s’emparent du sujet pour faire face à la concurrence déloyale de gens qui travaillent mal. Je suis dans les métiers du sourcing depuis très longtemps et soucieuse de l’amélioration continue des bonnes pratiques de notre profession en utilisant tous les nouveaux outils mis à notre disposition. L’importation n’est pas à la mode, mais la production nationale de la pêche couvre à peine 10 % des besoins. Il est difficile de succomber à la tendance du locavore dans le domaine. Notre rôle est de satisfaire les besoins des consommateurs en assurant leur approvisionnement avec des produits totalement sûrs et d’une qualité optimale. Notre fonction est également de rechercher des espèces inexistantes sur nos côtes.
A.B. : En 2010, il y avait beaucoup de suspicions, autour du pangasius notamment, et les opérateurs pouvaient déclencher en direct des analyses pour des recherches d’additifs. L’idée a été de mettre en lumière un paramètre qui soit rapide, économique et efficace pour identifier une pratique éventuelle d’ajout d’eau. Financée par FranceAgriMer et le Fonds européen pour la pêche (FEP), Fraud’filets, dédié à la mise en évidence des fraudes en eau ajoutée dans les filets de poissons surgelés, a nécessité des travaux complémentaitres financés par le SNCE. Elle a consisté à analyser le rapport humidité/protéines sur huit espèces de poissons (cf. encadré p. 10). Nous avons ensuite établi une valeur limite au-dessus de laquelle on sort de la gamme standard. Si cette limite est dépassée, il convient alors d’aller plus loin, de lancer des analyses complémentaires de recherche d’additifs et de questionner son fournisseur.
|
Les espèces de poissons analysées Cabillaud (Gadus morhua), cabillaud du Pacifique |
3- Comment continuez-vous à lutter contre les pratiques frauduleuses ?
A.B. : Avec cette étude, nous n’avons pas été uniquement sur du one shot pour de la communication. Nous maintenons un niveau de vigilance à travers notre observatoire des fraudes. Ce groupe de travail se réunit quatre fois par an et partage les résultats de deux protocoles que nous avons mis en place. D’une part, des analyses d’échantillons prélevés anonymement par le laboratoire PFI Nouvelles Vagues sur différents canaux de distribution (GMS, hard-discount, home service et RHD). Nous nous concentrons chaque année sur quatre à cinq espèces, soit quelques dizaines de produits différents, en termes d’analyses et de mentions portées sur l’emballage. Et nous faisons remonter les constats en cas de problème. Nous ne faisons pas la police mais mettons en alerte. Par ailleurs, nous mettons en place une base de données à partir des autocontrôles H/P de nos adhérents. Nous disposons ainsi de plus de 5 000 résultats, sur les espèces de Fraud’filets ainsi que sur d’autres, afin de pouvoir, à terme, établir une référence.
L’un des résultats de cette approche a été de voir quasiment disparaître en France les fraudes par ajout d’eau non déclaré sur le pangasius, l’une des espèces emblématiques de Fraud’filets.
4- Comment les opérateurs s’approprient-ils la méthode et quelles sont les conséquences sur les rapports avec les fournisseurs et clients ?
P.M. : Je ne peux pas parler pour tous les opérateurs, mais je pense que les critères de l’étude Fraud’filets ont été adoptés par une grande majorité des intervenants du secteur. Cosmos Foods fait partie des sociétés à l’origine de l’étude et a notamment fourni des échantillons pour les analyses. Lorsque nous auditons les usines de nos fournisseurs, un préalable avant toute importation, nous pouvons imposer ces critères. Le taux H/P apparaît dans les spécifications fournisseurs et clients. Les lots sont systématiquement contrôlés selon des échantillonnages représentatifs, par des laboratoires agréés, notamment PFI Nouvelles Vagues. Lors de dépassements, ce qui est rare, nous assurons la recherche de polyphosphates, acide citrique et autres additifs. Nous alertons les fournisseurs et, en général, nous retournons voir sur place s’il a changé ses process. Aujourd’hui, les clients font référence à ces critères. Et les fournisseurs s’y sont mis aussi, passées quelques réticences liées à la varialibité naturelle des taux de protéines et humidité. Cette variabilité a justement été prise en compte dans l’étude lors de l’échantillonage. Fraud’filets est devenue une référence dans la profession, un outil commun à l’ensemble de la filière, et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a validé les résultats.
5- Comment travaille la DGCCRF ?
A.B. : Les critères de Fraud’filets sont désormais reconnus par la profession et la DGCCRF. Mais, au contraire de la filière volaille, ils ne sont pas entrés dans la réglementation, car l’univers du poisson sauvage est trop complexe. Ils le sont uniquement pour la coquille Saint-Jacques.
La DGCCRF s’est impliquée dans l’étude dès l’origine et les échantillons ont été systématiquement analysés en doublon, par PFI Nouvelles Vagues et par leur laboratoire, le SCL de Marseille. Les résultats étaient identiques. Les critères demeurent de simples indicateurs, mais ils les ont intégrés dans leurs propres contrôles.
6- Depuis Fraud’filets, comment a évolué la situation selon votre regard de professionnel ?
A.B. : Rappelons que l’ajout d’eau est autorisé. Mais il doit être indiqué dans la liste des ingrédients et, si cela dépasse 5 % du poids, dans la dénomination de vente avec la mention « eau ajoutée ». Depuis l’étude et le règlement Inco sur l’étiquetage alimentaire, il est très encadré. En fait, il existe une fraude lorsqu’il peut y avoir un profit. Elle est donc liée à la disponibilité de la marchandise et de son cours sur le marché. D’une année à l’autre, on peut en constater sur des espèces différentes. Ce n’est pas une tendance globale sur une espèce ou un marché. C’est pour cela que nous devons maintenir un haut niveau de vigilance.
P.M. : Avec Fraud’filets, nous disposons d’un outil de contrôle simple et très clair. Dans le cadre de la certification IFS Broker, basée sur l’amélioration continue, nous faisons aussi, en plus, par sondage, des recherches d’additifs. Je pense qu’il y a moins de fraudes par ajout d’eau et nous avons éduqué producteurs et clients. Les spécifications sont devenues beaucoup plus exigeantes au cours des dernières années.
7- Des études sont en cours sur deux nouvelles espèces. Pourquoi ?
A.B. : Nous avons constaté, dans le cadre des remontées d’autocontrôle des adhérents, une variabilité importante du H/P sur certaines espèces, dont nous pensions qu’elle n’était pas due à des variations naturelles du produit. Il s’agit du loup de mer et du rouget-barbet cinnabare. Nous avons donc lancé une seconde étude Fraud’filets, financée intégralement par le SNCE.
P.M. : Nous envisageons d’aboutir d’ici fin 2019. Nous devons, entre autres, réussir à nous approvisionner en poissons entiers représentatifs, c’est-à-dire, n’ayant été soumis à aucun process susceptible de les faire prendre de l’eau. Et comme la DGCCRF suit les travaux, nous devons nous entendre sur le protocole. Nous préférons prendre le temps et travailler sur une base fiable.
8- Quelles sont les fraudes potentielles les plus identifiées aujourd’hui ?
A.B. : Ces dernières années, nous avons noté beaucoup de fraudes sur le thon, destinées à modifier sa couleur. Cette espèce se dégrade rapidement et la couleur reste un indicateur de fraîcheur pour le consommateur. Certains opérateurs peu scrupuleux utilisent des composés, comme des extraits végétaux riches en nitrite, pour redonner une jolie couleur à la chair. Nous constatons aussi l’ajout d’antioxydant, de l’acide ascorbique par exemple, à fortes doses, au-delà de la teneur légale. Dès 2015, nous avons alerté sur ces pratiques. La DGCCRF et la Commission européenne ont pris nos remarques au sérieux. Des rappels à la réglementation ont été réalisés et des contrôles officiels lancés dans différents pays d’Europe. Nous continuons nos actions sur cette espèce notamment auprès de la Direction générale de la santé (DGS).
P.M. : Le problème principal est le non-étiquetage d’additifs qui permettent les ajouts d’eau. Nous essayons d’anticiper au mieux les problèmes pour y répondre. Nous savons que ce type de chose existe. C’est pourquoi le syndicat se mobilise pour anticiper et redonner confiance aux consommateurs.
9- Où en est-on avec les additifs moins détectables, comme les carbonates ?
A.B. : L’utilisation de carbonates est toujours frauduleuse, comme l’a rappelé la DGS. Certains opérateurs ont voulu les définir comme des auxiliaires technologiques, qui n’ont pas besoin d’être étiquetés. Mais ce n’est pas le cas. Des recherches sont en cours pour les détecter, notamment de la part de la DGCCRF, mais ce n’est pas simple. Nous n’avons pas encore de méthode directe disponible, mais il existe d’autres paramètres qui permettent de suspecter leur utilisation. Nous restons vigilants. Dans les discussions de l’observatoire, les opérateurs échangent et remontent les informations quant à des suspicions potentielles, des constats un peu étranges sur le terrain.
P.M. : S’il apparaît, sur le marché, des distorsions de prix importantes et constantes, nous sommes en droit de suspecter une fraude. C’est ce type de constat qui avait amené à la création de Fraud’filets.
10- Dans un autre registre, vous ouvrez un chantier sur les dénominations des découpes de poisson. Pourquoi et où en est-on ?
A.B. : Cette problématique est dans la même veine, puisqu’elle a à voir avec les pratiques déloyales pour gagner des marchés et donc avec la confiance des consommateurs. Dans des appels d’offres, des opérateurs vendent des produits sous certaines dénominations qui peuvent être fausses. Des gens vendent par exemple des « portions » alors que ce sont des « queues ». La DGCCRF avait consulté nos adhérents quant à l’existence d’usage professionnel sur les découpes. On trouve des choses écrites sur la dénomination « cœur de filet » ou sur celle de « bloc », mais pas plus. Afin de lutter contre les distorsions de concurrence et, sur des dénominations un peu trop valorisantes, contre d’éventuelles déceptions des consommateurs, nous travaillons à rationaliser les dénominations des découpes depuis 2017. Avec l’idée d’être utile à toute la filière.
Propos recueillis par Dominique Guillot
Photos Thierry NECTOUX